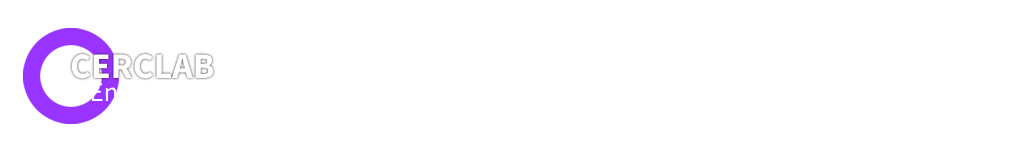CA GRENOBLE (ch. soc. sect. A), 5 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10750
CA GRENOBLE (ch. soc. sect. A), 5 mars 2024 : RG n° 21/05162
Publication : Judilibre
Extrait : « Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle (Cour de cassation, Civ. 1ère, 8 avril 2004, n° 03-04.013).
Premièrement, la SAS STC démontre, par la production d'une convention de prêt conclue entre elle-même et le salarié le 13 novembre 2015 qu'un prêt de 1.000 euros sans intérêt a été consenti au salarié, lequel s'est engagé en retour à rembourser à la société dix mensualités de 100 euros par mois. En outre, l'employeur établit qu'il a régulièrement déclaré cet emprunt au service des impôts en versant aux débats une déclaration de contrat de prêt établie sur un formulaire Cerfa et datée du 13 novembre 2015. Enfin, M. X. ne conteste pas qu'il n'a pas remboursé à la SAS STC l'intégralité de la somme qu'il lui a empruntée, mais allègue cependant qu'en raison du jugement du tribunal d'instance de Vienne du 3 octobre 2017 qui a effacé l'ensemble de ses dettes non professionnelles, et dont il verse une copie aux débats, il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'emprunt à son employeur.
Deuxièmement, la SAS STC ne démontre pas que le prêt consenti au salarié a été assujetti aux cotisations et contributions sociales en ce qu'il aurait été retenu par l'URSAAF qu'il avait la nature d'un complément de salaire, cette qualification n'étant au demeurant pas appliquée de manière automatique à tout prêt consenti par un employeur à l'un de ses salariés, cette qualité étant dans tous les cas sans incidence sur la qualité de dette professionnelle du prêt consenti, ce dont il résulte que ce moyen est inopérant. Troisièmement, la SAS STC n'allègue ni ne démontre que la dette contractée par le salarié auprès d'elle serait née pour les besoins d'une activité professionnelle.
Quatrièmement, le fait que le prêt ait été consenti par l'employeur du salarié, lequel n'a pas la qualité d'organisme de crédit, n'implique pas que la dette contractée par le salarié aurait de ce seul fait la nature de dette professionnelle, contrairement aux allégations de l'employeur. En effet, par arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a jugé, s'agissant du prêt consenti par un employeur à un salarié et à son conjoint afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier, d'une part que l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs », au sens de cette disposition, d'autre part que l'article 2, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens que ladite entreprise doit être considérée comme un « professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. Il en résulte que la dette contractée par un salarié vis-à-vis d'un employeur n'a pas la qualité de dette professionnelle mais de dette non professionnelle, et que les règles relatives aux droits de la consommation s'appliquent dans le cadre des prêts consentis par un employeur à ses salariés, peu important que l'employeur n'ait pas la qualité d'organisme de crédit, lequel employeur doit malgré cela être considéré comme professionnel au sens des dispositions dudit droit de la consommation (Cour de cassation, Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 16-12.519).
En considération de ces constatations, la dette contractée par le salarié vis-à-vis de la SAS STC, son employeur, dans le cadre du contrat de prêt du 13 novembre 2015, n'a pas la nature de dette professionnelle. Par jugement du 3 octobre 2017, dont le salarié verse une copie aux débats, le tribunal d'instance de Vienne a constaté que la situation de M. X., de bonne foi, était irrémédiablement compromise, et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X., lequel rétablissement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement audit jugement. Il ressort du jugement du 3 octobre 2017 que la SAS STC était partie à l'instance. Il résulte de ces constatations que la dette contractée par M. X. à l'égard de la SAS STC dans le cadre de l'emprunt consenti par cette dernière le 13 novembre 2015 a été effacée. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
ARRÊT DU 5 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/05162. N° Portalis DBVM-V-B7F-LE3B. Appel d'une décision (RG n° F 21/00038) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE, en date du 22 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 3], représenté par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/XXX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMÉE :
SAS STC
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, SIRET N° : XXX, [Adresse 4], [Localité 2], représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et par Maître Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 8 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X. a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 février 2015 en qualité de chauffeur livreur par la société par actions simplifiées (SAS) STC.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2015 suivant avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2015.
M. X. a été victime d'un accident du travail le 21 décembre 2015 et placé en arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2016.
Le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 18 juin 2016.
Le 6 juillet 2017, M. X. a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS STC au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2015.
Le 2 octobre 2017, M. X. a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS STC à lui payer des dommages et intérêts au titre de la violation des temps de repos, du non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, du harcèlement moral dont il allègue avoir été l'objet, et des rappels de salaire au titre du non-paiement des jours fériés, des heures supplémentaires impayées et des contreparties obligatoire en repos due au titre desdites heures supplémentaires.
A l'issue de deux visites des 16 et 24 octobre 2017, M. X. a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Le 21 novembre 2017, M. X. s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que les demandes de M. X. sont recevables,
Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
Dit et jugé que la demande reconventionnelle de la SAS STC est recevable,
Condamné M. X. à rembourser la somme de 1 411,37 euros à la SAS STC,
Condamné M. X. à verser à la SAS STC la somme de 1 411,37 euros au titre du remboursement du salaire trop perçu en mars 2017,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. X. en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 décembre 2021.
[*]
Par conclusions du 14 mars 2022 transmises par voie électronique, M. X. demande à la cour d'appel de :
« Réformer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Vienne,
Statuant à nouveau,
Juger que la SAS STC n'a pas respecté les prescriptions en matière de décompte du temps de travail et de tenue de livret,
Juger que la SAS STC n'a pas respecté la législation relative à la durée maximale hebdomadaire de travail, au temps de pause quotidien, au temps de repos quotidien,
En conséquence,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de la violation de la législation sur la durée du travail hebdomadaire,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de la violation de la législation sur le temps de pause quotidien,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de la violation de la législation sur le temps de repos quotidien,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 1 127,28 euros au titre du paiement des jours fériés en 2015 et 2016,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 3 375,07 euros au titre de rappel de paiement des heures supplémentaires effectuées,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 14 885,50 euros au titre de la dissimulation des heures supplémentaires,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 1 226,09 euros au titre du repos compensateur,
Ordonner la rectification des bulletins de salaire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Juger que la SAS STC a fait une utilisation abusive du système de géolocalisation,
Juger que la SAS STC aurait dû maintenir le salaire de M. X. à la suite de son arrêt de travail du 18 juin 2016,
Juger que la SAS STC a exercé un harcèlement moral à l'encontre de M. X.,
En conséquence,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'utilisation détournée de la géolocalisation,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 1 039,75 euros au titre du maintien de salaire durant son arrêt pour accident du travail,
Condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 5.000 euros au titre du harcèlement moral,
Juger que la SAS STC est mal fondée dans sa demande de remboursement de salaire indûment perçu et de remboursement de prêt,
En conséquence,
Débouter la SAS STC de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
Condamner la SAS STC à payer à Maître [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi 19-647 du 10 juillet 1991,
Condamner la SAS STC à payer les entiers dépens ».
[*]
Par conclusions du 13 juin 2022 transmises par voie électronique, la SAS STC demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. X. des demandes suivantes :
2.000 euros au titre de la violation de la législation sur la durée du travail hebdomadaire,
2.000 euros au titre de la violation de la législation au titre du temps de pause quotidien,
2.000 euros au titre de la violation de la législation sur le temps de repos quotidien,
1 127,28 euros au titre du paiement des jours fériés en 2015 et 2016,
3 375,07 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,
14 885,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 226,09 euros au titre du repos compensateur,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la géolocalisation,
1 039,75 euros au titre du maintien de salaire durant son arrêt pour accident du travail,
5.000 euros au titre du harcèlement moral,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 22 novembre 2021 en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de la somme 1 411,37 euros en remboursement du salaire versé à tort,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SAS STC de sa demande de condamnation de M. X. au paiement de la somme de 790 euros en remboursement du solde du prêt,
Statuant à nouveau,
Condamner M. X. au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l'instance ».
[*]
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de cette disposition que la cour d'appel n'a pas à statuer sur les chefs du dispositif qui n'énoncent pas de prétentions, notamment ceux débutant par les formules « dire et juger » et « constater » s'ils n'emportent aucune condamnation de la partie adverse.
Il ressort des conclusions de M. X. et du dispositif de celles-ci que le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à ce qu'il soit jugé que la SAS STC n'a pas respecté les prescriptions en matière de décompte du temps de travail et de tenue de livret, et, statuant à nouveau, de juger que la SAS STC n'a pas respecté ladite prescription.
Il ne peut qu'être constaté que M. X. ne tire aucune conséquence juridique de son allégation selon laquelle la SAS STC n'aurait pas respecté les prescriptions en matière de décompte du temps de travail et de tenue de livrer, ce dont il se déduit que la demande qu'il a formulée sur ce fondement dans le dispositif de ses conclusions ne constitue pas une prétention, mais un moyen sur lequel la cour d'appel n'a dès lors pas à se prononcer, conformément aux dispositions susvisées de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- La lecture des bulletins de salaire et des décomptes produits permettent de constater qu'il a travaillé au-delà de la durée légale du travail mais également des durées maximales autorisées, ce que la SAS STC reconnaît,
- Il a nécessairement subi un préjudice résultant de ce dépassement.
La SAS STC fait valoir pour sa part que :
- Il ressort des comptes rendus d'activité de M. X. que ce dernier n'a travaillé au-delà de 48 heures par semaine que sur les deux premières semaines du mois de mars 2015,
- Les heures supplémentaires ainsi réalisées ont été rémunérées sans qu'à aucun moment le salarié n'en critique la réalisation,
- Aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre,
- Dans tous les cas, M. X. ne prouve pas l'existence d'un préjudice justifiant la demande de dommages et intérêts sollicitée.
Sur ce,
Selon l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Selon l'article L. 3121-21 du même code, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 et L. 3121-25.
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail relatifs aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, qui incombe à l'employeur.
Par ailleurs, le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire applicable, en ce qu'il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Il en résulte que le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation.
Il ressort des conclusions de la SAS STC que celle-ci reconnaît que le salarié a travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire autorisée de 48 heures les deux premières semaines du mois de mars 2015.
A l'examen des comptes-rendus d'activité hebdomadaires de l'année 2015 complétés manuscritement par le salarié, produits par l'employeur, et qui ont manifestement été corrigés manuscritement par ce dernier et font mention pour chacun d'eux du nombre d'heures de travail hebdomadaire effectuées sur la base des horaires indiqués par le salarié éventuellement corrigés par l'employeur, la cour d'appel relève que la durée maximale de travail hebdomadaire n'a pas été seulement dépassée les deux premières semaines du mois de mars 2015, mais à de nombreuses reprises par la suite.
Le fait que les heures supplémentaires réalisées aient été en partie payées, ce que ne conteste pas le salarié, et que le salarié ne se soit jamais plaint de devoir réaliser des heures supplémentaires, est sans incidence sur la violation par l'employeur de son obligation de respecter les durées maximales de travail, telles que prévues par les dispositions susvisées du code du travail.
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire autorisée a porté atteinte au droit au repos du salarié, et lui a nécessairement causé un préjudice, qui sera justement réparé par la condamnation de la SAS STC à lui payer la somme de 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre du non-respect du temps de repos quotidien :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- L'employeur a reconnu dans ses écritures ne pas avoir respecté les prescriptions en la matière, a minima à trois reprises au début du mois de mars 2015,
- Les décomptes de ses horaires de travail hebdomadaires démontrent que le temps de repos quotidien d'une durée minimum de onze heures consécutives n'a pas été respecté par la SAS STC,
- Le jugement des premiers juges s'est affranchi du respect du droit en retenant, pour le débouter de sa demande, que le temps de repos quotidien a été respecté au cours des autres semaines de la relation de travail.
La SAS STC fait valoir pour sa part que :
- Il ressort des comptes rendus hebdomadaires que le salarié a bien bénéficié de 11 heures consécutives de repos quotidien, à l'exception de trois jours sur la première semaine du mois de mars 2015,
- Ces trois manquements sont insuffisants pour établir l'existence d'un préjudice.
Sur ce,
Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L'employeur reconnaît dans ses conclusions que la durée minimale de repos quotidien de onze heures n'a pas été respectée à trois reprises la première semaine du mois de mars 2015, ce qui ressort du compte-rendu hebdomadaire des horaires de travail pour cette semaine produit aux débats.
Ce manquement de l'employeur à son obligation a porté atteinte au droit au repos du salarié, lui causant de ce fait un préjudice dont il est bien fondé à demander la réparation, et qu'il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de fixer à la somme de 1.000 euros net.
La SAS STC est condamnée à payer cette somme à M. X., par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre du non-respect des temps de pause :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- Il n'a pas bénéficié des temps de pause conformément aux dispositions applicables au transport routier,
- Les relevés de temps de travail produits par l'employeur sont dénués de mentions relatives aux temps de pause,
- Si l'employeur n'a pas formalisé ses temps de pause, c'est parce qu'ils n'existaient pas,
- Le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en le déboutant au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé sans réaliser les temps de pause réglementaires,
- Il aurait dû bénéficier a minima de 45 minutes de temps de pause quotidien.
La SAS STC fait valoir pour sa part que :
- Des temps de pause apparaissent sur les comptes rendus d'activité hebdomadaires du salarié,
- Le salarié n'a pas voulu renseigner systématiquement les pauses quotidiennes dont il a bénéficié, en violation des instructions de son employeur,
- En effet, il a été alerté sur le non-respect des temps de pause comme l'indique précisément la lettre que la SAS STC lui a adressée le 22 mai 2017,
- Il ne peut pas aujourd'hui judiciairement reprocher à son employeur un prétendu non-respect des temps de pause, alors que l'erreur lui incombe entièrement et est délibérée,
- Le salarié avait une grande expérience dans le domaine du transport routier, et ne peut soutenir ne pas être au fait de la réglementation sur les temps de pause,
- Enfin, M. X. ne démontre l'existence d'aucun préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Sur ce,
Selon l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bien pu bénéficier des temps de pause prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 3121-16 du code du travail.
Le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de ses temps de pause peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Il ressort des comptes-rendus hebdomadaires des horaires de travail que le salarié n'a pas mentionné la réalisation d'une pause pour l'ensemble des jours travaillés, seuls certains d'entre eux, en nombre restreints, portant l'indication de la réalisation d'une pause avec sa durée en minutes.
Il ne peut être valablement soutenu par la SAS STC que M. X. aurait bien pris ses temps de pause, mais qu'il ne les aurait pas mentionnés de manière systématique.
En effet, premièrement, cette allégation, non démontrée, ne permet pas de contredire le salarié qui soutient pour sa part qu'il n'a mentionné la durée de ses pauses que lorsqu'il a eu la possibilité de les prendre.
Deuxièmement, la SAS STC se contredit en soutenant que le salarié aurait bien bénéficié de ses temps de pause, mais qu'il aurait simplement omis de les indiquer, alors qu'elle verse aux débats un courrier adressé à celui-ci daté du 22 mai 2017, en réponse à un courrier de M. X., dans lequel elle soutient qu'elle n'interdit pas les temps de pause, mais qu'elle est obligée « d'intervenir pour que les salariés respectent ces temps de pause car plusieurs d'entre eux, comme vous, préfèrent ne pas prendre leurs pauses afin de terminer leur service plus tôt », la SAS STC reconnaissant ainsi que M. X. ne prenait pas ses temps de pause.
Or, il ne peut qu'être constaté que la SAS STC ne démontre ni qu'elle aurait enjoint au salarié avant ce courrier du 22 mai 2017 de respecter ses temps de pause, ni que le salarié aurait bien délibérément refusé de prendre ses pauses afin de terminer son service plus tôt, alors qu'il était placé dans la situation de pouvoir les prendre, ce que conteste le salarié qui invoque une cadence de travail telle qu'il lui était matériellement impossible de prendre ses temps de pause.
En considérations de ces constatations, le non-respect par l'employeur de son obligation de permettre à M. X. de bénéficier des pauses prévues par la législation, dont la charge lui incombe entièrement, est établi.
L'atteinte au droit au repos qui en résulte a nécessairement causé un préjudice à M. X., qui sera justement réparé, eu égard à la durée du manquement et ses conséquences sur sa santé et sa sécurité, par la condamnation de la SAS STC à lui payer la somme de 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du non-paiement des jours fériés :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- La convention collective nationale des transports routiers en son article 7 bis prévoit que pour les salariés de 6 mois d'ancienneté, le paiement de 5 jours en plus du 1er mai est déterminé par l'employeur et ce, même s'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire,
- L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là,
- Il a droit au paiement des cinq jours fériés supplémentaires au 1er mai, ces périodes doivent être rémunérées quelle que soit l'absence de travail y compris en période d'incapacité pour accident de travail.
La SAS STC fait valoir pour sa part que :
- Au cours de l'année 2015 et avant son accident du travail, les jours fériés, quels qu'ils soient, lui ont été normalement payés comme le confirment les comptes rendus d'activité et ses bulletins de salaire,
- S'agissant de la période au cours de laquelle le contrat de travail de M. X. a été suspendu, le salarié a bénéficié du versement des indemnités journalières de sécurité sociale servies aux salariés victimes d'accident du travail, de sorte que sa demande au titre des années 2016 et 2017 est dénuée de fondement.
Sur ce,
Selon l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Par ailleurs, selon les stipulations de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 applicables à la relation de travail :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;
- les périodes d'absence autorisée.
L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés ».
Le salarié ayant été embauché à compter du 25 février 2015, il en résulte qu'il pouvait bénéficier du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile à compter du 24 août 2015.
Il doit être relevé que M. X., qui sollicite que lui soient payés les jours fériés non travaillés pour un total de dix jours, n'indique pas dans ses conclusions quels jours fériés n'auraient pas été travaillés et ne lui auraient pas été payés en violation des dispositions susvisées de la convention collective applicable à la relation de travail.
Il ressort des comptes-rendus hebdomadaires complétés par le salarié et produits par l'employeur que plusieurs jours ne font pas mention d'horaires de travail mais portent l'indication « Férié » écrite manuscritement ou sont simplement barrés sans mention : le 6 avril 2015, lundi de Pâques ; le 8 mai 2015 ; le 14 mai 2015, Ascension ; le 25 mai 2015, lundi de Pentecôte ; le 14 juillet 2015, et le 11 novembre 2015.
Dès lors, il y a lieu de retenir, le salarié ne contredisant pas l'employeur sur ce point, que M. X. n'a pas travaillé ces jours fériés.
A l'examen des bulletins de salaire de l'année 2015 versés aux débats par l'employeur, il n'apparaît pas que le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité de son salaire pour les mois correspondant aux jours fériés ci-dessus mentionnés, aucune retenue n'apparaissant au titre de ces jours fériés non travaillés.
Il en résulte que le salarié a été parfaitement rempli de ses droits s'agissant de la période au cours de laquelle il a travaillé, soit de son embauche jusqu'à son arrêt de travail pour accident du travail le 21 décembre 2015.
S'agissant de la période à partir de laquelle le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail, celui-ci ne contredit pas son employeur qui allègue qu'il a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale en lieu et place du paiement de son salaire. Celles-ci étant calculées sur le fondement de la rémunération perçue par le salarié au cours des périodes travaillés il en résulte que celui-ci a été également rempli de ses droits s'agissant du paiement des jours fériés non travaillés.
M. X. est débouté de sa demande de rappel de salaire formulé à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- Il n'a pas été rémunéré de la totalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées, l'employeur n'en ayant payé qu'une partie,
- Le nombre d'heures supplémentaires réalisées ressort des comptes-rendus hebdomadaires qu'il a remplis et qui sont produits par l'employeur.
La SAS STC fait valoir pour sa part que :
- Le salarié ne produit aucun décompte lui permettant de répondre utilement en contrôlant ses déclarations,
- Les attestations de deux salariées produites par M. X. ne peuvent établir qu'il a bien effectué les heures supplémentaires alléguées,
- Elle produit les comptes rendus hebdomadaires remplis par le salarié lui-même au titre de l'année 2015, sur lesquels sont inscrites, semaine par semaine, les heures effectivement accomplies et ce de manière quotidienne,
- Un calcul hebdomadaire des heures supplémentaires se décomptant par semaine civile au sens de l'article L. 3121-20 du code du travail était systématiquement rappelé sur les comptes-rendus en question,
- Il ressort de la comparaison entre ces comptes-rendus et les bulletins de paie que l'ensemble des heures supplémentaires réalisées ont été reportées sur les bulletins de salaire et payées conformément aux règles applicables.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, M. X. produit dans ses conclusions un tableau des heures supplémentaires payées par l'employeur telles qu'elles sont mentionnées sur les bulletins de paie, et allègue que la SAS STC ne lui a pas payé la totalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées telles que celles-ci sont mentionnées sur les comptes-rendus hebdomadaires qu'il a lui-même complétés et qui sont produits par l'employeur, M. X. précisant que celui-ci ne lui a rémunéré que 209 heures supplémentaires sur les 464,4 heures qu'il prétend avoir effectuées, le rappel de salaire lui étant dû s'élevant en conséquence à 3 068,25 euros brut dès lors que ces heures doivent être majorés de 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargés de contrôler la durée du travail de ses salariés, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Or, la SAS STC se limite à alléguer qu'elle a rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires figurant sur les comptes-rendus hebdomadaires sans expliquer pour quelles raisons les décomptes du nombre total d'heures réalisées par semaine par le salarié, tels qu'ils apparaissent sur chacun de ces comptes-rendus et sur la base desquels elle a manifestement déterminé le nombre d'heures supplémentaires dues au salarié ne correspondent pas aux horaires indiqués par le salarié sur lesdits comptes-rendus, les totaux des heures réalisées étant systématiquement minorés.
Faute pour l'employeur de justifier cette différence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en condamnant la SAS STC à lui payer la somme de 3 068,25 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, outre 306,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir qu'il a droit à l'indemnité prévue pour travail dissimulé, l'intention de dissimulation des heures supplémentaires réalisées s'évinçant de l'absence de non-paiement de la totalité des heures supplémentaires réalisées, alors que la SAS STC avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail à travers les comptes-rendus hebdomadaires qu'il complétait et lui remettait.
La SAS STC fait valoir pour sa part que le salarié échoue à rapporter la preuve de l'intention de dissimulation des heures supplémentaires réalisées par le salarié.
Sur ce,
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La SAS STC échouant à justifier des raisons pour lesquelles elle n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires résultant des comptes-rendus hebdomadaires complétés par le salarié et qu'elle verse elle-même aux débats, il doit être retenu que l'intention de dissimulation d'une partie des heures de travail effectuées par le salarié est établie.
M. X. est dès lors fondé à prétendre à l'indemnité prévue par les dispositions susvisées de l'article L. 8221-5 du code du travail.
La SAS STC est ainsi condamnée à lui payer la somme de 14 885,50 euros net à ce titre, dont elle ne critique pas utilement le calcul effectué par le salarié, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- Selon l'article R. 3312-48 du code des transports, il a droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée varie en fonction du nombre d'heures supplémentaires réalisées,
- Il n'a jamais été destinataire du nombre d'heures de contrepartie qui lui étaient dues,
- Il n'a pas été informé des modalités lui permettant de bénéficier de la compensation due,
- La SAS STC lui est donc redevable d'un rappel de salaire à ce titre.
La SAS STC fait valoir pour sa part que :
- Le salarié a déjà bénéficié des contreparties obligatoires en repos qui lui étaient dues au titre des heures supplémentaires réalisées,
- Le décompte produit par M. X. est incompréhensible,
- La SAS STC a bien remis au salarié les relevés d'activité, lequel en a expressément accusé réception par lettre du 2 août 2017,
- Elle a ainsi parfaitement satisfait à ses obligations à ce titre.
Sur ce,
Selon l'article 5 5° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa version modifiée par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, applicable aux faits de l'espèce :
« Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ».
En outre, selon l'article R. 3171-11 du code du transport, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
La SAS STC, qui soutient dans ses conclusions avoir régulièrement informé le salarié du nombre de jours auxquels celui-ci avait droit à titre de compensation obligatoire en repos trimestrielle au titre des heures supplémentaires, ne produit aucun élément permettant de le démontrer, les courriers des 2 et 10 août 2017 adressés au salarié visés par l'employeur dans ses conclusions, outre qu'ils ont été envoyés après l'arrêt de travail de M. X. et non au cours de la période travaillée, faisant uniquement mention des comptes-rendus des horaires de travail remis par le salarié à son employeur chaque semaine.
Par ailleurs, il ressort du courrier du 22 mai 2018, par lequel la SAS STC indique au salarié qu'il « n'a jamais été question de ne pas (lui) allouer de repos compensateurs pour les périodes concernés par (son activité) et permettant le bénéfice de tels repos. A ce jour, et compte tenu de votre arrêt de travail, ces repos sont conservés à votre compteur et un tableau récapitulatif vous sera prochainement communiqué. Ces repos pourront être pris loin de votre retour à votre poste de travail », que l'employeur reconnaît qu'il n'a pas communiqué au salarié les relevés lui permettant d'avoir connaissance de ses droits au cours de la période travaillée.
La SAS STC ne verse pas aux débats ce tableau.
En tout état de cause elle se limite à contester les heures supplémentaires revendiquées sans alléguer ni a fortiori démontrer qu'elle aurait payé les journées dues au titre de la compensation obligatoire en repos au moment de la rupture de la relation de travail.
Dès lors, eu égard aux calculs produits par le salarié dans ses conclusions, qui ne sont pas utilement contestés par la SAS STC, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à M. X. la somme de 1 114,63 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la compensation obligatoire en repos due au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 111,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire au cours de l'arrêt de travail :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- La convention collective des transports routiers prévoit le maintien à 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt de travail, puis de 75 % du 31e au 90e jour d'arrêt,
- Ensuite de son accident de travail en date du 18 juin 2016, le maintien de salaire se calcule donc à 100 % du 18 juin au 17 juillet, puis à 75 % sur 60 jours du 18 juillet au 15 septembre 2016,
- Il remplissait les conditions pour bénéficier de ces dispositions à la date du 18 juin 2017,
- Il ne peut être retenu que l'arrêt du 18 juin 2016 est la simple prolongation de l'arrêt du 21 décembre 2015.
La SAS STC fait valoir que :
- La règle du maintien de salaire n'est juridiquement applicable, aux termes de l'article 10 ter de la convention collective nationale des transports routiers, qu'à la condition que le salarié au moment de l'accident du travail ait une ancienneté d'un an, ce qui n'était pas le cas du salarié au moment de son accident du travail survenu le 21 décembre 2015,
- Le second accident du travail du 18 juin 2016 n'a pas donné lieu à un nouvel arrêt de travail mais à une prolongation de l'arrêt initial du 21 décembre 2015,
- Le salarié ne peut donc bénéficier des dispositions de la convention collective au titre de ce second accident du travail.
Sur ce,
Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article D. 1226-1 du même code, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Selon l'article 17 bis c) de l'Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
« En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :
- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;
- soit au titre de l'assurance accidents du travail,
le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
(')
c) Absences pour accident du travail
Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
Après 1 an d'ancienneté :
Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :
- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;
- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;
bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt ».
Aussi bien les dispositions du code du travail que les stipulations plus favorables de la convention collective applicable à la relation de travail conditionnent l'obligation pour l'employeur de maintenir le salaire à la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail à une ancienneté dans l'entreprise d'au moins un an.
Le salarié ayant été embauché à compter du 25 février 2015, il en résulte qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions susvisées qu'à compter du 25 février 2016.
Il ressort des moyens échangés que le différend opposant les parties porte sur le maintien de salaire à compter de l'arrêt de travail du 18 juin 2016, soit après le 25 février 2016.
Il s'évince des certificats d'arrêt de travail pour accident du travail du salarié produits par l'employeur que M. X. a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 décembre 2015 et que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 11 juin 2016.
La SAS STC ne contredit pas le salarié qui allègue qu'il a repris le travail à compter du 13 juin 2016, et qu'il a été victime d'un nouvel accident du travail le 16 juin 2016, entraînant un nouvel arrêt de travail à compter de cette date.
S'il ressort du certificat d'arrêt de travail pour accident du travail du 18 juin 2016 versé aux débats par l'employeur que le médecin traitant du salarié a coché la case « prolongation », il ne peut être valablement soutenu que ce certificat d'arrêt de travail n'aurait pas fait démarrer un nouveau cycle d'indemnisation par la sécurité sociale, dès lors que le salarié a repris le travail à compter du 13 juin 2016 entraînant le versement d'une rémunération par l'employeur pour cette période.
Il en résulte que le salarié est fondé à prétendre au bénéfice des stipulations susvisées de la convention collective à compter du 18 juin 2016, date du nouvel arrêt de travail pour accident du travail consécutif à sa rechute.
La SAS STC ne présente aucune critique utile du calcul effectué par M. X. au titre d'un rappel de salaire résultant du maintien de son salaire, soit la somme de 1 896,84 euros brut, le salarié alléguant en outre que l'employeur lui aurait versé la somme de 857,09 euros en mars 2017 et demandant à ce que cette somme soit déduite de la somme due au titre du maintien de salaire, il y a lieu de condamner la SAS STC à payer à M. X. la somme de 1 039,75 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période de quatre-vingt-dix jours suivant le début de l'arrêt de travail du 18 juin 2016, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la licéité de l'utilisation de la géolocalisation par l'employeur et les dommages et intérêts au titre du préjudice moral en résultant :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- La SAS STC a fait une utilisation non conforme à ses déclarations à la CNIL du système de géolocalisation mis en place au sein de l'entreprise,
- L'employeur a utilisé ce système afin d'écrêter les heures supplémentaires effectuées au motif qu'il passait trop de temps chez les clients,
- Il a subi un préjudice moral dont il demande la réparation.
La SAS STC fait valoir que :
- Les règles applicables à l'époque des faits étaient celles fixée par la délibération de la Commission Nationale Informatique et Liberté (ci-après dénommée CNIL) du 4 juin 2015 laquelle imposait que « ['] des données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ['] »,
- Elle a parfaitement respecté les règles en vigueur à l'époque des faits, en informant M. X. comme l'ensemble des salariés de l'entreprise de l'existence d'un système de géolocalisation, ce qui ressort du contrat de travail,
- Les élus du personnel ont été consultés à ce titre comme le confirme le procès-verbal de consultation du 19 juin 2014,
- La CNIL a été destinataire dès le 30 décembre 2009 d'une déclaration préalable par la société STC relative au traitement de données à caractère personnel,
- La société intimée a réitéré cette déclaration préalable le 5 janvier 2010 et le 21 décembre 2015,
- Le salarié ne fait la démonstration d'aucune faute à ce titre.
Sur ce,
Selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Par ailleurs, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Selon L. 1222-3 du même code, le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Selon l'article L. 1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Selon l'article L. 2312-38 alinéa 3 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Il ressort de l'avenant au contrat de travail du 29 mai 2015 par lequel le contrat de travail à durée déterminée du 25 février 2015 est devenu à durée indéterminée à compter du 30 mai 2015, que M. X. a été « informé que les véhicules sont équipés d'un système de géolocalisation GPS, déclaré à la CNIL et mis en place notamment pour mieux allouer les moyens en fonction des livraisons à accomplir, permettant de les localiser à tout moment. Toute tentative de débrancher ce matériel sera considéré comme une faute grave » (article 7).
Le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 19 juin 2014, produit par l'employeur, fait apparaître que la direction a informé le comité d'entreprise de la mise en place d'un système de vidéo-surveillance et non d'un système de géolocalisation.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS STC n'a pas informé le comité d'entreprise de la mise en place d'un dispositif de géolocalisation susceptible de permettre un contrôle de l'activité des salariés, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 2312-38 alinéa 3 du code du travail.
La SAS STC verse également aux débats des déclaration à la CNIL des 30 décembre 2009, 5 janvier 2010, et 21 décembre 2015 de géolocalisation des véhicules des employés. Toutefois, il doit être constaté que ces documents ne font pas mention de la finalité que l'employeur a entendu assigner au système de géolocalisation mis en place.
Il ressort du courriel que la CNIL a adressé au salarié le 16 mars 2017, que produit l'employeur, que cet organisme a confirmé à M. X. que la SAS STC avait bien fait une déclaration du dispositif de géolocalisation en conformité avec la loi 78-17 du 6 janvier 1978, dit loi Informatique et Libertés. Il doit par ailleurs être relevé que la CNIL indique au salarié dans ce même courriel qu'elle a retenu dans sa délibération du 4 juin 2015 que le suivi du temps de travail des salariés constituait l'une des finalités pouvant être assignées à la mise en place d'un système de géolocalisation lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d'autres moyens.
Cependant, la SAS STC ne produit aucun élément démontrant d'une part qu'elle ne pouvait assurer ce suivi par un autre moyen, d'autre part qu'elle aurait informé le salarié de cette finalité, le contrat de travail ne mentionnant comme unique finalité la meilleure allocation des moyens en fonction des livraisons à accomplir, finalité également mentionné par la CNIL dans la courriel susvisé dans les termes suivants : « meilleur allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés ».
Il résulte de ces constatations que la SAS STC ne pouvait recourir au dispositif de géolocalisation mis en place pour contrôler le temps de travail des salariés.
Or, il ressort d'un courrier de l'employeur daté du 22 mai 2017 adressé au salarié que la SAS STC a reconnu qu'elle avait recours au système de géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés de l'entreprise : « Ensuite, comme vous l'indiquez, la géolocalisation permet effectivement un suivi du temps de travail. Dans votre cas, il a permis de mettre en avant votre refus de respecter les temps de pause ».
Par ailleurs, le salarié produit deux attestations d'anciens salariés de la SAS STC exerçant les fonctions de livreur durant la période d'emploi de M. X., desquels il ressort que l'employeur s'appuyait sur les données fournies par le dispositif de géolocalisation pour leur reprocher de passer trop de temps chez les clients et justifier sa décision de retrancher du temps de travail des horaires déclarés par ces derniers.
Il a été relevé précédemment que les comptes-rendus hebdomadaires des horaires de travail du salarié complété par ce dernier, produits par l'employeur, avaient manifestement été corrigés par l'employeur, afin de minorer la durée de travail du salarié, et la rémunération due en conséquence au titre des heures supplémentaires accomplies.
Ces éléments, précis et concordants, sont suffisants pour retenir que la SAS STC a fait un usage détourné et par conséquent illicite du dispositif de géolocalisation mis en place, et que cet usage a causé un préjudice moral au salarié, en ce qu'il a contraint le salarié à travailler sous la surveillance injustifiée et illicite de son employeur, cette contrainte obérant d'autant sa capacité à remplir convenablement les missions qui lui étaient assignées dans le respect de son droit à la vie privée et de son droit à la santé et à la sécurité.
Le préjudice ainsi subi sera justement réparé par la condamnation de la SAS STC à lui payer la somme de 3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour usage illicite du dispositif de géolocalisation mis en place, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral :
Moyens des parties,
M. X. fait valoir que :
- Il n'a passé sa visite médicale d'embauche que plusieurs mois après le début de la relation de travail,
- Il a subi une surcharge de travail,
- Il a subi des conditions de travail dégradées,
- Il a été victime d'un premier accident du travail le 21 décembre 2015,
- La SAS STC a fait un usage illicite du système de géolocalisation,
- Lors de sa semaine de reprise, il a effectué 43 heures en quatre jours, soit plus de 10 heures par jour,
- Il a perdu connaissance le 16 juin 2016, mais il a été contraint de terminer sa tournée,
- Ces faits laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La SAS STC fait valoir que :
- Le salarié ne peut invoquer avoir subi un accident du travail au titre de la reconnaissance d'un harcèlement moral, puisque cela revient à invoquer une faute de l'employeur, dont la connaissance ne relève pas de la juridiction prud'homale,
- Dans tous les cas, une décision devenue définitive a été rendue par le Pôle social du tribunal de grande instance de Vienne le 1er avril 2018 qui a débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS STC,
- Elle démontre que l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité étaient respectées dans l'entreprise, et que le salarié avait été informé de l'ensemble des règles applicables dans l'entreprise,
- Le salarié ne produit aucun élément au soutien de ses allégations de surcharge de travail et de conditions de travail dégradées,
- Elle n'a fait aucun usage illicite du système de géolocalisation,
- Elle a respecté la règlementation relative à la durée maximale de travail,
- Le salarié n'établit aucun fait laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Sur ce,
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le salarié se limite dans ses conclusions à solliciter la réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait d'une situation de harcèlement moral, laquelle prétention relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS STC visant à ce que la demande de M. X. soit déclarée irrecevable au motif qu'elle relèverait de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'elle aurait pour effet la réparation du dommage résultant d'un accident du travail est inopérante et ne peut qu'être rejetée.
Partant, il est sans pertinence et sans incidence que par décision irrévocable rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne le 1er avril 2019, il ait été jugé que l'accident du travail dont M. X. a été victime le 21 décembre 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS STC, la cour d'appel rappelant qu'elle n'est dans tous les cas pas tenue par les décisions rendues par les juridictions du droit de la sécurité sociale s'agissant des demandes relevant de la compétence de la juridiction prud'homale.
M. X. allègue avoir subi une situation de harcèlement moral caractérisée par les faits suivants :
- La visite médicale préalable à l'embauche n'a été passée que le 1er juin 2015, alors qu'il a été embauché à compter du 25 février 2015,
- Il a subi une surcharge de travail extrêmement importante, aussi bien s'agissant du nombre de cartons à livrer que des amplitudes de travail,
- Il transportait quotidiennement une centaine de colis pour un poids moyen par colis de 15 kilogrammes,
- Il a fait l'objet d'un contrôle de la part de son employeur par le biais d'un usage détourné du dispositif de géolocalisation des véhicules de l'entreprise,
- Il a subi un premier accident du travail le 21 décembre 2015,
- A sa reprise, aucune mesure particulière n'a été mise en 'uvre, malgré les préconisations de la médecine du travail, et il a effectué plus de 43 heures de travail sur quatre jours la semaine de sa reprise, soit plus de dix heures de travail par jour,
- Il a subi un nouvel accident du travail le 16 juin 2016, avec perte de connaissance, mais les secours n'ont pas été appelés, et il a été contraint de terminer sa tournée.
S'agissant de la visite médicale d'embauche, M. X. verse aux débats son dossier médical auprès de la médecine du travail, duquel il ressort qu'il a été convoqué une première fois le 14 avril 2015, mais qu'il a lui-même annulé la visite, une seconde fois le 23 avril 2015, mais qu'il ne s'y est pas rendu, et une troisième fois le 1er juin 2015, jour auquel la visite a bien eu lieu.
Ce fait est établi.
Il a été précédemment retenu que la SAS STC n'avait pas respecté à plusieurs reprises la durée maximale de travail hebdomadaire, ainsi que le temps de repos quotidien.
Ce fait est établi.
S'agissant du nombre de colis à transporter et de leur poids, s'il s'évince des horaires de travail importants réalisés par le salarié, eu égard notamment au nombre d'heures supplémentaires réalisé, que le salarié a été amené à livrer un grand nombre de colis, M. X. ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir qu'il lui a été confié des colis dont le poids moyen était de 15 kilogrammes. Ce fait est établi uniquement s'agissant du grand nombre de colis à livrer.
Il a été retenu précédemment que la SAS STC avait fait un usage illicite du dispositif de géolocalisation des véhicules de l'entreprise, aux fins de contrôler la durée du travail des salariés. Ce fait est établi.
Il est établi que M. X. a été placé en arrêt de travail pour accident du travail une première fois à compter du 21 décembre 2015, puis à nouveau à compter du 18 juin 2016, peu de temps après sa reprise le 13 juin 2015. Par ailleurs, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail après avis rendus par la médecine du travail les 16 et 24 octobre 2017. Ces faits sont établis.
S'agissant des conditions du deuxième accident du travail, le salarié verse aux débats une attestation d'un collège de travail, M. [H] [J], qui indique que le salarié, peu de temps après sa reprise en juin 2016, s'est ouvert le crâne, car les conditions de chargement étaient inappropriées, qu'il a fait un malaise vagal. M. [H] ajoute qu'il a insisté pour que M. X. se rende à l'hôpital, mais celui-ci appréhendait d'être à nouveau placé en arrêt de travail, et qu'ils « l'ont laissé partir sans prendre de nouvelles ». Le salarié ne produit aucun autre élément pertinent susceptible de corroborer les déclarations de ce seul témoin. Ces éléments sont insuffisamment précis pour éclairer la cour sur les circonstances exactes dans lesquelles s'est déroulé le second accident du travail.
Pris ensemble, les éléments matériellement établis par le salarié laissent supposer une situation de harcèlement moral de type managérial, en ce qu'ils tendant à établir que l'organisation du travail dans la société, notamment en raison du contrôle exercé à l'encontre des salariés par l'usage illicite du dispositif de géolocalisation aux fins de les assujettir à une cadence de travail élevée et à minorer la durée de travail déclarés par eux, a pour effet une dégradation de leurs conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
La SAS STC, dont l'argumentation développée se limite à réfuter tout usage illicite du dispositif de géolocalisation, tout dépassement de la durée maximale du travail et le respect des durées de repos quotidien, échoue à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des raisons objectives à tout harcèlement moral, le fait qu'elle ait correctement évalué les risques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'elle verse aux débats, et que le salarié ait été informé sur les risques inhérents à son activité par la remise d'un livret d'accueil étant dépourvus de pertinence au cas d'espèce.
Dès lors, il doit être jugé que le salarié a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail durant la totalité de sa période d'emploi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi précédemment décrites, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. X. telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts, à laquelle la SAS STC est condamnée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement du salaire trop-perçu en mars 2017 :
Moyens des parties,
La SAS STC fait valoir que :
- Le salarié n'a jamais remboursé la somme de 1 411,37 euros qui lui a été versée à tort, au titre d'une « régularisation indu » au mois de mars 2017, malgré la lettre qu'elle lui a adressée le 14 mars 2017,
- Elle lui a proposé un échéancier de remboursement sur six mois, auquel le salarié n'a jamais donné suite.
M. X. fait valoir pour sa part que :
- Il a sollicité des avances sur salaire, qui ont toutefois donné lieu à de nombreuses erreurs, qui ont été reconnues par la société,
- En conséquence, aucun trop-perçu n'est dû à la société.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
La constatation de l'erreur n'est pas une condition nécessaire à la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette.
Premièrement, il doit être constaté que le salarié conteste dans ses conclusions avoir perçu en mars 2017 la somme de 1 411,37 euros, reconnaissance toutefois qu'il a reçu au cours de ce même mois la somme de 857,09 euros, laquelle a été déduite du rappel de salaire dû au titre du maintien de salaire au titre de l'arrêt de travail pour accident du travail à compter du 18 juin 2016 conformément à sa demande formulée dans ses conclusions et à la somme demandée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Deuxièmement, il ne ressort pas du bulletin de salaire du mois de mars 2017, produit par l'employeur, que la SAS STC aurait versé par erreur la somme de 1 411,37 euros, ce bulletin faisant certes mention de la somme de 1 411,37 euros mais en tant que somme à déduire au titre d'une régularisation indue, et le bulletin indiquant un salaire net à payer négatif de -1 973,16 euros.
Troisièmement, si la SAS STC produit un premier courrier adressé au salarié daté du 14 mars 2017 par lequel il est indiqué à ce dernier qu'un virement d'un montant de 1 411,37 euros a été effectué à tort sur son compte bancaire et le priant de bien vouloir le rembourser, un second courrier de rappel du 12 avril 2017, un troisième courrier du 20 juin 2017 du salarié proposant à son employeur un échéancier pour rembourser la somme de 1 411,37 euros, ainsi qu'un quatrième courrier en réponse de l'employeur daté du 28 juin 2017 dans lequel celui-ci propose un autre échéancier pour le remboursement, ces éléments sont insuffisants, faute pour la SAS STC de produire un élément de nature comptable ou bancaire, pour démontrer la réalité du virement de la somme alléguée sur le compte bancaire du salarié.
En considération de ces constatations, il y a lieu de débouter la SAS STC de se demande reconventionnelle de répétition de la somme de 1 411,37 euros, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement du prêt consenti par l'employeur :
Moyens des parties,
La SAS STC fait valoir que :
- Elle a consenti à M. X. un prêt de 1.000 euros dans le cadre d'une convention de prêt ad hoc qui a été déclarée au service des impôts,
- Le remboursement de prêt consenti à M. X. par la société S.T.C. a la nature de dette professionnelle,
- Il ne peut en conséquence lui être opposé le jugement du tribunal d'instance de Vienne du 3 octobre 2017 qui a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation de M. X. avec pour conséquence « [...] l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement [...] ».
M. X. fait valoir pour sa part que :
- Il a été contraint de déposer un dossier de surendettement en raison de difficultés financières,
- Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal d'instance de Vienne a jugé qu'il était de bonne foi, que sa situation était irrémédiablement compromise, et ordonné l'effacement de toutes les dettes non professionnelles,
- La SAS STC était partie à l'instance et ne pouvait donc ignorer l'effacement de ses dettes.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle (Cour de cassation, Civ. 1ère, 8 avril 2004, n° 03-04.013).
Premièrement, la SAS STC démontre, par la production d'une convention de prêt conclue entre elle-même et le salarié le 13 novembre 2015 qu'un prêt de 1.000 euros sans intérêt a été consenti au salarié, lequel s'est engagé en retour à rembourser à la société dix mensualités de 100 euros par mois.
En outre, l'employeur établit qu'il a régulièrement déclaré cet emprunt au service des impôts en versant aux débats une déclaration de contrat de prêt établie sur un formulaire Cerfa et datée du 13 novembre 2015.
Enfin, M. X. ne conteste pas qu'il n'a pas remboursé à la SAS STC l'intégralité de la somme qu'il lui a empruntée, mais allègue cependant qu'en raison du jugement du tribunal d'instance de Vienne du 3 octobre 2017 qui a effacé l'ensemble de ses dettes non professionnelles, et dont il verse une copie aux débats, il n'est plus redevable d'aucune somme au titre de l'emprunt à son employeur.
Deuxièmement, la SAS STC ne démontre pas que le prêt consenti au salarié a été assujetti aux cotisations et contributions sociales en ce qu'il aurait été retenu par l'URSAAF qu'il avait la nature d'un complément de salaire, cette qualification n'étant au demeurant pas appliquée de manière automatique à tout prêt consenti par un employeur à l'un de ses salariés, cette qualité étant dans tous les cas sans incidence sur la qualité de dette professionnelle du prêt consenti, ce dont il résulte que ce moyen est inopérant.
Troisièmement, la SAS STC n'allègue ni ne démontre que la dette contractée par le salarié auprès d'elle serait née pour les besoins d'une activité professionnelle.
Quatrièmement, le fait que le prêt ait été consenti par l'employeur du salarié, lequel n'a pas la qualité d'organisme de crédit, n'implique pas que la dette contractée par le salarié aurait de ce seul fait la nature de dette professionnelle, contrairement aux allégations de l'employeur.
En effet, par arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a jugé, s'agissant du prêt consenti par un employeur à un salarié et à son conjoint afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier, d'une part que l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs », au sens de cette disposition, d'autre part que l'article 2, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens que ladite entreprise doit être considérée comme un « professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale.
Il en résulte que la dette contractée par un salarié vis-à-vis d'un employeur n'a pas la qualité de dette professionnelle mais de dette non professionnelle, et que les règles relatives aux droits de la consommation s'appliquent dans le cadre des prêts consentis par un employeur à ses salariés, peu important que l'employeur n'ait pas la qualité d'organisme de crédit, lequel employeur doit malgré cela être considéré comme professionnel au sens des dispositions dudit droit de la consommation (Cour de cassation, Civ. 1ère, 5 juin 2019, n° 16-12.519).
En considération de ces constatations, la dette contractée par le salarié vis-à-vis de la SAS STC, son employeur, dans le cadre du contrat de prêt du 13 novembre 2015, n'a pas la nature de dette professionnelle.
Par jugement du 3 octobre 2017, dont le salarié verse une copie aux débats, le tribunal d'instance de Vienne a constaté que la situation de M. X., de bonne foi, était irrémédiablement compromise, et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X., lequel rétablissement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement audit jugement.
Il ressort du jugement du 3 octobre 2017 que la SAS STC était partie à l'instance.
Il résulte de ces constatations que la dette contractée par M. X. à l'égard de la SAS STC dans le cadre de l'emprunt consenti par cette dernière le 13 novembre 2015 a été effacée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS STC de sa demande reconventionnelle formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la SAS STC à remettre à SAS STC un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.
La SAS STC, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Etat les sommes exposées par M. X. pour la défense en justice de ses intérêts, de sorte qu'il y a lieu de condamner la SAS STC au versement de la somme de 3.000 euros au conseil de M. X., Maître [B], sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordé à l'intimé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative au moyen tiré d'un non-respect des règles relatives au contrôle de la durée du travail,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS STC visant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. X. au titre du harcèlement moral,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. X. de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés non travaillés,
- Débouté la SAS STC de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 790 euros au titre du solde du prêt du 13 novembre 2015.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SAS STC a fait un usage illicite du dispositif de géolocalisation,
DIT que M. X. a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé,
CONDAMNE la SAS STC à payer à M. X. les sommes suivantes :
2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire,
2.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
1.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien,
3 068,25 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, outre 306,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
14 885,50 euros net à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé,
1 114,36 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la compensation obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires, outre 111,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1 039,75 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire au cours de l'arrêt de travail du 18 juin 2016,
3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour usage illicite du dispositif de géolocalisation du véhicule du salarié,
5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
CONDAMNE la SAS STC à remettre à M. X. un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DEBOUTE la SAS STC de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1 411,37 euros,
DEBOUTE la SAS STC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS STC à payer la somme de 3.000 euros au conseil de M. X., Me [E] [B], sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordé à l'intimé,
CONDAMNE la SAS STC aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,