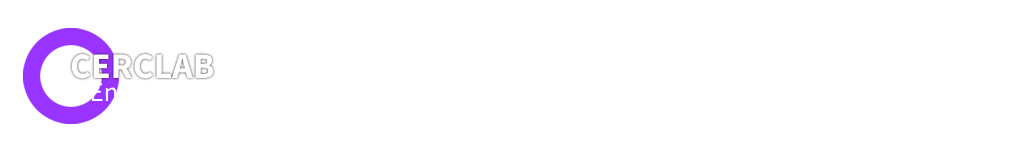CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 7 mars 2024
CERCLAB - DOCUMENT N° 10840
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-6), 7 mars 2024 : RG n° 22/06240
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Se prévalant de la recevabilité de leur demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la clause pénale stipulée à l'article II-5 du contrat en ce qu'elle tend aux mêmes fins que leur demande de débouté formulée en première instance, ils font valoir qu'entre professionnels et consommateurs sont réputées non écrites les clauses dites abusives qui « créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » et se fondent sur l'article R. 132-2 (devenu R. 212-2) du code de la consommation repris à l'article 1171 (nouveau) du code civil selon lequel : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause (à compter du 1er octobre 2018) ' non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties », qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » Et pour démontrer cette disproportion manifeste dans le contrat de prêt en cause qu'ils qualifient de « contrat d'adhésion », ils soutiennent que la condamnation prononcée est « extrêmement excessive », calculant, d'une part, qu'au 9 septembre 2022, ils seraient redevables d'une somme totale de 99.229,16 euros, soit le cumul du capital de 60.139,16 euros emprunté, selon un prêt dont ils n'ont pas compris les termes, et la somme de 39.090 euros au titre des intérêts, évoquant, d'autre part, le préjudice (non caractérisé) subi en regard par la société Créatis du fait du retard de paiement des échéances.
Mais il convient de considérer que, succédant à l'introduction de dispositions spécifiques régissant le droit des contrats spéciaux et à des créations prétoriennes (s'agissant de clauses pré-rédigées dans des contrats de consommation de masse dans le domaine, en particulier, de l'assurance, du transport, de la fourniture d'eau ou d'électricité ou encore des clauses limitatives de responsabilité), la réforme du droit des obligations et des contrats de 2016 a précisément défini les contours des différents types de contrats, distinguant notamment, à l'article 1110 du code civil le contrat de gré à gré (à savoir : « celui dont les stipulations sont librement négociées par les parties » et le contrat d'adhésion (à savoir : « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par les parties »).
En l'espèce, les époux X. contestent la validité de l'article II-5 du contrat intitulé « intérêts de retard' qui stipule :'les intérêts de retard sont calculés au taux contractuel majoré de quatre points sur les échéances impayées et les sommes dues en application de l'article 3 ci-dessus, à compter, en cas d'impayé, du jour de l'échéance concernée et sur le capital restant dû à compter du jour de la déchéance du terme, ceci sans délai, tout mois commencé étant dû ».
Mais l'article 1171 dont ils se prévalent ne tend pas à sanctionner la lésion ou à corriger un déséquilibre entre la prestation du contrat et son prix mais à annihiler les clauses accessoires non négociables susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Et la société Créatis est fondée à leur opposer le fait qu'ils avaient la liberté de conclure un prêt avec un taux plus favorable, ce qu'ils n'ont pas fait, dès lors que cette stipulation ressortait de la libre négociation des parties, les époux X. ayant accepté l'offre de prêt de restructuration au taux nominal de 6,90 %, susceptible de majoration en cas de retard, qui était soumise à leur appréciation et à leur libre arbitre. Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point. »
2/ « Il convient, en revanche, de rappeler que l'établissement de crédit souscripteur d'assurance de groupe est tenu à l'égard de son client emprunteur, adhérant à cette assurance, de satisfaire à une double obligation. Il lui appartient d'abord de l'informer sur l'objet du contrat et les caractéristiques du produit et il peut être considéré que la société Créatis y a satisfait en remettant aux époux X. la notice d'information qu'ils ne contestent pas avoir reçue. Mais cette simple remise ne suffit pas et pèse sur l'établissement de crédit souscripteur, et non point sur l'assureur de groupe, un devoir de conseil qui doit le conduire à éclairer son client, à attirer son attention sur la couverture et l'opportunité de la garantie en regard de sa situation personnelle de sorte que les risques couverts soient en adéquation avec celle-ci.
En l'espèce, si l'article 9.2.3.2 contient une information concernant le taux d'invalidité, à savoir qu'il procède de la combinaison du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité physique ou mentale, la seule explication relative à cette incapacité fonctionnelle ressort de l'indication figurant dans la notice d'information selon laquelle « elle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (barème du concours médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard ».
Cette information essentielle sur l'incapacité professionnelle dès lors qu'elle permettait de déterminer le taux d'invalidité ouvrant droit à la garantie méritait une définition que ne contient pas la notice, comme le soutiennent les intimés, et la société Créatis ne démontre ni même ne soutient qu'elle les a éclairés sur ce point en attirant leur attention sur l'intérêt que pouvait présenter la garantie dans une situation raisonnablement prévisible compte tenu de leurs âges ou du secteur d'activité dans lequel ils exerçaient leurs professions qui exigeaient des capacités physiques, les époux X. précisant notamment sur ce dernier point (§ 4/54 de leurs conclusions) qu'en raison de leur commune qualité de gardiens d'immeuble et de la spécificité de cette profession, le licenciement de l'épouse a malheureusement eu pour effet d'entraîner celui de l'époux. Il en résulte que les époux X. sont fondés à lui faire grief d'avoir failli à son devoir de conseil, comme retenu par le tribunal. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-6
ARRÊT DU 7 MARS 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/06240 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOXO. CONTRADICTOIRE. Code nac : 53B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES : RG n° 20/06370.
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA CREATIS
N° Siret : XXX (RCS Lille Métropole), [Adresse 5], [Localité 4], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 - Représentant : SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 8], [Adresse 1], [Localité 6]
Madame Y. épouse X.
née le [Date naissance 3] à [Localité 7], de nationalité Française, [Adresse 1], [Localité 6]
Représentant : Maître Olivier DEMANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, substitué par Maître Louise HASER, avocat au barreau de VERSAILLES
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'offre de prêt personnel de restructuration consenti par la société Créatis et acceptée le 26 février 2010 par les époux X. portant sur une somme de 80.600 euros, moyennant un taux nominal de 6,90 % (majoré de quatre points en présence d'intérêts de retard) et remboursable en 182 mensualités,
Vu, en garantie du remboursement de ce prêt, l'adhésion des époux X. au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Créatis auprès de la société Serenis Vie, assureur, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ACM,
Vu, à la suite de l'accident de travail de madame X. (gardienne d'immeuble) survenu le 1er mars 2012, la prise en charge des échéances du prêt par l'assureur au titre de la garantie incapacité totale de travail, ceci jusqu'à la date du 25 octobre 2015, puis, après son licenciement en janvier 2016 pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement et évaluation médicale de son taux d'invalidité, le refus de prise en charge de ce dernier sinistre au titre de la garantie invalidité totale de travail souscrite que lui a notifié la société Créatis, au nom de la société Serenis Vie, le 27 juin 2016, ceci du fait que la combinaison, contractuellement prévue, des deux taux fixés par le médecin conseil ne permettait pas d'établir un taux d'invalidité suffisant pour ce faire,
Vu la déchéance du terme prononcée par la société Créatis et notifiée aux époux X. par pli recommandé du 5 jui1let 2016, en application des dispositions contractuelles, et la mise en demeure de lui régler la somme de 58.838,61euros restée lettre morte,
Vu l'assignation en paiement de sa créance (évaluée à 60.139,16 euros) délivrée le 29 mars 2017 par la société Créatis aux époux X. puis l'assignation en intervention forcée délivrée le 17 novembre 2017 à l'assureur, à la requête des époux X.,
Vu, après jonction de ces deux procédures, le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a débouté les époux X. de leurs demandes formulées sur le fondement des clauses abusives et sur celui des manquements aux obligations d'information et de mise en garde, ordonné, avant dire droit, une expertise médicale notamment destinée à permettre de déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de madame [P] ainsi que celui de son incapacité professionnelle et sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport en retirant l'affaire du rôle du tribunal,
Vu le rapport déposé le 29 juillet 2019 par l'expert mandaté évaluant à 35% son taux d'incapacité fonctionnelle et à 100 % son taux d'incapacité professionnelle,
Vu, sur appel du jugement mixte précité interjeté par les époux X., l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la troisième chambre de la cour d'appel de Versailles (RG 19/03738) confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejetant la fin de non-recevoir présentée par l'assureur tirée de la nouveauté en cause d'appel de la demande de réparation du préjudice moral, condamnant la société Créatis à payer aux époux X. les sommes de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral (du fait de la défaillance de celle-ci en ce qu'elle ne les a pas mis « en mesure d'appréhender la portée réelle de la garantie offerte et de comprendre concrètement que même en cas d'invalidité professionnelle totale, seules de graves incapacités correspondant à de lourdes lésions pouvaient aboutir à une prise en charge » générant une inquiétude à sa découverte), outre celle de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en lui faisant supporter les dépens, et enfin rejetant toute autre demande (à savoir : le caractère abusif d'une clause des conditions générales du contrat d'assurance et l'absence d'objet de ce contrat),
Vu, sur demande de réinscription au rôle du tribunal, le jugement contradictoire rendu le 09 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles qui a :
- condamné solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. à verser à la société Créatis, au titre du solde du prêt, la somme de 60.139,16 euros, avec intérêts au taux de 10,90 % l'an, à compter du 5 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- déclaré recevable la demande en dommages et intérêts formée par monsieur X. et madame Y. épouse X.,
- condamné la société Créatis à verser à monsieur X. et madame Y. épouse X., en réparation de leur préjudice financier, la somme de 30.069, 58 euros,
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par monsieur X. et madame Y. épouse X.,
- condamné in solidum monsieur X. et madame Y. épouse X. aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Virginie Sandrin, avocat postulant,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Vu l'appel à l'encontre de ce dernier jugement interjeté par la société Créatis contre les seuls époux X., selon déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2022,
[*]
Vu les dernières conclusions (n° 2) notifiées le 4 juillet 2023 par la société anonyme Créatis demandant à la cour :
- de déclarer monsieur X. et madame Y. épouse X. mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
- de déclarer la SA Créatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. à verser à la société Créatis la somme de 60.139,16 euros avec intérêts au taux de 10,90 % l'an à compter du 5 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Créatis à payer monsieur X. et madame Y. épouse X. la somme de 30.069,58 euros en réparation de leur préjudice financier,
Statuant à nouveau
- de débouter monsieur X. et madame Y. épouse X. de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
- si la cour estimait que la SA Créatis avait manqué à son devoir d'information de fixer l'indemnisation de monsieur X. et madame Y. épouse X. à la somme maximale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant
- de condamner solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. à payer à la SA Créatis la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du « CPC »,
- de condamner solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. aux entiers dépens de première instance et d'appel,
[*]
Vu les dernières conclusions notifiées le 07 avril 2023 par monsieur X. et madame Y., son épouse, qui prient la cour, au visa des articles 1355, 1147, 1244-1, 1152, 1231 du code civil applicables au moment des faits, 565 du code de procédure civile et l'ancien article R 132-2 du code de la consommation, applicable au moment des faits :
- de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a déclaré recevable la demande en dommages et intérêts formée par monsieur X. et madame Y. épouse X.,
- d'infirmer « le jugement de la cour d'appel de Versailles' (sic) en ce qu'i1 a : condamné solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. à verser à la société Créatis, au titre du solde du prêt, la somme de 60.139,16 euros, avec intérêts au taux de 10,90 % l'an à compter du 5 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement // condamné la société Créatis à (leur) verser, en réparation de leur préjudice financier, la somme de 30.069,58 rejeté la demande de délais de paiement présentée par monsieur X. et madame Y. épouse X. // condamné in solidum monsieur X. et madame Y. épouse X. aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction (...) // dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
à titre principal
- de débouter la société Créatis de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire si la cour d’appel devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux X.
- de juger non écrite la clause pénale prévoyant le paiement de l'intérêt conventionnel au taux de 10,90 %, à compter du 5 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- de juger que les époux X. disposent d'un délai de paiement sur une durée de 24 mois pour régler les sommes auxquelles ils seraient condamnés,
à titre infiniment subsidiaire si la cour d'appel retenait la condamnation des époux X. aux intérêts conventionnels,
- de juger que l'intérêt conventionnel au taux de 10,90 %, à compter du 5 juillet 2016 et jusqu'à parfait paiement, est excessif et en conséquence doit être diminué,
à titre reconventionnel et en toute hypothèse
- de condamner la société Créatis à verser aux époux X. la somme de 60.139,16 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice financier subi par ces derniers,
- de débouter1a société Créatis de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Créatis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Créatis aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance de la société Créatis :
Il y a lieu de rappeler que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 1134 (ancien) du code civil, a d'abord jugé que le prêt personnel en cause n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du crédit à la consommation et, partant, que ses stipulations n'étaient pas soumises aux dispositions des articles L. 311-30 et L. 311-31 du code de la consommation.
En application des articles II-3 et II-5 du contrat (portant sur la déchéance du terme, sur une clause pénale ainsi que sur les intérêts de retard) et en contemplation d'un historique de compte, d'un décompte de la créance (non contesté par les débiteurs) et des pièces relatives à la déchéance du terme, il a fait droit à la demande en paiement de la société Créatis.
Tandis que cette dernière poursuit la confirmation du jugement sur ce point, les époux X. intimés présentent successivement, sur appel incident, différents moyens de contestation.
Sur la validité de la clause prévoyant des intérêts conventionnels :
Se prévalant de la recevabilité de leur demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la clause pénale stipulée à l'article II-5 du contrat en ce qu'elle tend aux mêmes fins que leur demande de débouté formulée en première instance, ils font valoir qu'entre professionnels et consommateurs sont réputées non écrites les clauses dites abusives qui 'créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties' et se fondent sur l'article R. 132-2 (devenu R. 212-2) du code de la consommation repris à l'article 1171 (nouveau) du code civil selon lequel:
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause (à compter du 1er octobre 2018) ' non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties », qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Et pour démontrer cette disproportion manifeste dans le contrat de prêt en cause qu'ils qualifient de « contrat d'adhésion », ils soutiennent que la condamnation prononcée est « extrêmement excessive », calculant, d'une part, qu'au 9 septembre 2022, ils seraient redevables d'une somme totale de 99.229,16 euros, soit le cumul du capital de 60.139,16 euros emprunté, selon un prêt dont ils n'ont pas compris les termes, et la somme de 39.090 euros au titre des intérêts, évoquant, d'autre part, le préjudice (non caractérisé) subi en regard par la société Créatis du fait du retard de paiement des échéances.
Mais il convient de considérer que, succédant à l'introduction de dispositions spécifiques régissant le droit des contrats spéciaux et à des créations prétoriennes (s'agissant de clauses pré-rédigées dans des contrats de consommation de masse dans le domaine, en particulier, de l'assurance, du transport, de la fourniture d'eau ou d'électricité ou encore des clauses limitatives de responsabilité), la réforme du droit des obligations et des contrats de 2016 a précisément défini les contours des différents types de contrats, distinguant notamment, à l'article 1110 du code civil le contrat de gré à gré (à savoir : « celui dont les stipulations sont librement négociées par les parties » et le contrat d'adhésion (à savoir : « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par les parties »).
En l'espèce, les époux X. contestent la validité de l'article II-5 du contrat intitulé « intérêts de retard' qui stipule :'les intérêts de retard sont calculés au taux contractuel majoré de quatre points sur les échéances impayées et les sommes dues en application de l'article 3 ci-dessus, à compter, en cas d'impayé, du jour de l'échéance concernée et sur le capital restant dû à compter du jour de la déchéance du terme, ceci sans délai, tout mois commencé étant dû ».
Mais l'article 1171 dont ils se prévalent ne tend pas à sanctionner la lésion ou à corriger un déséquilibre entre la prestation du contrat et son prix mais à annihiler les clauses accessoires non négociables susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Et la société Créatis est fondée à leur opposer le fait qu'ils avaient la liberté de conclure un prêt avec un taux plus favorable, ce qu'ils n'ont pas fait, dès lors que cette stipulation ressortait de la libre négociation des parties, les époux X. ayant accepté l'offre de prêt de restructuration au taux nominal de 6,90 %, susceptible de majoration en cas de retard, qui était soumise à leur appréciation et à leur libre arbitre.
Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Subsidiairement et sur le fondement de l'article 1244-1 (devenu 1343-5) du code civil, les intimés demandent à nouveau à pouvoir disposer d'un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette.
Ils invoquent le caractère « astronomique » des sommes réclamées, l'incapacité de travail de l'épouse outre le fait que la société Créatis ne leur a pas versé la somme de 6.000 euros au paiement de laquelle la cour d'appel l'a condamnée dans l'arrêt susvisé.
Mais il convient de considérer qu'ils disposent d'un titre exécutoire pour obtenir le paiement de cette dernière somme et que cette circonstance n'entrent pas dans les critères d'appréciation de la demande en cause, qu'ils ont en outre disposé de facto de plus de sept années de délais pour s'acquitter de leur dette depuis la mise en demeure reçue en 2016 et qu'ils laissent sans réponse le motif pertinent des premiers juges énonçant qu'ils n'allèguent ni ne démontrent que leur situation financière leur permet de régler le montant des sommes dues dans le délai de 24 mois.
De sorte que mérite confirmation le jugement qui les déboute de cette demande.
Sur la demande de modération de « l'intérêt conventionnel au taux de 10,90 % » :
Plus subsidiairement et visant « la clause pénale visée à l'article II-5 du contrat » (sus-repris) ils reprennent leur argumentation précédente pour en critiquer le caractère manifestement excessif comme pour souligner la disproportion au regard de la situation des deux parties et sollicitent l'application de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil.
La société Créatis rétorque que les époux X. ont bénéficié de la somme de 80.600 euros qui était destinée à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursables au taux effectif global de 8,86 % l'an, qu'elle a accepté leur demande dans ce sens et que le prêt consenti en 2016 leur a permis de bénéficier de mensualités moins importantes.
Ceci étant exposé, la clause pénale qui a un caractère coercitif pouvant se définir comme une clause fixant forfaitairement et par avance une indemnité en cas d'inexécution totale ou partielle des obligations convenues, la cour, en présence de formulations imprécises, en déduit qu'elle se trouve saisie d'une demande de modération de la majoration de 4 % stipulée qui s'analyse, compte tenu de ses caractéristiques, en une clause pénale.
Cela étant, il est constant que le caractère manifestement excessif d'une telle clause ne peut s'apprécier en fonction de la position économique du débiteur et de sa bonne foi mais en regard des peines habituellement pratiquées, ce que les époux X. s'abstiennent de démontrer, voire d'invoquer.
Ayant emprunté la somme de 80.600 euros en février 2010 et redevables de la somme de 58.838,61 euros en juillet 2016 ils ne peuvent se prévaloir de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré à la société Créatis, les intérêts moratoires convenus, dont l'excès évident n'est pas établi, ayant vocation à indemniser le non-respect du délai de paiement.
Cette autre demande ne peut prospérer.
Il s'évince de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en sa condamnation des époux X. au paiement du principal et des intérêts au taux de 10,90 %.
Sur la demande indemnitaire des emprunteurs en réparation de leur préjudice financier :
Alors que la société Créatis appelante poursuit l'infirmation du jugement sur ce point et le « débouté » des époux X. en leur demande indemnitaire en se prévalant, pour ce faire, de l'autorité de la chose jugée, de l'absence de manquement au devoir de mise en garde ainsi que d'un préjudice financier et d'une perte de chance qui ne sont que prétendus, les intimés, qui dénient toute autorité de chose jugée et excipent d'un manquement de la société Créatis à son obligation d'information et à son devoir de conseil, se prévalent d'une perte de chance totale devant conduire la cour à condamner la société Créatis à réparer intégralement leur préjudice économique.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Saisi de ce moyen, le tribunal a déclaré « recevable » la demande indemnitaire des époux X. en se fondant sur les dispositions de l'article 1351 du code civil et sur la doctrine de la Cour de cassation (Cass, ass. plén., 9 juin 1978, pourvoi n° 76-10591, publié au bulletin) ayant constaté qu'une nouvelle action tendait « à la réparation d'un élément de préjudice sur lequel il n'avait pu être statué puisqu'il n'avait pas été inclus dans la demande initiale » et énonçant que « l'autorité de la chose jugée (...) ne pouvait être opposée à une action ayant un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement ».
Factuellement, il a analysé les éléments de la procédure pour juger que les époux X. ont formé une demande de prise en charge du remboursement du prêt à l'encontre de l'assureur qui ne pouvait s'assimiler à une demande indemnitaire en réparation de leur préjudice et, à l'encontre de Créatis, qu'ils n'ont formé en cause d'appel qu'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral, la demande de réparation de leur préjudice financier n'ayant jamais été tranchée.
Visant les articles 480, 482, 483 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l'appelante soutient qu'ils doivent être 'déboutés' de leur action indemnitaire du fait qu'il a été retenu qu'elle avait bien remis aux époux X. une notice d'information sur l'assurance et qu'ils ont bien reçu l'information contractuelle préalablement à la conclusion du contrat mais que la cour d'appel, selon un arrêt devenu définitif et qui a autorité de chose jugée, l'a condamnée à réparer leur préjudice moral (à hauteur de 3.000 euros) du fait que l'information fournie n'était pas compréhensible.
Peu importe, selon l'appelante, que la nature des dommages-intérêts ait changé et il est faux de prétendre, comme le font les intimés, que la cour d'appel précédemment saisie leur ait implicitement suggéré de formuler une demande au titre de leur préjudice financier.
Ceci étant exposé, il convient de considérer que 'la chose jugée' figure au rang des fins de non-recevoir ressortant de l'article 122 du code de procédure civile.
Il s'agit, par conséquent, d'un 'moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond'.
Etant rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif' et relevé, au cas présent, que la société Créatis ne demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, que de déclarer les époux X. 'mal fondés » en leurs prétentions et de les en « débouter » (autrement dit, selon le dictionnaire juridique de [F] [M], de juger que recevables, elles ne se trouvent pas fondées), il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point, étant ajouté que si le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance, tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, le jugement mixte et l'arrêt précédemment rendus ont statué avant qu'il ne soit statué en ouverture du rapport d'expertise judiciaire dont il résultait l'exclusion de la mise en œuvre de la garantie, son impossible mobilisation donnant naissance au préjudice financier dont le tribunal a été saisi après réinscription de l'affaire.
Il peut être ajouté qu'il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Sur les obligations du prêteur-souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe à l'égard de l'emprunteur y adhérant.
Pour se dédouaner de tout manquement à ce qu'elle qualifie de devoir de mise en garde, la société Créatis, s'appuyant sur le montant des revenus cumulés des emprunteurs résultant de la « fiche de dialogue » étayée par des justificatifs fournis (soit la somme mensuelle de 3.382,86 euros) et le montant des mensualités de l'emprunt destiné à regrouper des créances (soit : 1.000,66 euros), affirme d'abord qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir satisfait à ce devoir en l'absence de risque d'endettement excessif.
Elle fait ensuite valoir que si le devoir de mise en garde du banquier s'étend à l'adéquation de l'assurance à la situation de l'emprunteur et l'oblige à éclairer son client sur ce point, il ressort de l'arrêt précédemment rendu que les époux X. ont « reconnu avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L 1221-2-1 III du code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information 41.33.84 (12/2009) » qu'elle produit en pièce n° 2.
Elle observe que cette notice (en son point 9 relatif aux garanties) contient deux formules précisément décrites, s'interrogeant sur la manière concrète dont elle pourrait mieux informer les emprunteurs et objecte que les intimés n'ont jamais apporté la preuve qu'ils auraient souhaité ou pu souscrire un contrat d'assurance plus protecteur.
Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce que, retenant une perte de chance de 50%, il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au montant de 30.069,58 euros.
Les époux X. rétorquent que l'article 9.2.3.2 de la notice intitulé 'détermination du taux d'invalidité' indique bien que le taux d'invalidité retenu pour l'application de la garantie résulte de la combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et de celui de l'incapacité professionnelle mais qu'à aucun moment il n'est indiqué ce que sont « l'incapacité fonctionnelle », « physique ou mentale » et « l'incapacité professionnelle ».
Ils s'approprient la motivation de la cour d'appel développée dans son arrêt rendu le 29 octobre 2020 accueillant, par motifs sus-repris, leur demande de réparation de leur préjudice moral pour soutenir que cette clause et les suivantes des conditions générales qui ouvraient droit à la prise en charge de l'assureur n'étaient pas rédigées de manière claire et compréhensible, n'ayant de sens que pour les seuls et rares initiés, non point pour un consommateur moyen, de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de connaître ce que recouvre l'incapacité professionnelle et, par voie de conséquence, le taux d'invalidité.
Ils concluent à la violation de l'obligation d'information et de conseil dont était débitrice la société Créatis, comme en a jugé le tribunal.
Ceci étant exposé, il échet de relever qu'il n'est pas reproché à la société Créatis d'avoir failli à son devoir de mise en garde sur un endettement excessif et, au demeurant, de rappeler que « le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt », comme a pu en juger la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-18854, publié au bulletin), de sorte que l'appelante consacre à cette question de vains développements.
Il convient, en revanche, de rappeler que l'établissement de crédit souscripteur d'assurance de groupe est tenu à l'égard de son client emprunteur, adhérant à cette assurance, de satisfaire à une double obligation.
Il lui appartient d'abord de l'informer sur l'objet du contrat et les caractéristiques du produit et il peut être considéré que la société Créatis y a satisfait en remettant aux époux X. la notice d'information qu'ils ne contestent pas avoir reçue.
Mais cette simple remise ne suffit pas et pèse sur l'établissement de crédit souscripteur, et non point sur l'assureur de groupe, un devoir de conseil qui doit le conduire à éclairer son client, à attirer son attention sur la couverture et l'opportunité de la garantie en regard de sa situation personnelle de sorte que les risques couverts soient en adéquation avec celle-ci.
En l'espèce, si l'article 9.2.3.2 contient une information concernant le taux d'invalidité, à savoir qu'il procède de la combinaison du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité physique ou mentale, la seule explication relative à cette incapacité fonctionnelle ressort de l'indication figurant dans la notice d'information selon laquelle « elle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (barème du concours médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard ».
Cette information essentielle sur l'incapacité professionnelle dès lors qu'elle permettait de déterminer le taux d'invalidité ouvrant droit à la garantie méritait une définition que ne contient pas la notice, comme le soutiennent les intimés, et la société Créatis ne démontre ni même ne soutient qu'elle les a éclairés sur ce point en attirant leur attention sur l'intérêt que pouvait présenter la garantie dans une situation raisonnablement prévisible compte tenu de leurs âges ou du secteur d'activité dans lequel ils exerçaient leurs professions qui exigeaient des capacités physiques, les époux X. précisant notamment sur ce dernier point (§ 4/54 de leurs conclusions) qu'en raison de leur commune qualité de gardiens d'immeuble et de la spécificité de cette profession, le licenciement de l'épouse a malheureusement eu pour effet d'entraîner celui de l'époux.
Il en résulte que les époux X. sont fondés à lui faire grief d'avoir failli à son devoir de conseil, comme retenu par le tribunal.
Ils peuvent, par conséquent, prétendre à la réparation de leur préjudice qui s'analyse en la perte de chance de contracter une assurance mieux adaptée à leur situation personnelle, étant ajouté, afin de répondre à la société Créatis, que « toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d'une perte de chance raisonnable », comme cela résulte de récentes décisions de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 20 mai 2020, pourvoi n° 18-25440 // 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-13670, publiés au bulletin).
Sur la réparation du préjudice financier subi :
Sur appel incident les époux X. poursuivent la réformation du jugement quant à l'évaluation de la perte de chance retenue, faisant valoir que la réparation du préjudice économique résultant d'un défaut d'information et de conseil de la part d'un établissement bancaire est intégrale, et estimant, en se réclamant de décisions de la Cour de cassation, que leur perte de chance n'est aucunement hypothétique mais certaine si bien qu'elle doit être réparée intégralement.
Ils font valoir que ce défaut d'information et de conseil a eu pour conséquence de les priver du bénéfice d'une prise en charge des échéances du prêt restant à courir ou de renoncer à leur projet d'emprunt qui s'avérait risqué au vu des garanties souscrites et sollicitent, sur la base d'une perte de chance évaluée à 100 %, l'allocation d'une somme indemnitaire de 60.139,16 euros.
Pour affirmer que ne sont que prétendus leur préjudice financier (qui nécessite la démonstration de l'existence d'un dommage certain) et leur perte de chance (qui suppose un certain degré d'incertitude), la société Créatis, poursuivant principalement le débouté des époux [P] et subsidiairement la fixation d'une indemnité à une somme maximum de 3.000 euros sanctionnant le manquement au devoir de conseil, leur rétorque qu'en tout état de cause ils ne peuvent prétendre à l'évaluation de leur préjudice à hauteur de la somme de 60.139,16 euros.
Elle rappelle qu'elle a été condamnée par la cour d'appel de Versailles au paiement de la somme de 3.000 euros réparation du préjudice moral subi résultant de l'inquiétude ressentie lorsqu'ils ont découvert la portée de leur garantie, en en déduisant que la cour a ainsi décidé de rejeter le préjudice de perte de chance.
Et elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, l'établissement de crédit n'étant tenu qu'à une obligation d'information consistant en la description du crédit proposé mais non point à une obligation de conseiller ou de déconseiller quant à la pertinence ou l'opportunité de recourir à l'opération de crédit, ceci du fait de son devoir de non-ingérence ; y ajoutant, elle renvoie la cour à ses explications relatives à l'absence de risque d'endettement excessif.
Elle oppose enfin aux époux X. leur absence de production de contrats d'assurance qui leur auraient permis de bénéficier d'une protection plus importante.
Ceci étant relaté, est dénuée de pertinence, compte tenu de la motivation qui précède, l'argumentation de la société Créatis relative à l'absence de devoir de conseil du dispensateur de crédit dans le cadre du prêt qu'il consent et non point (ce qui est le seul objet du litige) en sa qualité de souscripteur à une assurance de groupe, comme l'est celle relative à la nécessité, pour l'adhérent à cette assurance, de prouver que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
La cour précédemment saisie de l'appel à l'encontre du premier jugement n'a nullement énoncé que le préjudice des époux X. devait être cantonné à la réparation de leur préjudice moral mais simplement jugé (page 13/15 de l'arrêt sus-visé) que les griefs des époux [P] n'étaient dirigés que contre l'assureur sans demande indemnitaire à l'encontre de Créatis autre que celle au titre de leur préjudice moral.
S'agissant de l'évaluation de la perte de chance correspondant à l'intégralité de la perte subie, telle qu'évaluée par les époux X. à l'aune de la condamnation poursuivie dans l'assignation, il peut être rappelé que celle-ci peut être définie comme la disparition actuelle et certaine d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
La perte de chance d'échapper à un risque qui s'est finalement réalisé suppose donc l'existence d'une incertitude quant à la prise d'une décision plus judicieuse par le créancier de l'obligation d'information et de conseil s'il avait été mieux informé et conseillé.
Tel est le cas en la présente espèce dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut d'information et de conseil n'est pas la seule cause du dommage qui s'est finalement réalisé.
De sorte qu'au soutien de leur demande de réparation intégrale de leur préjudice correspondant à l'avantage perdu les époux X. ne peuvent solliciter la transposition d'une jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 3ème, 02 février 2022, pourvoi n° 21-10205, non publié au bulletin) qui, en présence d'éléments factuels permettant de retenir la certitude d'un lien causal entre le manquement et le préjudice subi (à savoir : la présentation 'd'un projet comme dénué de tout risque, avec la sécurité de loyers garantis pendant une durée irrévocable de neuf ans, sans comporter la moindre réserve sur les risques liés à l'éventuelle défaillance du preneur à bail'), énonce (§9 de l'arrêt) :
'ayant ainsi exclu toute incertitude sur la décision des acquéreurs s'ils avaient été dûment informés des aléas et risques éventuels de l'opération d'investissement immobilier proposée, (la cour d'appel) en a exactement déduit que le préjudice causé par le manquement de la société Lagrange à son devoir d'information et de conseil ne pouvait consister en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et correspondait à l'intégralité de la perte de loyers subie'.
Seule donne lieu, ici, à réparation la perte de chance de ne pas adhérer à l'assurance de groupe proposée ou de mieux souscrire qui doit être mesurée à la chance perdue.
Force est de considérer, sur la question de l'évaluation à 50% de la perte de chance par le tribunal, qu'il a pris en considération l'âge de madame X. lors de l'adhésion au contrat d'assurance (soit : 39 ans), son emploi de gardienne d'immeuble selon un contrat à durée indéterminée, la possibilité qui était la sienne d'adhérer à un contrat plus protecteur mais aussi nécessairement plus onéreux et que les parties s'abstiennent de critiquer les critères d'appréciation ainsi exposés et au demeurant pertinents.
Si bien que le jugement sera confirmé tant en ce qu'il retient l'existence d'une perte de chance qu'en ce qu'il en évalue le quantum à 50% et chiffre le préjudice à la somme de 30.069,58 euros (soit : 60.139,16 euros / 2).
Sur les frais non compris dans les dépens et les dépens :
La succombance partielle des parties en cause d'appel conduit à considérer qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune la charge de ses propres frais inhérents à la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
Et chacune supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel sans qu'il y ait lieu à infirmation du jugement quant à la condamnation des époux X. aux dépens de première instance incluant les frais de l'expertise médicale ordonnée, destinée à permettre de trancher la question de l'éventuelle mobilisation de la garantie à leur profit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,