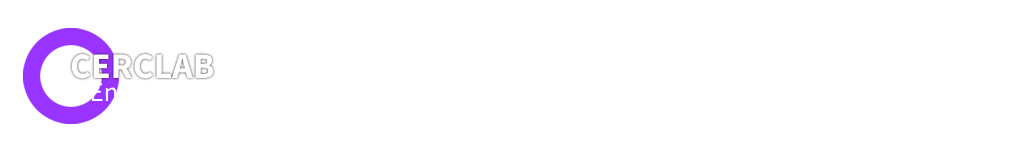CASS. SOC., 23 septembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 5200
CASS. SOC., 23 septembre 2014 : pourvoi n° 13-15111 ; arrêt n° 1577
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, l’arrêt retient que cette clause était limitée dans le temps, sa durée étant fixée à six mois, renouvelable une fois ; qu’elle comportait pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice égale à un maximum de six mois de salaire, prime et rémunération de toute nature ; qu’une telle clause était licite ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que l’employeur se réservait la faculté d’étendre la portée de la clause de non-concurrence dans le temps, d’autre part, que le montant de la contrepartie financière n’était pas déterminé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-15111. Arrêt n° 1577.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Karl Storz endoscopie France
Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président. SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 1er septembre 2008 en qualité d’ingénieur technico-commercial par la société Karl Storz endoscopie France ; que par lettre du 23 février 2010, il a donné sa démission en invoquant différents griefs à l’encontre de son employeur ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la rémunération variable du salarié dépend d’objectifs à atteindre, l’employeur ne peut fixer des objectifs irréalistes et incompatibles avec le marché ; que M. X. a fait valoir d’une part que les objectifs qui lui avaient été impartis en 2009 étaient inaccessibles et irréalistes compte tenu de l’état du marché et des effets de la crise mondiale, en précisant qu’aucun autre commercial n’avait atteint les objectifs fixés par l’employeur et, d’autre part, qu’en 2010, l’employeur avait encore augmenté ses objectifs de 35 % ; que la cour d’appel, qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants sans rechercher si les objectifs fixés en 2009 et 2010 étaient réalistes et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ que M. X. s’est notamment prévalu d’irrégularités commises en octobre et novembre 2009 par l’employeur en démontrant que les chiffres annoncés par ce dernier concernant les commandes régularisées par le salarié étaient incohérents, des montants pourtant pris en considération par l’employeur disparaissant subitement sans aucune explication ; que la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d’acte de rupture ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces griefs, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail ;
3°/ que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé ; que la cour d’appel, tout en constatant que le salarié n’avait bénéficié ni de la visite d’embauche, ni de la visite de reprise après l’arrêt de travail, a considéré que ces manquements n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’en rejetant les demandes du salarié par des motifs inopérants, alors que l’employeur n’avait fait passer au salarié ni la visite d’embauche, ni la visite de reprise après son arrêt de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 du code du travail, ainsi que l’article R. 4624-21 du code du travail (dans ses dispositions applicables en 2010) ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel, qui a estimé qu’il n’était pas établi que le salarié avait contesté la hauteur des objectifs à atteindre en 2009 et en 2010 ou que les produits commercialisés par la société étaient plus chers que ceux proposés par ses concurrents, a procédé à la recherche invoquée par la première branche ;
Et attendu que la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qui a estimé que le fait pour l’employeur de n’avoir fait passer au salarié ni visite médicale d’embauche ni visite de reprise ne caractérisait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, l’arrêt retient que cette clause était limitée dans le temps, sa durée étant fixée à six mois, renouvelable une fois ; qu’elle comportait pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice égale à un maximum de six mois de salaire, prime et rémunération de toute nature ; qu’une telle clause était licite ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que l’employeur se réservait la faculté d’étendre la portée de la clause de non-concurrence dans le temps, d’autre part, que le montant de la contrepartie financière n’était pas déterminé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société Karl Storz endoscopie France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Karl Storz endoscopie France et condamne celle-ci à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la prise d’acte de la rupture par M. X. produit les effets d’une démission, débouté M. X. de ses demandes tendant à voir dire et juger qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la SA KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE au paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de congés payés sur préavis, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour manquements de l’employeur à ses obligations pendant l’exécution du contrat de travail ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE compte tenu des termes du courrier du salarié en date du 23 février 2010, visant expressément une démission aux torts de l’employeur et énumérant un certain nombre de reproches à son encontre, il apparaît qu’il s’agit en fait d’une prise d’acte du salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ; il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du salarié, présentée pour la première fois devant la cour, sur ce point ; lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soient dans le cas contraire d’une démission ; il appartient au salarié de justifier des griefs qu’il allègue constituant des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur ; dans son courrier du 23 février 2010, le salarié dénonçait les pratiques suivantes qu’il reprend à l’appui de ses prétentions : le non-respect du contrat de travail et des conditions de rémunération : - à plusieurs reprises des chiffres d’affaires ont été décalés pour éviter de payer des commissions, - une pression accrue pour le faire partir avec rien ou peu de chose,- un avertissement supplémentaire du 19 décembre pour le moindre prétexte et pourtant non justifié, - la modification unilatérale de son secteur et à son insu, - tout cela aboutissant à une usure progressive et étant à l’origine ou au moins une des causes de ses problèmes de santé grave, - même pendant l’absence des humiliations publiques,- un dernier courrier augmentant les objectifs de + 35 % par rapport à 2009, - un objectif de 2009 déjà très important alors que sur le même secteur les produits de la marque sont vendus moins cher par les distributeurs français, découverte faite après embauche ; il ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de lui faire passer une visite d’embauche puis une visite de reprise après un arrêt de travail supérieur à 21 jours et enfin en l’ayant laissé travailler sans mesures de protection nécessaires compte tenu du matériel médical qu’il vendait ; s’agissant du non-respect du contrat de travail et des conditions de rémunération, outre un traitement annuel brut fixe de 33.000 euros, le salarié bénéficiait en outre, sous réserve que les objectifs soient atteints, d’un complément de 35.000 euros sous la forme d’une partie variable constituée de primes mensuelles, trimestrielles et annuelles basées sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs selon les éléments dont les détails faisaient l’objet d’une communication écrite actualisée au minimum chaque année ; le contrat prévoyait expressément que les objectifs mensuels trimestriels et ou annuels et le système d’intéressement seraient fixés par la direction et présentés au salarié ; le salarié soutient que les engagements de l’employeur s’agissant de sa rémunération étaient illusoires, les objectifs, unilatéralement fixées par lui étant irréalistes et augmentés de façon importante ; il souligne qu’alors qu’il avait quitté son emploi précédent, et donc, avec sa famille, la région où il exerçait avec tous les frais que cela a entraînés, sa rémunération s’est vue amputer de 50 % ; en l’espèce, l’employeur, qui au terme du contrat de travail fixait les objectifs à atteindre pour le salarié, justifie en versant les pièces correspondantes qu’il a transmis régulièrement au salarié les objectifs à atteindre ainsi que les résultats effectivement réalisés, sans que le salarié ne justifie avoir expressément contesté la faisabilité des objectifs ; indépendamment de l’augmentation des objectifs fixés, l’employeur justifie que pour 2008, le prédécesseur de M. X. avait atteint le chiffre de 1.044.380,23 euros, soit 68 % de ses objectifs alors même que pour 2009, le salarié a réalisé 546.362,00 euros soit 45 % de ses objectifs tels qu’ils avaient été fixés ; le fait que le salarié n’ait pas atteint ses objectifs en 2009 ne pouvait signifier que toute augmentation des objectifs ne pouvait intervenir pour l’année 2010, le salarié ne justifiant d’ailleurs pas que les produits qu’il proposait à la vente auraient été plus chers que ceux proposés par la concurrence ; le salarié ne justifie pas du manque de loyauté de l’employeur dans la fixation de sa rémunération alors même qu’il avait lui-même choisi de quitter l’emploi qu’il occupait précédemment, avec toutes les conséquences qui en découlaient ; il ne pouvait sérieusement méconnaître les conditions dans lesquelles il allait exercer ses fonctions ; le salarié ne justifie pas le fait qu’en septembre 2009, c’est en raison d’une volonté délibérée de l’employeur qu’une commande, qui aurait pu lui faire dépasser ses objectifs, n’avait pas été prise en compte alors même que le salarié a immédiatement alerté l’employeur et que la prise en compte pouvait en tout état de cause se faire rétroactivement ; s’agissant de la modification du secteur, intervenue début 2010, la répartition des secteurs géographiques, relevant du pouvoir de gestion et d’organisation de l’employeur, le salarié ne justifie pas que sa nouvelle affectation aurait modifié un élément substantiel de son contrat de travail alors même qu’il s’est certes vu retirer le département 77 mais s’est vu attribuer les départements 55, 52, 88, son secteur recouvrant donc le Grand-Est puisqu’il travaillait d’ores et déjà dans les départements 51, 02, 08 et 10 ; le fait qu’il ait appris semble-t-il par un collègue qui voulait anticiper le changement fin 2009, ne peut constituer une faute de la part de l’employeur ; le salarié ne justifie donc pas du non-respect du contrat de travail par l’employeur ou d’un défaut de loyauté de ce dernier dans son exécution ; s’agissant de la pression qu’il dit avoir subi pour partir dans de mauvaises conditions le salarié ne procède que par affirmations ; il ne justifie pas d’une mise à l’écart étant rappelé que le salarié a été en arrêt maladie du 16 décembre 2009 jusqu’au 14 février 2010 pour des problèmes lombaires sans doute liés à ses déplacements professionnels, en voiture mais dont il ne démontre pas qu’ils auraient pour origine une quelconque pression subie, étant rappelé qu’un contrôle, organisé comme en l’espèce dans le cadre réglementaire, de la réalité et du bien-fondé d’un arrêt de travail ne peut être considérée comme abusif ; le fait qu’il ait été convié à trois reprises entre le 3 novembre et le 10 décembre au siège de l’entreprise ne peut, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, être significatif d’un comportement fautif de l’employeur ; le courrier en date du 10 décembre 2009 aux termes duquel l’employeur attire l’attention du salarié sur un certain nombre de manquements dans l’exercice de ses fonctions (absence de suivi commercial dans un dossier, pas de réponse du service appels d’offres, absence de suivi administratif, défaut de réalisation d’objectifs), ne peut être considéré comme un avertissement mais constitue un rappel à l’ordre ; s’agissant de l’avertissement délivré par lettre recommandée le 18 décembre 2009, l’employeur reproche au salarié une absence de renseignement et de rapport de visites sur la base Endocontact, alors même que cela lui avait été notifié par oral et par écrit et que le service des appels d’offres attendait sa réponse à une relance du 11 décembre 2009 dans un appel d’offres CH de Lagny, ce que n’a pas contesté le salarié qui aujourd’hui ne donc pas prétendre à un avertissement injustifié et asseoir sa demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; à cet égard, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ; le salarié ne justifie pas plus qu’en son absence, l’employeur l’aurait humilié ; le constat d’huissier qu’il a fait établir au terme duquel il aurait reçu un SMS d’un collègue de travail lui indiquant qu’en janvier au cours d’une réunion de travail, son chef l’aurait bien pourri devant tout le monde, n’a aucune valeur probante faute de justifier de la réalité de l’envoi par ledit collègue, outre le fait que les termes employés sont parfaitement subjectifs ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE lorsque la rémunération variable du salarié dépend d’objectifs à atteindre, l’employeur ne peut fixer des objectifs irréalistes et incompatibles avec le marché ; que Monsieur X. a fait valoir d’une part que les objectifs qui lui avaient été impartis en 2009 étaient inaccessibles et irréalistes compte tenu de l’état du marché et des effets de la crise mondiale, en précisant qu’aucun autre commercial n’avait atteint les objectifs fixés par l’employeur et, d’autre part, qu’en 2010, l’employeur avait encore augmenté ses objectifs de 35 % ; que la cour d’appel, qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants sans rechercher si les objectifs fixés en 2009 et 2010 étaient réalistes et compatibles avec le marché, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
ALORS QUE Monsieur X. s’est notamment prévalu d’irrégularités commises en octobre et novembre 2009 par l’employeur en démontrant que les chiffres annoncés par ce dernier concernant les commandes régularisées par le salarié étaient incohérents, des montants pourtant pris en considération par l’employeur disparaissant subitement sans aucune explication ; que la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d’acte de rupture ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces griefs, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Et AUX MOTIFS QUE s’agissant du manquement grave de l’employeur à son obligation de résultat de sécurité, le salarié soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une visite d’embauche, qu’il n’a pas bénéficié d’une visite de reprise le lundi 15 février 2010 et enfin, que la société ne lui a pas remis un dosimètre alors même qu’il pouvait être exposé à des rayons très importants puisqu’il travaillait au moins à mi-temps en salle d’opération ; s’agissant de la nécessité d’être muni d’un dosimètre, le salarié ne justifie pas que son activité lui imposait d’être présent lors d’examens l’exposant à des rayons X ; il n’y faisait d’ailleurs pas allusion dans sa lettre de démission ; l’employeur justifie d’ailleurs que par une note du 20 juillet 2004, certes antérieure à l’embauche de M. X., l’employeur rappelait à toute la force de vente que sauf exception, une présence n’était pas nécessaire ; aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est dès lors avéré à cet égard ; s’agissant de la visite d’embauché, l’employeur ne conteste pas quelle n’a pas été effective ; l’employeur a dès lors manqué à ses obligations nées de l’article R. 4624-12 du code du travail ; s’agissant de la visite de reprise, aux termes de l’article R. 4621-22 du code du travail, elle devenait intervenir dans un délai de huit jours suivant la reprise soit avant le 23 février, date à laquelle le salarié a certes envoyé sa lettre de démission, sans toutefois que l’employeur ait pu le prévoir ; or ce dernier ne prétend pas avoir mis en place un rendez-vous pour la visite de reprise nécessaire ; il a de ce fait manqué à ses obligations ; ces deux manquements ont nécessairement causé au salarié un préjudice ; toutefois, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et ce d’autant qu’il appartenait au salarié de pallier la carence de l’employeur en provoquant lesdites visites ; faute pour lui d’avoir justifié de la part de l’employeur des manquements graves, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X. en date du 23 février 2010 doit produire les effets d’une démission ; le jugement étant infirmé en ce qu’il a statué sur ce point et M. X. débouté de ses prétentions en découlant ; le salarié sera en tant que de besoin condamné à restituer à la société les sommes versées au titre du jugement infirmé ; par contre, la SA Karl Storz Endoscopie France sera donc que condamnée à payer à M. X. la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite d’embauche et de reprise ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé ; que la cour d’appel, tout en constatant le salarié n’avait bénéficié ni de la visite d’embauche, ni de la visite de reprise après l’arrêt de travail, a considéré que ces manquements n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’en rejetant les demandes du salarié par des motifs inopérants, alors que l’employeur n’avait fait passer au salarié ni la visite d’embauche, ni la visite de reprise après son arrêt de travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 du code du travail, ainsi que l’article R. 4624-21 du code du travail (dans ses dispositions applicables en 2010).
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de Monsieur X. tendant à obtenir le paiement de la somme de 18.056 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence abusive ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE s’agissant de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, elle était limitée dans le temps, pour une durée de six mois renouvelable une fois, limitée dans l’espace, à savoir le territoire d’action commerciale confié au salarié au cours des deux ans précédant la rupture, limitée quant aux activités puisque visant les entreprises concurrentes c’est-à-dire toute entreprise dont l’activité se rapporte à la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels produits et ayant une même destination que ceux commercialisés par la société ou l’ayant été dans les deux ans précédant la rupture du contrat ; elle prévoyait une contrepartie à savoir une indemnité compensatrice égale à un maximum de six mois de salaire prime et rémunération de toute nature perçue par le salarié en prenant comme base de référence la moyenne mensuelle des 12 derniers mois d’activité ; enfin, l’employeur se réservait le droit de renoncer à la dite clause jusqu’à six mois après le départ du salarié ; contrairement à ce que soutient le salarié, la clause de non-concurrence était donc licite ; dès le 31 mars 2010, les deux parties ont convenu de la levée de la clause de non-concurrence ; le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce point ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la clause de non-concurrence qui permet à l’employeur d’agir à sa discrétion et laisse le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté d’une part, que la durée de l’interdiction n’était pas déterminée avec précision, l’employeur se réservant la possibilité de porter de 6 à 12 mois la durée de l’application de la clause, que d’autre part, que l’employeur se réservait le droit de renoncer à la clause à tout moment et jusqu’à six mois après le départ du salarié, ce qui correspondait à la durée initiale de l’interdiction et enfin, que seul le montant maximum de l’indemnité compensatrice et non son montant réel était déterminé, la clause permettant à l’employeur d’en fixer le montant à sa discrétion ; qu’en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, l’article L. 1121-1 du code du travail et le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.