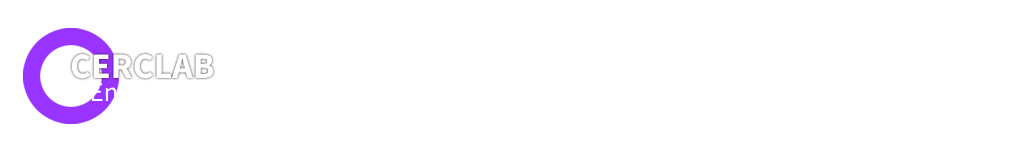CA PARIS (pôle 5 ch. 1 - 1er pdt), 14 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6664
CA PARIS (pôle 5 ch. 1 - 1er pdt), 14 décembre 2016 : RG n° 16/11138, RG n° 16/1156, RG n° 16/11173, RG n° 16/11179, RG n° 16/11205, RG n° 16/11210, RG n° 16/11213, RG n° 16/11214, RG n° 16/11215, RG n° 16/11246, RG n° 16/11263, RG n° 16/11270, RG n° 16/11276, RG n° 16/11292 ; arrêt n° 134/2016
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il convient de rappeler que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur, de nature à justifier la visite ; que, par suite, le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; qu'à cette fin, le JLD doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'administration, qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve, au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant, sans qu'il soit nécessaire que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; qu'un contrôle de proportionnalité a été effectué par le juge lorsqu'il décide de faire droit à la requête de l'administration. » [...]
« Il y a lieu de retenir que, si le JLD doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre la mise en place de l'enquête dite « lourde » car intrusive - ce qu'il a fait en l'espèce -, il est constant que l'article L. 450-4 du code de commerce n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres pouvoirs d'une Autorité administrative indépendante. Par ailleurs, il importe peu que ces pratiques soient qualifiées de « secrètes » ou de « discrètes », car, en l'absence d'écrits, il s'agissait de rechercher les preuves éventuelles de pratiques prohibées et que les sociétés du groupe CARREFOUR n'avaient sur ce point communiqué qu'oralement. En outre, la motivation du premier juge, loin de constituer une considération d'ordre général susceptible de justifier n'importe quelle visite domiciliaire, s'appuie sur des témoignages multiples et concordants, allant tous dans le même sens et dont il a été donné quelques exemples supra. »
2/ « Cette procédure permet à l'entreprise de faire connaître aux enquêteurs les pièces qui, d'après elle, pourraient bénéficier de la protection liée à la confidentialité des correspondances avocat-client. Ainsi, ces documents peuvent être rapidement supprimés des fichiers de messagerie dans lesquels ils figurent, étant précisé que la société visitée peut refuser d'utiliser cette procédure qui lui est proposée. Cette procédure du scellé provisoire ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux, et notamment aux droits de la défense. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 1 - PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/11138, 16/11156, 16/11173, 16/11179, 16/11205, 16/11210, 16/11213, 16/11214, 16/11215, 16/11246, 16/11263, 16/11270, 16/11276, 16/11292. Arrêt n° 134/2016 (29 pages).
Décisions déférées : R.G. n° 16/11138 : Ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - 16/11156 : Recours sur le procès-verbal des opérations de visite et saisie en date du 9 février 2016 dans les locaux sis [...] - R.G. n° 16/11173 : Ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - R.G. n° 16/11179 : Ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - R.G. n° 16/11205 : Recours sur le procès-verbal des opérations de visite et saisie en date du 9 février 2016 dans les locaux sis [...] - R.G. n° 16/11210 : Recours sur le procès-verbal des opérations de visite et saisie en date du 9 février 2016 dans les locaux sis [...] - R.G. n° 16/11213 : Ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - R.G. n° 16/11214 : Recours sur le procès-verbal des opérations de visite et saisie en date du 9 février 2016 dans les locaux sis [...] - R.G. n° 16/11215 : Ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - R.G. n° 16/11246 : Recours sur le procès-verbal des opérations de visite et saisie en date du 9 février 2016 dans les locaux sis [...] - R.G. n° 16/11263 : Ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY- R.G. n° 16/11270 : Recours sur le procès-verbal des opérations de visite et saisie en date du 9 février 2016 dans les locaux sis [...] - R.G. n° 16/11276 : Ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'ÉVRY - R.G. n° 16/11292 : Recours sur le procès-verbal des opérations de visite et saisie en date du 9 février 2016 dans les locaux sis [...].
Nature de la décision : contradictoire.
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L. 450-4 du code de commerce ;
assisté de Karine ABELKALON, greffier présent lors des débats ;
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G., substitut général, qui a fait connaître son avis.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
ENTRE :
Société C.S.F.
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro XXX, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Elisant domicile au cabinet LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE - [...]
Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro YYY, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Elisant domicile au cabinet LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE - [...]
Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'Évry sous le numéro ZZZ, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Elisant domicile au cabinet LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE - [...]
Société CARREFOUR IMPORT
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'Évry sous le numéro WWW, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Elisant domicile au cabinet LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE - [...]
Société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d'Évry sous le numéro VVV, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Elisant domicile au cabinet LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE - [...]
Société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro UUU, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Elisant domicile au cabinet LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE - [...]
Société INTERDIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro TTT, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Elisant domicile au cabinet LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE - [...]
Représentées par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque J125, Ayant pour avocats plaidants Maître Patrick H. et Maître Chimène F. de LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE, avocats au barreau de PARIS, toque K112
Appelantes et demanderesses aux recours
ET :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
représenté par Madame A., directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile de France, élisant domicile [adresse], conformément aux dispositions de l'article R. 470-1 du code de Commerce, ci-après la DIRECCTE, le Ministère et l'Administration, Représenté par Messieurs B. et C., fonctionnaires au pôle C de la DIRECCTE, munis de pouvoir de représentation spécial du 17 octobre 2016
Intimée et défenderesse au recours
* * *
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 octobre 2016, les conseils des parties, le représentant du Ministre de l'économie et le ministère public ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 14 Décembre 2016 pour prononcé en audience publique, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 462 du Code de procédure pénale.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ordonnance en date du 5 février 2016, le juge des libertés et de la détention d'ÉVRY (ci-après JLD) a autorisé monsieur X., directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile de France (ci-après DIRECCTE), responsable du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie, à procéder ou à faire procéder dans les locaux de l'entreprise suivante, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements du groupe CARREFOUR relatifs aux demandes d'avantages financiers supplémentaires et aux menaces d'arrêts de commande et de report des négociations commerciales qui entrent dans le champ des pratiques prohibées de l'article L. 442-6 du code de commerce ainsi que toute manifestation de ces agissements prohibés dans les locaux de toutes les sociétés du groupe CARREFOUR, situés au [adresse], dont notamment :
CARREFOUR IMPORT
CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
C.S.F
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
INTERDIS
Cette ordonnance a été établie suite à une requête de l'administration dans laquelle la DIRECCTE indiquait que la société sus-mentionnée serait présumée se livrer à des pratiques prohibées par l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Elle était accompagnée de 13 documents en annexe.
Dans sa requête, l'administration décrivait un contexte économique sectoriel caractérisé par une guerre des prix, aggravée récemment par le rapprochement des enseignes de la grande distribution en vue d'une coopération à l'achat, renforçant ainsi leur puissance de négociation, comme c'est le cas pour l'enseigne CARREFOUR, qui aurait conclu un accord avec l'enseigne CORA.
Elle faisait également état d'informations, selon lesquelles le groupe CARREFOUR demanderait, pour conserver sa position de leader depuis le 2 décembre 2015, à ses fournisseurs de bénéficier d'un avantage financier supplémentaire, à savoir une remise intitulée « remise complémentaire de distribution » (ci-après RCD), destinée à compenser le surcoût logistique résultant du développement de son réseau de magasins de proximité, surcoût qu'elle tenterait de répercuter sur les fournisseurs.
D'après les rapports de constat versés en annexe et établis par les enquêteurs de plusieurs Directions régionales, cette demande de remise (RCD) de l'enseigne CARREFOUR à ses fournisseurs aurait été annoncée à un panel de 200 fournisseurs le 2 décembre 2015 et l'acceptation de cette RCD aurait été présentée par l'enseigne comme un préalable à toute négociation commerciale ou à la signature du contrat en méconnaissance des règles du code de commerce qui encadrent les relations commerciales et notamment son article L. 441-6 I, qui dispose que « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale ».
Selon l'administration, le fait de différer le point de départ des négociations ou de soumettre à la signature du contrat à l'acceptation de demandes de remise RCD de l'enseigne, créerait une incertitude juridique et économique pour les fournisseurs, quant à la poursuite de leur relation commerciale avec l'enseigne, alors qu'ils ne pourraient se priver du débouché commercial d'une enseigne qui représente plus de 25 % de parts de marché.
Selon les déclarations recueillies par les enquêteurs, il y aurait eu un arrêt des commandes pour certains fournisseurs pendant quelques semaines, ce qui aurait eu pour effet de conduire ces derniers à accepter la RCD exigée par l'enseigne CARREFOUR, pour des montants déterminés par elle seule, étant précisé que les déclarations recueillies l'ont été oralement et sous couvert d'anonymat, dans le cadre d'une enquête réalisée dans trois régions différentes.
Il serait également fait état des craintes des fournisseurs de faire l'objet de mesures de rétorsion, telles le déréférencement de produits, de la part de l'enseigne CARREFOUR dans un secteur où les rapports de force entre partenaires commerciaux sont souvent déséquilibrés.
Par ailleurs, à la lecture des rapports de constat, il apparaîtrait que CARREFOUR ait présenté cette remise comme une demande aux fournisseurs de prendre en charge le surplus du coût généré par le transport des entrepôts de stockage de l'enseigne vers ses commerces de proximité en propre ou en franchise et que l'acceptation du versement de cette remise serait une condition, imposée par l'enseigne aux fournisseurs comme préalable à toute négociation commerciale ou à toute signature du contrat et donc, à terme, à la poursuite de leurs relations commerciales.
Il s'évincerait, du contenu de ces rapports, que ces demandes auraient été accompagnées de menaces orales ou, en cas de refus, de pressions ou de mesures de rétorsion telles que des arrêts de commandes, au moins temporaires, ou l'interdiction pour les commerciaux des fournisseurs de se présenter dans les magasins CARREFOUR, étant précisé que les demandes de l'enseigne CARREFOUR n'auraient été effectuées qu'oralement.
Dès lors il existerait, selon l'administration, de fortes présomptions que, depuis la réunion du 2 décembre 2015 et la présentation de cette remise à 200 fournisseurs, l'enseigne CARREFOUR demande de manière généralisée à l'ensemble de ses fournisseurs ce nouvel avantage financier, au titre de la prise en charge d'un surcoût logistique, sous la menace d'un report des négociations commerciales et des mesures de rétorsion.
L'administration en déduit que le transfert de la charge logistique du distributeur vers les fournisseurs, réalisé par l'enseigne CARREFOUR, serait susceptible de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et pourrait ainsi porter atteinte à l'équilibre des relations commerciales en exerçant ou en tentant d'exercer des pressions sur les fournisseurs, sous le menace de déréférencements ou d'arrêts de commande et, dans certains cas, en différant le début des négociations annuelles pour qu'ils acceptent sa demande de remise complémentaire.
Il en ressortirait que ces agissements contreviendraient notamment aux dispositions de l'article 442-6-I, 1°, 2°, 4° et 5° du code de commerce qui prévoit que la responsabilité d'une entreprise est engagée, lorsqu'elle obtient ou tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu et qu'engage sa responsabilité celui qui soumet ou tente de soumettre, son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…) qu'elle obtient ou tente d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix (…).
Sur la base de ces éléments, le JLD d'ÉVRY a délivré, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, une ordonnance de visite et de saisies.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2016 à 9 heures et mise en délibéré pour être rendue le 14 décembre 2016.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/11213 ; 16/11138 ; 16/11173 ; 16/11215 ; 16/11263 ; 16/11179 ; 16/11276 (appels) et RG 16/11156 ; 16/11214 ; 16/11292 ; 16/11205 ; 16/11210 ; 16/11270 ; 16/11246 (recours), lesquelles seront regroupées.
SUR L’APPEL
Par conclusions d'appel enregistrées le 18 juillet 2016, les sociétés appelantes font valoir que :
- le recours à l'article L. 450-4 du code de commerce, injustifié dans la présente affaire, procède d'une instrumentalisation et d'un détournement de procédure
Les appelantes rappellent les dispositions de l'article L. 450-4, al. 2 du code de commerce, dont il ressort que le juge doit vérifier que « la demande qui lui est soumise est fondée », et cette démarche implique de vérifier qu'il existe dans un dossier un ensemble d'indices laissant présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence, dont la preuve ne peut être recherchée autrement.
Or, en l'espèce, l'ordonnance contestée justifie le recours à l'article précité de la façon suivante : « il importe que soit recherchée la preuve des agissements auprès de leur auteur, c'est à dire des sociétés du groupe Carrefour, qu'à cette fin, les contrôles exercés sur le fondement des pouvoirs d'enquêtes définis à l'article L. 450-3 ne suffisent pas à apporter la preuve matérielle de l'existence des pratiques recherchées ; qu'en effet, la stratégie élaborée est manifestement établie selon des modalités secrètes et les documents nécessaires à la preuve de ces pratiques prohibées sont vraisemblablement conservés au sein de l'entreprise sous une forme qui facilite leur dissimulation ».
Les sociétés invoquent que ces arguments sont inopérants et infondés car, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance, les éléments recherchés n'avaient rien de « secrets », et auraient pu être parfaitement obtenus une fois les conventions avec les fournisseurs conclues.
Ainsi que l'a fait observer l'administration, « la mise en place de ladite remise a été annoncée à un panel de 200 fournisseurs lors d'une réunion organisée par l'enseigne, dans ses locaux, le 2 décembre 2015 », ces pratiques, à les supposer établies, ne revêtaient donc en rien un caractère secret.
De même, l'ordonnance énonce que « la stratégie élaborée est manifestement établie selon les modalités secrètes et les documents nécessaires à la preuve de ces pratiques prohibées sont vraisemblablement conservés au sein de l'entreprise, sous une forme qui facilite leur dissimulation ».
Or, une telle motivation constitue une considération d'ordre général susceptible de justifier n'importe quelle visite domiciliaire : il va en effet de soi que toute information relative à la stratégie commerciale d'une entreprise relève, par essence, du secret des affaires de cette dernière.
Par ailleurs, le recours à l'enquête lourde n'était pas justifié par une quelconque contrainte de temps, il aurait en effet était parfaitement été possible de recueillir des éléments de preuve, une fois les conventions avec les fournisseurs conclues.
L'administration justifie le recours au pouvoir de l'article L. 450-4 du code de commerce, en indiquant : « qu'en effet, les demandes du distributeur n'étant qu'orales, les remises sur facture et les baisses de tarifs accordées par les fournisseurs par exemple, pourraient être considérées comme des conditions particulières de vente « offertes », de leur plein gré, par les fournisseurs au distributeur ; que l'absence d'une contrepartie, de même que la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif seraient alors difficilement démontrables ». Or, il aurait été parfaitement possible de recueillir auprès des fournisseurs, après que les conventions aient été conclues, les éléments de preuve relatifs à une éventuelle mise en place RCD, étant précisé que l'article L. 441-7-I-1° exige désormais explicitement que figurent dans la convention unique les remises ou ristournes consenties par le fournisseur de produits ou de prestations de service dans le cadre de l'opération de vente.
Le but des visites et saisies en l'espèce était non pas de rechercher en vue de leur éventuelle sanction, les preuves de la commission, par CARREFOUR, de pratiques irrégulières mais de chercher à influer, de façon artificielle, sur la conduite des négociations commerciales, dans un but fondamentalement politique, ce qui n'est ni la lettre, ni l'esprit de l'article L. 450-4 précité.
Au surplus, les agissements présumés n'apparaissent pas particulièrement complexes et difficiles à appréhender sur le plan factuel.
En effet, les prétendus agissements révélés par les fournisseurs sont exposés de façon claire par l'administration, qui précise que « l'acceptation du versement de cette remise serait une condition, imposée par l'enseigne aux fournisseurs comme préalable à toute négociation commerciale ou à toute signature du contrat et donc, à terme, à la poursuite de leurs relations commerciales avec cette enseigne ». De ce fait, le recours au pouvoir de l'article L. 450-4 du code de commerce ne pouvait donc pas se justifier.
- le caractère injustifié du recours de l'article L. 450-4 du code de commerce est, dans cette affaire, d'autant plus contestable qu'il existait d'autres mesures d'enquête possible et moins attentatoires aux libertés des sociétés du groupe CARREFOUR
En effet, selon l'ordonnance, « les contrôles exercés sur le fondement des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3 du code de commerce ne suffisent pas à apporter la preuve matérielle de l'existence des pratiques recherchées ». Or, cette assertion s'avère inexacte car, à aucun moment, les contrôles exercés par les enquêteurs sur le fondement des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3 du code de commerce n'ont visé CARREFOUR elle même, à qui aucune explication n'a été demandée quant à la réalité et aux motivations de la mise en place de la RCD préalablement aux visites et saisies, alors, qu'une fois de plus, celle-ci n'avait rien de secrète, puisqu'annoncée aux fournisseurs eux mêmes très en amont.
Les sociétés appelantes font valoir que suite aux reformes introduites par la loi HAMON puis la loi MACRON, les pouvoirs dévolus aux enquêteurs agissant sous l'empire de l'article L. 450-3 ont été considérablement étendus, ces derniers pouvant désormais, en enquête simple, « exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains, qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ». De ce fait, il aurait été parfaitement possible pour l'administration d'exiger de CARREFOUR la communication des documents se rapportant spécifiquement à la mise en place de cette RCD, ou, par exemple, les documents se rapportant à la réunion du 2 décembre 2015, cependant de façon contestable, les enquêteurs n'ont, à aucun moment, fait usage de ces pouvoirs.
Affirmer, comme il le fait l'administration, que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce constitue le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés, trahit l'existence d'un détournement de procédure.
En réalité, ces opérations de visites et de saisies se sont inscrites dans un contexte bien particulier, marqué par la crise agricole et par des nombreuses déclarations du gouvernement en faveur d'une application plus rigoureuse de la loi LME, et, au delà, demandant à la grande distribution de cesser de négocier des prix bas auprès de ses fournisseurs et par une déclaration en octobre 2015 du ministre de l'Economie de la mise en place des contrôles de grande envergure, notamment des services de la DGCCRF.
Les appelantes citent, à l'appui de leur argumentation, plusieurs déclarations de ministres relatives au projet de révision de la loi LME et dans ce contexte, les opérations pratiquées dans les locaux des sociétés du groupe CARREFOUR ne peuvent se comprendre autrement que sous un jour purement politique. Il ne s'agissait en réalité, en instrumentalisant la procédure, que d'apporter une réponse médiatique à une crise politique majeure, en exerçant une pression accrue sur les distributeurs au moment même où se déroulaient les négociations annuelles.
Il en ressort que la DGCCRF elle même, loin du devoir de réserve qui s'impose à toute administration, n'a pas hésité à communiquer le 12 février 2016, quelques jours simplement après leur déroulement, sur les opérations de visites et saisies, menées dans les locaux de CARREFOUR à MASSY.
Dès lors, les opérations menées dans les locaux de CARREFOUR ainsi que les déclarations tonitruantes qui s'en sont suivies ne poursuivaient donc en réalité qu'un seul but, parfaitement étranger à l'objectif visé par l'article L. 450-4 du code de commerce : faire de CARREFOUR un « exemple », au service d'une logique politique et ayant vocation à aider le gouvernement à montrer qu'il agissait dans le cadre de la crise agricole.
Enfin, par conclusions en réponse en date du 10 octobre 2016, les sociétés du groupe CARREFOUR ont fait valoir l'absence de pertinence du moyen de procédure soulevé par l'administration, à savoir l'application de l'article 908 du code de procédure civile au cas d'espèce. Elles soutiennent que les règles de procédure pénale sont applicables en l'espèce et que le moyen de caducité invoqué par l'intimé ne peut qu'être écarté et ses conclusions à fins de caducité, rejetées. Par ailleurs, il est repris le moyen selon lequel le recours à la procédure de visite et de saisie n'était pas nécessaire pour mettre en évidence les pratiques alléguées de CARREFOUR, en précisant que les éléments recherchés n'avaient rien de « secrets », que la fusion de CARREFOUR avec l'enseigne CORA ne saurait éclairer la présente affaire de manière pertinente ; que le JLD aurait dû au préalable vérifier qu'il existait bien, dans le dossier, un ensemble d'indices laissant présumer l'existence de pratiques restrictives de concurrence, dont la preuve ne pouvait pas être recherchée autrement et que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce n'était pas davantage justifié par une quelconque contrainte de temps, à savoir la date butoir du 1er mars et que indique que l'affirmation selon laquelle, faute de pouvoir cibler les documents à demander à CARREFOUR, l'exercice du pouvoir de communication, fondé sur l'article L. 450-4 du code de commerce, aurait, selon lui, été privé d'efficacité. Elles concluent que la position de l'administration consiste à soutenir qu'il disposerait d'un véritable pouvoir discrétionnaire pour choisir entre la procédure de l'article L. 450-3 et la procédure beaucoup plus intrusive de l'article 450-4, position qui est intenable car on ne comprend pas pourquoi le législateur aurait reconnu à l'entreprise une voie de recours si, précisément, la question centrale de la nécessité et proportionnalité d'une opération d'une opération de visite et saisie intrusive ne pouvait pas être contestée.
Dès lors, il est demandé à ce qu'il soit fait droit au moyen tiré du défaut de nécessité et de proportionnalité du recours à l'article L. 450-4 du code de commerce et, par voie de conséquence, d'annuler l'ordonnance.
En conséquence, les sociétés appelantes demandent de constater que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce était injustifié dans la présente espèce, à titre principal, d'annuler l'ordonnance du JLD d'ÉVRY, de déclarer que la nullité de l'ordonnance entraîne la nullité des opérations de visites et saisies, d'ordonner la restitution immédiate aux sociétés appelantes des documents saisis dans leurs locaux et de condamner le ministre de l'Economie à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse enregistrées le 30 septembre 2016 au greffe de la Cour d'appel de PARIS, l'administration rappelle que, depuis la fin de l'année 2013, les distributeurs français se sont engagés dans une « guerre des prix », laquelle a impacté directement les marges des distributeurs de l'ancien CARREFOUR qui, ainsi qu'elle l'indique dans son rapport d'activité 2014, les a cependant maintenues par la mise ne 'uvre d'un plan logistique.
Au cours de la fin de l'année 2015 et au début de l'année 2016, en menant des contrôles pour s'assurer de la conformité des négociations commerciales aux dispositions du code de commerce, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après la DGCCRF) a recueilli des déclarations de fournisseurs faisant état de pressions et de pratiques susceptibles d'enfreindre les dispositions de l'article L. 442-6 du même code.
Au cours du mois de janvier 2016, il a été constaté que les négociations relatives aux conditions commerciales applicables en 2016 n'avaient pas commencé. En outre, les forces de vente des fournisseurs rencontrés n'étaient plus autorisées à visiter les magasins et certaines références n'étaient plus commandées depuis plusieurs semaines. L'enseigne CARREFOUR avait répondu défavorablement aux demandes des fournisseurs d'engager les négociations commerciales, en leur demandant d'abord de prendre décision sur la demande de remise RCD.
La DGCCRF rappelle qu'aux termes de l'article L. 441-7 du code de commerce, la convention unique ou le contrat cadre annuel fixant les conditions de la relation fournisseur-distributeur doit être impérativement conclu avant le 1er mars de chaque année.
Dans ce contexte, des constats relatifs aux pratiques incriminées ont été effectués dans plusieurs régions françaises par les DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté, Ile de France et Nord-Pas-Calais-Picardie.
I - Sur l'applicabilité de l'article 908 du code de procédure civile à l'espèce
L'administration soutient que l'article 908 du code de procédure civile qui dispose « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » et qu'en l'espèce, les sociétés du groupe CARREFOUR n'ont fait parvenir à l'administration leurs premières écritures relatives à l'appel dirigé contre l'ordonnance du JLD d'ÉVRY que le 18 juillet 2016, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel du 19 février 2016 et partant, le délégué du Premier Président décidera si la déclaration d'appel doit être frappée de caducité.
II - Sur l'absence de pertinence du moyen unique soulevé par les appelantes
Le groupe CARREFOUR affirme que le recours à la procédure de visite et saisie était « injustifié dans la présente affaire et procède d'une instrumentalisation et d'un détournement de procédure ».
Il est soutenu que le groupe CARREFOUR, en focalisant ses développements sur le contexte de la crise agricole, omet sciemment d'évoquer un élément crucial pour la compréhension du dossier, à savoir le mouvement de fusion des différentes centrales d'achat des distributeurs au niveau national, ce qui se traduit par un accroissement sensible de leur pouvoir de négociation, ainsi que l'a indiqué le JLD d'ÉVRY en la page 3 de son ordonnance laquelle met en exergue l'accord conclu entre l'enseigne CARREFOUR avec l'enseigne CORA.
1 - Le recours à la procédure de visite et saisie était nécessaire pour mettre en évidence les pratiques du groupe CARREFOUR et en rassembler les preuves
- sur le caractère secret des pratiques recherchées
Selon l'administration, le groupe CARREFOUR ne saurait nier le caractère secret de la remise complémentaire de distribution au prétexte qu'elle a donné lieu à une présentation à 200 fournisseurs lors d'une réunion dans ses locaux le 2 décembre 2015.
Cependant, le groupe CARREFOUR a tenté de dissimuler les preuves liées à l'existence et à l'objet de cette demande de remise, assortie de pressions et de menaces à l'égard des fournisseurs récalcitrants, notamment en ne communiquant à son sujet que de manière informelle, sans transmission de supports écrits, afin de ne laisser aucune trace susceptible d'être récupérée et exploitée par les services de l'administration, ainsi que l'évoque l'ordonnance en se référant à des rapports de constat selon lesquels l'enseigne CARREFOUR a présenté cette remise (RCD) comme une demande aux fournisseurs de prendre en charge le surplus de coût généré par le transport des entrepôts de stockage de l'enseigne CARREFOUR vers ses commerce de proximité (…) et que l'acceptation du versement de cette remise serait une condition imposée par l'enseigne aux fournisseurs comme préalable à toute négociation commerciale ou à toute signature du contrat et donc, à terme, à la poursuite de leurs relations commerciales avec cette enseigne.
Il est indiqué que toujours selon les rapports de constat figurant en annexe de la requête, ces demandes auraient été accompagnés de menaces orales ou, en cas de refus, de pressions ou de mesures de rétorsion telles que des arrêts de commandes (...) et que ces demandes de l'enseigne CARREFOUR n'auraient été effectuées qu'oralement.
En ne communiquant que de manière verbale, le groupe CARREFOUR souhaitait ne laisser aucun document ou support écrit relatif à la remise RCD qui puisse être transmis par ses fournisseurs aux services de la DGCCRF ou saisi par les partenaires de l'enseigne.
Pour l'administration, il est évident que l'usage des pouvoirs d'enquête ordinaires prévus à l'article L. 450-3 du code de commerce n'aurait pas permis de recueillir des preuves de ces pratiques chez les fournisseurs et c'est le constat des demandes indues du groupe CARREFOUR, assorties de pressions et de menaces, ainsi que ses man'uvres pour ne laisser aucun support consultable hors de ses locaux, qui a conduit l'administration à solliciter l'autorisation de procéder à des opérations de visite et de saisie.
Il est, par ailleurs, invoqué que le secret des affaires ne saurait lui être opposé lorsque des pratiques susceptibles d'être contraires à la loi peuvent être déduites d'un faisceaux d'indices de nature à justifier une telle opération.
En l'espèce, la DGCCRF a présenté à l'appui de sa requête, différents rapports de constat établis auprès de onze fournisseurs, basés dans des régions différentes, rapports allant tous dans le même sens, à savoir l'existence d'une demande occulte de remise complémentaire de distribution formulée par le groupe CARREFOUR, ces rapports en plus des éléments de contexte économique précités constituent un faisceau d'indices clairs, précis et concordants suffisant pour autoriser le recours aux pouvoirs prévus par l'article L. 450-4 du code de commerce.
Le JLD a examiné in concreto les éléments qui lui ont été soumis par l'administration, s'assurant ainsi de la proportionnalité entre les mesures de visite et de saisie sollicitées et l'objectif recherché, à savoir recueillir les preuves de la remise complémentaire de distribution imposée aux fournisseurs sous peine de représailles économiques.
Enfin, le groupe CARREFOUR ne saurait justifier le fait que cette demande de remise RCD a été systématiquement formulée oralement et a même conduit au refus de précisions écrites, en réponse aux demandes de précisions émanant de certains fournisseurs et effectuées par courriels. La volonté de dissimulation n'est pas douteuse.
La procédure de visite et de saisie, au sein des locaux du groupe CARREFOUR, était, par conséquent, proportionnée et la seule en mesure de permettre le recueil des preuves nécessaires à la démonstration de l'existence de la pratique.
- sur l'opportunité de recourir aux pouvoirs de visite et saisie avant le 1er mars
L'administration fait valoir que le recours à une visite domiciliaire antérieurement au 1er mars était nécessaire, eu égard à l'urgence de la situation et compte tenu du risque de déperdition des preuves des pratiques prohibées et si la demande de communication avait été effectuée après la date butoir du 1er mars, la preuve des pratiques n'aurait pas pu être rassemblée de manière satisfaisante, la conclusion des conventions effaçant l'état du rapport de force existant au cours de la phase de négociation, ainsi que l'indique le JLD dans son ordonnance : « les demandes du distributeur n'étant qu'orales, les remises sur facture par exemple pourraient être considérées comme des conditions particulières de vente « offertes », de leur plein gré, par les fournisseurs au distributeur (...) ».
La DGCCRF soutient que de la part du groupe CARREFOUR, l'unique « contrepartie » de l'acceptation de la remise RCD était l'entrée en négociation pour la conclusion des conventions annuelles et que, compte tenu de l'exigence légale de conclusion de toute convention annuelle avant le 1er mars de chaque année, les fournisseurs étaient dans une situation particulièrement difficile et s'exposaient au risque de ne pas voir leur relation commerciale reconduite.
L'administration souligne la nécessité d'une action rapide afin de vérifier l'existence de pressions destinées à permettre à l'enseigne CARREFOUR de récupérer un avantage financier indu, comme condition préalable à toute entrée en négociation : en effet, après la signature des conventions annuelles, il n'aurait pas été possible de mettre en évidence le lien de causalité entre le refus de signature par l'enseigne CARREFOUR et la non acceptation du versement de la remise RCD par certains fournisseurs, d'autres justifications pouvant être avancées par l'enseigne a posteriori.
Elle affirme donc que la visite des locaux du groupe CARREFOUR n'a jamais été une tentative de pression sur le distributeur ayant comme but d'influencer les négociations, mais elle a constitué une opération destinée à recueillir les preuves de pratiques prohibées par le code de commerce à un moment crucial pour éviter leur dépérissement et pour mettre en évidence de manière probante le caractère déloyal de ces pratiques.
- sur la supposée absence de complexité des faits
D'après l'administration, CARREFOUR donne une interprétation inexacte de la loi et de la jurisprudence citées en appui de la supposée absence de complexité des faits relatés dans l'ordonnance, qu'elle invoque afin de contester la justification du recours à une procédure de visite et saisie.
En effet, une décision de la Cour d'appel de PARIS qu'elle invoque considère que l'opération de visite et de saisie « est inévitable face à des agissements présumés qui peuvent se révéler particulièrement complexes et difficiles à appréhender sur le plan factuel ». Or, des agissements occultes, comme c'est le cas en l'espèce, peuvent se révéler particulièrement complexes et difficiles à appréhender sur le plan factuel, compte tenu de la multiplicité des fournisseurs de l'enseigne et de l'absence d'écrit qui caractérisent cette situation particulière.
Par ailleurs, la complexité et la difficulté d'appréhension ne constituent pas des conditions pour la mise en 'uvre de l'article L. 450-4 du code de commerce.
2 - En dépit des assertions des appelantes, il n'existait aucune alternative efficace aux pouvoirs fondés sur l'article L. 450-4 du code de commerce pour mettre en évidence les pratiques investiguées
L'argument selon lequel le groupe CARREFOUR fait valoir que le recours à l'article L. 450-4 du code de commerce était injustifié, compte tenu de l'existence « d'autres mesures d'enquête possibles », moins intrusives que la visite domiciliaire, est inexacte, en ce qu'il passe, délibérément, sous silence la complexité des enquêtes relatives aux pratiques de négociation des entreprises de la grande distribution.
La prérogative, tirée des pouvoirs de l'article L. 450-3 du code de commerce est limitée par la nécessité d'identifier avec précision les documents et supports dont la communication est demandée. En pratique, seules deux séries de documents peuvent aisément être demandées par l'administration en faisant usage de l'article L. 450-3 du code de commerce :
- les documents dont la société a l'obligation légale d'assurer la tenue (comptabilité, documents fiscaux...), leur existence et leur contenu étant par principe acquis ;
- les documents dont la tenue n'est pas légalement obligatoire mais dont l'administration connait l'existence, notamment à la suite d'une enquête réalisée auprès de tiers ou par simple constat visuel.
C'est ainsi que se manifeste la difficulté de la tâche des enquêteurs : les documents dont la tenue n'est pas obligatoire, parce que leur usage est purement interne à l'entreprise, n'offrent aucune certitude par rapport à leur existence ou à leur contenu.
En l'espèce, exerçant son pouvoir de communication auprès de fournisseurs du groupe CARREFOUR, la DIRECCTE a constaté l'inexistence de supports écrits relatifs à la remise RCD, le groupe CARREFOUR ayant pris le soin de ne s'exprimer à ce sujet que de manière orale.
Les preuves des pratiques recherchées étaient de manière évidente conservées exclusivement dans les locaux du groupe CARREFOUR sous une forme occulte.
Par conséquent, le recours à une visite domiciliaire s'est révélé indispensable pour rechercher de preuves matérielles.
La DGCCRF fait observer que l'affaire soumise aujourd'hui est extrêmement proche de l'analyse qu'elle fait de l'affaire ITM, à savoir que l'exercice des pouvoirs ordinaires a permis de constater l'existence d'échanges exclusivement oraux entre le groupe CARREFOUR et ses fournisseurs au sujet de la remise RCD.
Enfin, le groupe CARREFOUR ne peut exiger de l'administration qu'elle fasse usage de son droit de communication, lorsque cette dernière constate les man'uvres de l'enseigne, afin de ne diffuser aucun support écrit relatif à la pratique incriminée. La mise en 'uvre de l'opération de visite et de saisie était justifiée parce qu'indispensable à l'objectif poursuivi.
Les moyens développés par les sociétés appelantes devront être rejetés et il est demandé de dire et juger que l'ordonnance n° EV 2016/3 du 5 février 2016 du JLD d'ÉVRY est régulière et condamner la société CARREFOUR aux entiers dépens.
Le Ministère Public soutient dans son avis en date du 12 octobre 2016 :
I - la légalité de l'ordonnance du JLD d'ÉVRY en date du 5 février 2016
Le contexte global, dans lequel s'est opérée l'opération de visite et de saisie, était celui du mouvement de fusion de différentes centrales d'achat des distributeurs au niveau national, qui entrainent une concentration des acteurs de la grande distribution augmentant ainsi leur pouvoir de négociation et pas seulement celui de la crise agricole qui ne touche qu'une partie limitée des fournisseurs du groupe CARREFOUR et l'ordonnance du JLD a été régulièrement prise en considération d'un faisceau d'indices concordants permettant de soupçonner des pratiques illicites, qui ne pouvaient être établies au vu des méthodes employées par le groupe CARREFOUR autrement que par le recours au pouvoir de l'article L. 450-4 du code de commerce.
Le groupe CARREFOUR a mis en place des man'uvres secrètes, dont l'établissement supposait la mise en 'uvre de la procédure prévue par l'article L. 450-4 du code de commerce
Le groupe CARREFOUR voulait mettre en place, de manière non visible et non décelable, un mécanisme de remise complémentaire de distribution (RCD) et pour recueillir leur adhésion ce dispositif a été présenté par le groupe CARREFOUR à 200 de ses fournisseurs, lors d'une réunion tenue en ses locaux le 2 décembre 2015.
Cette circonstance n'a pas empêché que le groupe CARREFOUR ait pris soin de ne communiquer sur la question du RCD que de manière informelle, sans jamais transmettre de support écrit, et ce afin de ne laisser aucune trace, dans le contexte de pression et menace qu'il exerçait à l'égard des fournisseurs récalcitrants, ainsi que l'atteste les indices convaincants de ces pratiques relevées par les enquêteurs de plusieurs DIRECCTE.
Le Ministère Public reprend la motivation du JLD et à travers le contenu des rapports de constat établis par l'administration indique que l'acceptation du versement de cette remise serait une condition imposée par l'enseigne aux fournisseurs comme préalable à toute négociation commerciale... et que ces demande auraient été accompagnées de menaces orales ou, en cas de refus, de pression ou de mesures de rétorsion (...).
Ainsi, en ne communiquant que de manière verbale, le groupe CARREFOUR s'organisait pour ne laisser aucun document ou support écrit relatif à la remise RCD qui puisse être transmis par ses fournisseurs aux service de la DGCCRF ou saisi chez les partenaires de l'enseigne.
Au regard de cette volonté de dissimulation par le groupe CARREFOUR, caractérisant une stratégie délibérée, dont plusieurs rapports de la DIRECCTE montrent qu'elle était mise en place sous pressions et menaces, avec de moyens ne laissant aucun support consultable chez les candidats fournisseurs, en dehors de ses locaux, le JLD a justement apprécié que seule la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce pouvait permettre à l'administration de recueillir la preuve des pratiques prohibées soupçonnées, qui sont de nature à troubler gravement l'ordre public économique.
En l'espèce, des indices clairs, précis et concordants de pratiques prohibées apparaissent ici dans les rapports de constat présentés au JLD, établis auprès de onze fournisseurs de l'enseigne CARREFOUR, basés dans des régions différentes, qui dénoncent les distances d'une demande occulte de RCD, formulée oralement par le groupe CARREFOUR.
L'objectif était ici de recueillir les preuves de ce que le groupe CARREFOUR imposait une RCD à ses fournisseurs, sous peine de représailles économiques, en faisant en sorte que ces fournisseurs ne disposent d'aucune trace écrite de cette demande.
Le JLD a, dès lors, justement considéré que les preuves des pratiques prohibées, soupçonnées sur le fondement de ce faisceau d'indices, ne pouvaient pas être établies que par un contrôle impromptu des documents internes de l'enseigne CARREFOUR.
De surcroît, le recours à la procédure de communication de certains documents professionnels posée par l'article L. 450-3 du code de commerce, suppose qu'il soit a priori possible d'identifier les documents demandés. Or, cette démarche ne peut être mise en 'uvre lorsque, comme ici, aucune possibilité n'existe pour les identifier à partir de documents détenus par des tiers, du fait que le groupe CARREFOUR s'est organisé pour qu'aucun candidat fournisseur ne dispose de document concernant ses exigences en matière de RCD.
Enfin, la jurisprudence, de manière constante,affirme que le recours à l'article L. 450-4 du code de commerce n'est subordonné à l'utilisation infructueuse des pouvoirs issus de l'article L. 450-3 du même code. Cette analyse est indispensable, car une demande préalable de communication pourrait conduire à l'effacement pur et simple de tout élément de preuve de la pratique prohibée soupçonnée.
- la nécessité de mettre en 'uvre des mesures de visite et de saisie autorisées par le JLD avant le 1er mars 2016
Le Ministère public fait valoir que la convention, une fois signée entre CARREFOUR et l'un de ses fournisseurs, n'aurait pas été de nature à faire apparaître les menaces et pressions utilisées à son égard, puisqu'elle ne fait qu'enregistrer le succès des man'uvres soupçonnées. La recherche de la preuve de ces pratiques prohibées, fondées sur le faisceau d'indices concordants, qui a été relevée par plusieurs DIRECCTE, suppose que les preuves soient recherchées en urgence, en amont de la signature de ces conventions et avant que tout élément de preuve ne soit éliminé par CARREFOUR, au moment où la signature du contrat avec le fournisseur marque le succès de sa démarche ainsi que le relève le JLD dans son ordonnance.
Par ailleurs, il était nécessaire d'établir un lien entre, d'un côté, le refus du groupe CARREFOUR de négocier la conclusion des conventions annuelles entre une fournisseur et, de l'autre, le rejet par ce fournisseur de la RCD exigée par CARREFOUR. Or, cette preuve ne pouvait être trouvée qu'au stade des pourparlers, avant le 1er mars 2016. En effet, après cette date, la démarche du groupe CARREFOUR aurait été, dans la continuation de sa volonté de rendre indécelables les pratiques prohibées auxquelles il pouvait avoir recours, de supprimer purement et simplement tous les éléments se rapportant à sa stratégie d'obtention de concessions contractuelles non réciproques.
Ainsi, intervenir avant le 1er mars était la seule façon de vérifier que la remise constituait un préalable de la négociation et que son acceptation ne donnait lieu à aucune contrepartie identifiée, sinon le droit de débuter la négociation de la convention annuelle fournisseur-distributeur.
Le Ministère public conclut au rejet du recours portant sur la légalité de l'ordonnance rendue le 5 février 2016 par le JLD d'ÉVRY.
SUR LE RECOURS
Par conclusions enregistrées le 18 juillet 2016, les sociétés appelantes soutiennent :
I - la violation du secret professionnel et des droits de la défense de CARREFOUR :
Il est invoqué que la violation du secret professionnel et des droits de la défense de CARREFOUR intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs et qu'en l'espèce, au cours des opérations des 9 et 10 février 2016, les enquêteurs ont saisi des fichiers informatiques qu'ils ont regroupés dans des fichiers conteneurs sécurisés et ont placé les fichiers retenus sous le scellé provisoire n° 30 et indiqué à Mme G., occupant des lieux, que l'ouverture du scellé provisoire et la suppression des documents éventuellement protégés par le secret des correspondances avocat-client interviendrait à une date restant à définir.
Le 23 mars 2016 les enquêteurs se sont rendus dans les locaux du groupe CARREFOUR à MASSY et, après avoir constaté que le scellé provisoire n° 30 était intact et après l'avoir brisé, en ont extrait un disque dur contenant les fichiers saisis et ont procédé à l'élimination des documents, dont CARREFOUR estimait qu'ils relevaient de la protection accordée par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Il est invoqué que les garanties offertes par cette nouvelle méthode de scellé provisoire apparaissent clairement insuffisantes et inefficaces, dès lors que, dans le cadre de l'ouverture des scellés provisoires, les enquêteurs ont eu la possibilité d'accéder et prendre connaissance du contenu de tels documents.
Selon les sociétés requérantes, cette situation n'est pas pas acceptable, s'agissant de la protection des droits de la défense des entreprises et la simple élimination de ces seuls documents des fichiers saisis ne saurait permettre à elle seule d'appréhender l'irrégularité de leur consultation, la prise de connaissance irrégulière de ces documents ayant irrémédiablement compromis les droits de la défense.
Par conséquent, seule l'annulation de l'ensemble des opérations de visites et saisies permettra d'assurer que les droits de la défense de CARREFOUR ne soient pas irrémédiablement compromis.
II - A titre subsidiaire, l'impossibilité pour le juge de vérifier, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des saisies des fichiers de messagerie électronique de la régularité de ces dernières.
Les enquêteurs ont, au cours des opérations en date du 9 et 10 février 2016, examiné les données informatiques accessibles depuis le serveur des entreprises et de plusieurs ordinateurs portables. Des fichiers informatiques issues du serveur des entreprises et de plusieurs ordinateurs portables ont été saisis et placés sur disque dur, sous scellé provisoire n°30, afin de permettre à CARREFOUR d'identifier les documents dont elle estimait qu'il relevait de la protection accordée par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Le 23 mars 2016, les enquêteurs de la DGCCRF se sont rendus de nouveau dans les locaux de CARREFOUR, situés à Massy. Après avoir constaté que le scellé provisoire n°30 était intact et l'avoir brisé, les enquêteurs en ont extrait un disque dur contenant les fichiers saisis et ont procédé à l'élimination des documents, dont CARREFOUR estimait qu'ils relevaient de la protection accordée de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Les enquêteurs ont enfin réalisé un inventaire informatique des fichiers informatiques expurgés, qu'ils ont gravés sur DVD-R et placés en annexe 3 au second procès-verbal de visite et de saisie.
Il apparaît que les inventaires informatiques de fichiers de messageries électroniques soient trop imprécis pour permettre au second juge de vérifier concrètement la régularité de telles saisies.
Or, en l'espèce, « en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des opérations » le juge n'est pas en mesure de déterminer si des documents contenus dans chacun des fichiers de messagerie saisis se rapportaient bien, au moins en partie, à l'objet de l'autorisation, et partant, de vérifier la régularité des opérations de visites et saisies.
Tout d'abord, l'inventaire des fichiers informatiques saisis, figurant en page 42 du premier procès-verbal de visite et de saisie, dressé le 10 février 2016, fait simplement référence, de manière très générale, à la présence, dans le scellé 30, d'un disque dur.
Surtout, l'inventaire reproduit supra tout comme les inventaires informatiques des fichiers informatiques qui ont été saisis, gravés sur DVD-R et placés en annexe 3 du second procès-verbal de visite et de saisie, ne permettent pas au juge de relier les documents contenus dans chacun des fichiers de messagerie, à l'objet de l'enquête de la DGCCRF.
Les sociétés requérantes soutiennent qu'il est impossible, à la lecture des inventaires informatiques placés en annexe 3 du second procès-verbal de visite et de saisie, d'avoir la moindre indication sur le contenu des documents saisis dans les fichiers des messageries électroniques. En effet, le détail des inventaires informatiques saisis ne permet pas de prendre connaissance de la nature des documents contenus dans ces fichiers, ces derniers étant seulement intitulés par des noms génériques ou abréviations peu compréhensibles. Il s'agit de fichiers de messagerie inventoriés dans l'inventaire intitulé « Inv-Messagerie-SFP » : ces 28 fichiers commençant par mdelage.id et se terminant par jhamrit.
De ce fait, à la lecture de ces intitulés, aucun élément ne permet d'identifier le type de documents contenus dans chaque fichier et de détecter la présence, le cas échéant de documents sans rapport avec l'objet de l'enquête.
Le groupe CARREFOUR soutient que, quelque soit le caractère sécable ou non des fichiers de messagerie saisis en l'espèce, l'administration ne saurait se réduire pour satisfaire aux exigences légales et permettre au juge d'exercer son contrôle, à l'énoncé du nom et du chemin informatique d'un fichier, alors que chaque fichier contient potentiellement des milliers de documents. En tout état de cause, il est incontestable qu'en l'espèce, le délégué du Premier Président, qui ne saurait être dispensé d'une vérification concrète, n'est pas en mesure de déterminer si les fichiers de messagerie saisis et mentionnés supra, contiennent, même seulement en partie, des documents entrant dans le champs de l'autorisation.
Il en résulte que le caractère insécable des messageries électroniques rend donc a minima nécessaire l'annulation de la saisie de la totalité des fichiers de messagerie listés ci-dessus.
Il est donc demandé d'annuler la saisie de l'ensemble des fichiers de messagerie mentionnés supra.
Dès lors, il est demandé de constater, à titre principal, que les enquêteurs ont, lors des opérations de visite et saisie des 9, 10 février et 23 mars 2016, violé le secret professionnel et les droits de la défense des sociétés requérantes et, à titre subsidiaire, que la juridiction d'appel n'est pas en mesure de vérifier, en se référant au procès-verbal et aux inventaires informatiques, la régularité de la saisie des fichiers de messagerie électronique et, en conséquence, d'annuler l'ensemble des visites et saisies effectuées dans les locaux des sociétés requérantes ainsi que la saisie des fichiers de messagerie électronique, dont le libellé ne permet pas à la juridiction d'appel d'exercer son contrôle. En toute hypothèse, il est demandé de condamner le Ministre chargé de l'économie à payer aux sociétés requérantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse enregistrées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 30 septembre 2016, M. le Ministre chargé de l'économie fait valoir :
I - l'absence de violation du secret professionnel
L'administration entend rappeler qu'à l'occasion d'une opération de visite et saisie :
l'original des fichiers demeure dans l'entreprise ;
3 copies sont faites de cet original, dont une est placée sous scellé, la seconde conservée par l'administration pour les besoins de l'enquête et la dernière laissée à l'entreprise.
Les enquêteurs procèdent à la seule copie sécurisée de certains fichiers stockés sur les supports informatiques de l'entreprise qui les conserve donc.
Par ailleurs, et alors même que ni le code du commerce ni l'article 56 du procédure pénale ne l'impose, un inventaire descriptif extrêmement précis est dressé, lequel indique : le nom du fichier, son extension, l'endroit où il se situait sur l'ordinateur visé (le chemin) et surtout son empreinte numérique, c'est à dire un identifiant équivalent à l'ADN pour un individu, étant précisé que cette méthode de saisie employée par l'administration est constamment validée par la jurisprudence.
Par ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement la saisie des messageries électroniques, la chambre criminelle de la cour de cassation considère que chaque messagerie constitue un fichier insécable devant être saisi dans son entièreté.
L'administration cite, à l'appui de son argumentation, plusieurs décisions rendues par la chambre criminelle de la cour de cassation en 2011, 2012, 2013 et 2014, établissant que les fichiers informatiques copiés, constitués de messageries électroniques insécables, ont fait l'objet d'un inventaire, dont mention a été portée au procès-verbal relatant les opérations de saisie et qu'un fichier informatique indivisible peut être saisi dans son entier s'il est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête.
En outre, par un arrêt du 2 avril 2015, la Cour européenne des droits de l'homme a validé les méthodes de perquisition informatique mise en place par l'administration. Néanmoins, l'administration a souhaité mettre en place la procédure dite du scellé provisoire pour mieux assurer la protection des pièces saisies et permettre aux entreprises d'écarter rapidement certaines pièces des scellés constitués, étant précisé également que la Cour de cassation valide de manière constante et sans aucune ambiguïté les méthodes de saisie utilisées par l'administration.
En l'espèce, il importe peu que les agents de l'administration aient pu prendre connaissance des pièces saisies car l'annulation de la saisie suivie de la restitution des pièces, leur interdit de les utiliser dans la suite de la procédure de quelque manière que ce soit.
Selon l'administration, la procédure des scellés fermés provisoires offre à l'entreprise la possibilité de faire connaître aux enquêteurs les pièces qui, d'après elle, pourraient bénéficier de la protection liée au privilège légal. Grâce à cette procédure, ces documents peuvent ainsi être rapidement supprimés des fichiers de messagerie dans lesquels ils figurent et l'entreprise reste totalement libre de ne pas utiliser cette faculté qui lui est offerte.
L'argumentation des sociétés du groupe CARREFOUR, qui soutiennent que la prise de connaissance de documents par des enquêteurs, à l'occasion des opérations d'expurgation des scellés fermés provisoires, est totalement contraire aux principes de la jurisprudence sur ces questions n'est pas fondée.
Les requérantes croient pouvoir s'appuyer sur l'arrêt MEDTRONIC, qui a considéré que la violation du secret des correspondances avocat-client « intervient dès lors que le document est saisi par les enquêteurs » et elles en déduisent, de manière péremptoire, que la prise de connaissance que les enquêteurs pourraient avoir du document, au moment où ils l'expurgent des éléments du scellé fermé provisoire, se traduit par la même violation du secret que si ce document avait été saisi.
Or, il s'agit d'une part d'un contre-sens évident et d'autre part, d'une argumentation qui ignore les solutions dégagées par la jurisprudence, qui a envisagé la solution dans laquelle les enquêteurs peuvent prendre connaissance de la teneur de documents couverts par le secret, sans que cette circonstance soit considérée comme entraînant la violation de celui-ci.
En effet, la protection du secret dont bénéficie les correspondances avocat-client se concrétise par l'impossibilité pour l'administration de faire usage des documents en question, dont la saisie est annulée.
La DGCCRF cite, à l'appui de son argumentation, une décision de la Cour d'appel de PARIS en date du 31 août 2012 EUROPCAR FRANCE.
En revanche, la prise de connaissance de ces documents constitue, dans tous les cas, une condition indispensable à la réalisation des opérations de visite et de saisie. Que ce soit, lors de l'examen sommaire des documents papier ou de données informatiques, et que cet examen conduise à une saisie (ou à une absence de saisie) immédiate ou ultérieure, après que l'entreprise ait été invitée à identifier les pièces qu'elle estime protégées par le privilège légal, ces opérations impliquent que les enquêteurs puissent se prononcer sur la teneur des documents, ne serait-ce que pour constater concrètement qu'ils consistent véritablement en des échanges avec les avocats.
Le fait d'interdire aux enquêteurs de visualiser un document, au motif qu'il serait susceptible d'être protégé les mettrait dans l'impossibilité totale de procéder aux missions, dont ils sont chargés.
A l'appui de son argumentation, l'administration cite plusieurs jurisprudences de la Cour de Cassation et de la Cour d'appel de PARIS.
En conséquence, c'est par une argumentation tout à fait erronée que les sociétés du groupe CARREFOUR tentent de faire valoir que les opérations d'expurgation des scellés fermés provisoires, visant à retirer les pièces couvertes par le secret des correspondances avocat-client, entraîneraient « per se » une violation dudit secret et porterait ainsi une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.
Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation a considéré quand bien même ces correspondances auraient été saisies à tort, en raison du caractère insécable des fichiers de messagerie, la conséquence qui devait en être tirée était l'annulation de la saisie des pièces litigieuses et leur restitution à l'entreprise, et non l'annulation de l'ensemble des opérations.
Selon l'administration, il ressort clairement des arrêts de la Cour de Cassation ou de Cours d'appel, que quand bien même des pièces devant bénéficier du secret professionnel auraient été indûment saisies, ceci n'aurait en aucun cas pour conséquence de vicier la régularité des autres opérations de saisie, mais entraînerait seulement l'annulation de leur saisie.
En conséquence, l'administration conclut au rejet de ce moyen.
II - Sur la prétendue impossibilité pour le juge de contrôler, à partir des procès verbaux et inventaires, la régularité des saisies de documents
La DGCCRF soutient que ce n'est pas sans une certaine mauvaise foi que CARREFOUR critique la désignation insuffisamment précise de ce disque dur placé sous le scellé N°30. En effet, le procès-verbal expose clairement, en page 40 et 41, les conditions dans lesquelles les enquêteurs ont demandé à l'occupant des lieux ou à son représentant de pouvoir accéder aux fichiers de messagerie ainsi qu'aux autres données informatiques présents sur les serveurs des entreprises visées par l'autorisation et accessibles depuis les ordinateurs de certains salariés.
Le procès-verbal indique bien que les enquêteurs ont constaté la présence, parmi ces données, de documents entrant dans le champ de l'application de l'autorisation ; qu'ils ont procédé à leur authentification numérique et qu'il les ont regroupés sur un fichier conteneur sécurisé constituant le scellé fermé provisoire n° 30.
Cette opération permet aux entreprises de demander l'expurgation de documents protégés par le secrets des correspondances entre les avocats et leurs clients.
Le procès-verbal indique encore qu'après avoir fait état de la mise sous scellé n° 30 de ce disque dur, la liste des fichiers y figurant, constituant l'annexe 5 du procès-verbal, a été remise à l'occupant des lieux.
Enfin, le second procès-verbal de visite et saisie, dressé le 24 mars 2016, relate que les sociétés du groupe CARREFOUR ont demandé la protection du secret des correspondances entre l'avocat et son client. Les enquêteurs ont procédé à l'expurgation des fichiers concernés et de nouveaux inventaires informatiques des fichiers saisis, placés en annexe n° 3 à ce second procès-verbal ont été élaborées. Deux copies ont été réalisées, l'une destinée aux enquêteurs et l'autre remise aux sociétés du groupe CARREFOUR.
Par ailleurs, les sociétés du groupe CARREFOUR reproduisent, au point 35 de leurs conclusions, la liste des noms de fichiers inventoriés dans cette annexe n° 3 sous l'intitulé « Inv-messageries-SFP » en affirmant qu’»aucun élément ne permet d'identifier le type de documents contenus et de détecter la présence, le cas échéant, de documents sans rapport avec l'objet de l'enquête.
L'administration fait valoir que, comme l'indique l'intitulé de cette liste, et les indications des procès verbaux, il s'agit là des noms des fichiers de messagerie électronique de divers salariés des sociétés que les enquêteurs ont décidé de saisir, après avoir constaté qu'ils contenaient des éléments en rapport avec l'objet de l'autorisation donnée par le juge. S'agissant de ce type de fichiers, leur nom est composé du nom de la personne concernée précédée par l'initiale de son prénom, ainsi que du suffixe « nsf » qui caractérise les fichiers de messagerie fonctionnant sur la base du logiciel Lotus Notes. L'inventaire précise le nom, la taille et le chemin d'accès informatiques de ces fichiers, qui coexistent avec d'autres fichiers reprenant les mêmes noms suivis du suffixe »id », de taille trsè réduite, qui constituent des éléments d'identification propres à ce logiciel.
La DGCCRF fait état d'une abondante et constante jurisprudence reconnaissant la validité de ce type de fichiers, leur insécabilité et la désignation de ceux-ci par leur nom générique.
La seule exigence relative à ces inventaires est qu'ils doivent permettre d'assurer l'authentification des pièces saisies, afin de permettre à l'entreprise visitée de les identifier de manière certaine et de faire valoir, le cas échéant, ses contestations sur la régularité de leur saisie.
Il en résulte que la contestation soulevée, à titre subsidiaire, par les sociétés du groupe CARREFOUR, suivant laquelle les inventaires établis à l'occasion des opérations de visite et saisie, et notamment ceux figurant en annexe 3 au procès-verbal dressé le 23 mars 2016, ne permettraient pas à l'autorité judiciaire de contrôler si les documents saisis entraient dans le champ de l'autorisation, est dépourvue de toute pertinence.
L'administration conclut au rejet des contestations sur les opérations sus-mentionnées.
En conséquence, elle demande de dire et juger que les opérations de visite et saisies effectuées en application de l'ordonnance EV 2016/3 rendue par le JLD d'ÉVRY ont été réalisées conformément aux dispositions des articles L. 450-4 du code de commerce et 56 et suivants du code de procédure pénale, condamner les sociétés requérantes du groupe CARREFOUR aux entiers dépens.
Le Ministère public, sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées en exécution de l'ordonnance rendue le 5 février 2016 par le JLD d'ÉVRY, fait valoir que la procédure suivie garantit la préservation du secret professionnel et des droits de la défense et elle est conforme aux exigences posées par la jurisprudence.
Les fichiers saisis, susceptibles de contenir des éléments intéressant l'enquête, ont été identifiés et inventoriés, ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi lors des opérations, qui fait état du placement sous scellé provisoire N°3 du disque dur concerné, avec une annexe 5 comportant la liste des fichiers y figurant, la copie de l'ensemble de ces éléments a été remise à l'occupant des lieux, ce qui a permis au groupe CARREFOUR de connaître le contenu des données appréhendées, puis de demander et d'obtenir la destruction des éléments couverts par le secret ainsi strictement protégé.
Par cette procédure du scellé provisoire, aucune atteinte aux droits fondamentaux, et notamment aux droits de la défense ne peut en conséquence être ici caractérisée.
Théoriquement, les agents de la DGCCRF peuvent prendre connaissance des documents saisis pour déterminer s'ils doivent ou non les saisir. Pratiquement, les saisies litigieuses concernent les boîtes mails de dirigeants ou salariés de l'entreprise, qui sont, suivant les exigences posées par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, insécables. Ces boîtes sont donc saisies dans leur intégralité, placées sous scellé provisoire et copie de ce qui a été saisi est remise à l'occupant des lieux. Ce dernier peut donc examiner ce qui a été placé sous scellé provisoire, avant la réunion à laquelle il a été convié avec les agents ayant procédé à la visite, lors de laquelle ils pourront obtenir la destruction des pièces qu'ils estiment protégées par le secret des échanges avec l'avocat ou le secret de la vie privée.
A supposer qu'un agent ait pu, lors de la saisie, après avoir eu en lecture l'une de ces pièces, ce qui ne pourrait exceptionnellement être le cas si cette dernière se trouvait en dehors d'une messagerie saisie de manière insécable, comme l'exige la Cour de cassation, cette pièce sera détruite, lors de la réunion contradictoire portant sur la transformation du scellé provisoire en scellé définitif et il ne pourra jamais être fait état de son contenu en procédure.
Pour la chambre criminelle, la sanction de la saisie d'éléments portant atteinte aux secrets protégés figurant à tort dans le dossier est l'annulation de la saisie des pièces litigieuses et non l'annulation des opérations de visite et de saisie.
Dans la présente espèce, la critique ne porte pas sur la présence en procédure d'éléments concernés par le secret de la correspondance avocat-client, puisqu'ils ont été détruits lors de la réunion contradictoire organisée pour transformer le scellé provisoire en scellé définitif.
Compte tenu du fait que les éléments expurgés ont été détruits, il est demandé d'écarter également l'allégation, non fondée factuellement, selon laquelle les pièces détruites auraient pu, avant leur destruction, orienter les investigations des enquêteurs ;
La constitution de scellés, précisément identifiés, permet dans tous les cas au magistrat saisi d'exercer son contrôle, à partir des procès verbaux établis à l'occasion des opérations de visite et de saisie et des inventaires qui les accompagnent.
Dès lors, il est demander de rejeter également le recours mettant en cause la régularité des opérations précitées consécutivement intervenues.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
A titre liminaire :
Les appelantes ont fait parvenir une note en délibéré en date du 22 novembre 2016.
L'article 445 du code de procédure civile dispose que : « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Or, lors de l'audience du 19 octobre 2016, nous n'avons formulé aucune demande particulière et cette note ne répond pas aux arguments du Ministère public, lequel, par ailleurs, n'a pas été destinataire de cette note.
Dès lors, cette note sera écartée des débats.
Sur l'applicabilité de l'article 908 du code de procédure civile à l'espèce :
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux procédures écrites devant la Cour d'appel et avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contentieux des visites domiciliaires relevant de la procédure orale, ces dispositions ne peuvent en conséquence s'appliquer.
SUR L’APPEL :
I) Le recours à l'article L. 450-4 du code de commerce, injustifié dans la présente affaire, procède d'une instrumentalisation et d'un détournement de procédure
Les sociétés appelantes font valoir que l'argumentation développée dans l'ordonnance querellée, à savoir que « la stratégie élaborée est manifestement établie selon les modalités secrètes et les documents nécessaires à la preuve de ces pratiques prohibées sont vraisemblablement conservés au sein de l'entreprise, sous une forme qui facilite leur dissimulation » est erronée et qu'une telle motivation constitue une considération d'ordre général susceptible de justifier n'importe quelle visite domiciliaire.
Il convient de rappeler que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce est tenu de vérifier si la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur, de nature à justifier la visite ; que, par suite, le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'administration aient une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; qu'à cette fin, le JLD doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'administration, qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve, au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant, sans qu'il soit nécessaire que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; qu'un contrôle de proportionnalité a été effectué par le juge lorsqu'il décide de faire droit à la requête de l'administration.
S'agissant des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions, le premier juge a examiné in concreto, en ses annexes 8, 9 et 10 relatifs aux constats effectués par trois DIRECCTE, à savoir celle de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE, celle du NORD PAS DE CALAIS PICARDIE et celle d'ILE DE FRANCE retranscrivant onze témoignages, lesquelles font apparaître que la demande de versement d'une nouvelle remise complémentaire de distribution (RCD) a été « présentée comme un préalable à la négociation commerciale de 2016. Il s'agit d'un pré-requis » (annexe 8). Le mercredi 20 janvier 2016, l'un des fournisseurs a expliqué à Madame Y. que, lorsqu'il propose à CARREFOUR que cette RCD soit discutée dans le cadre des négociations, CARREFOUR lui répond qu'il doit prendre position sur la RCD avant de pouvoir engager la négociation sur les points suivants. Le fournisseur affirme que « si la RCD n'est pas annoncée par CARREFOUR comme un pré-requis, de fait cela en est un, car à date du 20 janvier 2016, la négociation commerciale n'a pas encore commencé ». Le vendredi 22 janvier 2016, le second fournisseur a indiqué à Madame Y. que « avec CARREFOUR, la négociation commerciale n'a pas encore commencé, la négociation porte encore, à date, sur la remise logistique de proximité » (annexe 9). Selon un autre témoignage, il est indiqué ; « nous sommes en période de surchauffe pour 2016. CARREFOUR a déjà fait une réunion le 2 décembre à MASSY avec les plus grands fournisseurs, afin de présenter le cahier des charges. Durant le réunion, le ton est devenu très agressif, CARREFOUR reprochant aux industriels d'investir dans d'autres enseignes, et donc de créer la guerre des prix : « LECLERC est bas en prix de vente consommateur (PVC), cela veut dire que vous lui permettez de le faire ». Une nouvelle ristourne vient d'arriver chez CARREFOUR, une ristourne complémentaire de distribution. Elle se fonde sur le fait qu'il est plus cher de livrer un petit magasin, les acheteurs de CARREFOUR demandent donc aux industriels de prendre en charge une partie de ces dépenses. Cet argument est fallacieux car le PVC est supérieur en ville qu'en hyper. Or, CARREFOUR considère cela comme un pré-requis à toute négociation et ne veut pas parler de plan d'affaires (…) » (annexe 10).
Sur l'argument des sociétés appelantes, à savoir qu'il ne s'agirait pas d'une stratégie secrète, puisque la réunion avait été annoncée à 200 distributeurs, le 2 décembre 2015, le premier juge a relevé une absence totale d'écrits relatifs à cette remise RCD sans contrepartie et notamment dans le constat, où il était indiqué « le fournisseur a communiqué par mail avec la personne en charge des achats de son type de produits pour faire état de a problématique ‘remise complémentaire de distribution -, il n'a pas obtenu de réponse écrite » (annexe 8). D'après un autre témoignage, « le 13 janvier 2016 a été déclaré à nous F., L. et P., par le représentant du quatrième fournisseur : le 2 décembre tout était oral, il n'y a eu aucune présentation écrite... nous avons fait une proposition sur cette remise qu'ils n'ont pas acceptée (...) ».
Concernant les pressions dont auraient fait l'objet les fournisseurs, ces mêmes rapports de constat font état de « la force de vente du fournisseur n'est plus autorisée à visiter les magasins et des références ne sont plus commandées depuis trois semaines » (annexe 8). « A la date du 28 janvier 2016, ce fournisseur estime être sous la menace de référencement... avec une non-avancée de la discussion sur le tarif et les investissements 2016 » (annexe 9). A travers d'autres témoignages, il était relevé que « en date du 28 janvier 2016 cette même personne a déclaré à nous, P. M. : « les négociations avec CARREFOUR sont dures à cause de la remise de distribution complémentaire. Le fait que nous refusons cette remise complémentaire crée de forts blocages avec CARREFOUR ainsi que des sanctions. Ainsi, nous avons subi des déréférencements brutaux sans préavis. De plus, en ce moment, nous n'avons pas de négociation en cours avec cette enseigne ». Un autre fournisseur indiquait le 13 janvier 2016 « CARREFOUR a annoncé le 2 décembre qu'ils allaient arrêter de travailler avec certains fournisseurs » et le 29 janvier le représentant d'un cinquième fournisseur a déclaré « ‘nous pouvons quand même négocier mais le fait que nous n'acceptions pas la RCD en l'état, a causé chez nous des déréférencements brutaux. CARREFOUR ne propose aucune contrepartie pour le paiement de la RCD, il conditionne seulement un déroulement optimal des négociations à l'acceptation de cette condition » (annexe 10).
Ces éléments ont été rapprochés du contexte économique sectoriel caractérisé par une guerre des prix, aggravée récemment par le rapprochement des enseignes de la grande distribution, en vue d'une coopération à l'achat, renforçant ainsi leur puissance de négociation vis à vis des fournisseurs.
Il en a résulté, pour le juge signataire de l'ordonnance, qu'en dehors de tout contexte de crise agricole, en analysant, selon la méthode du faisceau d'indices, les éléments pris dans leur ensemble et non individuellement, la demande de versement d'une nouvelle remise complémentaire de distribution (RCD), sans contrepartie, était présentée comme un préalable à la négociation commerciale de 2016 et il s'agissait d'un pré-requis, que si une communication avait été faite, il n'existait pas d'écrits, et enfin que des pressions avaient été effectuées auprès des fournisseurs tels que des déréférencements brutaux, des arrêts de négociation..., et qu'elles étaient de nature à faire présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles, dont la preuve est recherchée.
Il en ressort également qu'en relevant ces éléments, le premier juge a estimé que les pouvoirs d'enquêtes définis à l'article L. 450-3 du code de commerce étaient insuffisants pour apporter l'éventuelle preuve matérielle des agissements prohibés et auraient pu conduire à une dissipation de documents pouvant, le cas échéant, établir cette demande de remise supplémentaire sans contrepartie et auraient, en tout état de cause, éveillé l'attention des sociétés du groupe CARREFOUR sur les investigations du Ministère de l'Economie sur la RCD, étant précisé qu'en l'absence d'écrits, les documents nécessaires à la preuve recherchée ne pouvaient se trouver qu'à l'intérieur des locaux des sociétés du groupe CARREFOUR.
Il y a lieu de retenir que, si le JLD doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre la mise en place de l'enquête dite « lourde » car intrusive - ce qu'il a fait en l'espèce -, il est constant que l'article L. 450-4 du code de commerce n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres pouvoirs d'une Autorité administrative indépendante.
Par ailleurs, il importe peu que ces pratiques soient qualifiées de « secrètes » ou de « discrètes », car, en l'absence d'écrits, il s'agissait de rechercher les preuves éventuelles de pratiques prohibées et que les sociétés du groupe CARREFOUR n'avaient sur ce point communiqué qu'oralement.
En outre, la motivation du premier juge, loin de constituer une considération d'ordre général susceptible de justifier n'importe quelle visite domiciliaire, s'appuie sur des témoignages multiples et concordants, allant tous dans le même sens et dont il a été donné quelques exemples supra.
Enfin, s'agissant de la contrainte de temps qui n'aurait pas été justifiée, le premier juge a pris en compte les témoignages liant cette remise supplémentaire sans contrepartie à la bonne conduite des négociations dont la date butoir était fixée au 1er mars 2016.
L'argument selon lequel il aurait été parfaitement possible de recueillir des éléments de preuve, une fois les conventions avec les fournisseurs conclues, n'est pas pertinent. Il s'agissait en l'espèce de déterminer le moment opportun pour vérifier si les assertions des 11 fournisseurs, repartis sur trois inter-régions différentes, étaient exactes ou non. Après le 1er mars 2016, il aurait été plus difficile de rapporter la preuve que cette RCD obtenue sans contrepartie, l'avait été sous des pressions diverses ou bien aurait été concédée, sous la forme « d'une sorte de geste commercial » de la part des fournisseurs aux distributeurs, étant précisé que l'article L. 441-7-I-1° exige explicitement que figurent dans la convention unique les remises ou ristournes consenties par le fournisseur de produits ou de prestations de service dans le cadre de l'opération de vente. Il ne s'agissait pas d'influer sur des négociations futures mais de déterminer la date opportune à laquelle les preuves éventuelles pouvaient être recueillies, sans courir le risque de voir disparaître des documents pouvant intéresser l'enquête.
Enfin, il ne semble pas que les agissements présumés aient été particulièrement complexes et difficiles à appréhender sur le plan factuel, l'élément déterminant pour les appréhender étant, comme nous l'avons rappelé précédemment, le choix du moment pour diligenter l'enquête lourde.
Ce moyen sera rejeté.
II) Le caractère injustifié du recours de l'article L. 450-4 du code de commerce est, dans cette affaire, d'autant plus contestable qu'il existait d'autres mesures d'enquête possible et moins attentatoires aux libertés des sociétés du groupe CARREFOUR
Il a été amplement répondu à ce moyen ci-dessus et notamment sur le fait que le premier juge, d'après les éléments qui lui étaient fournis, a procédé à un examen de proportionnalité entre l'autorisation délivrée pour une visite domiciliaire et les pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-3 du code de commerce, qui lui semblaient insuffisants.
Il y a lieu de mentionner que l'article 8 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme te des libertés fondamentales (ci-après CESDH) dispose, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, que « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Il convient de rappeler que le JLD lorsqu'il a été saisi de la requête de l'administration a pris connaissance de ces éléments et des recherches effectuées préalablement par le Ministère de l'Economie, concernant des éventuelles pratiques prohibées ; qu'il a effectué un contrôle de proportionnalité entre les présomptions qui lui sont produites et l'atteinte aux libertés, son rôle n'étant pas celui d'une chambre d'enregistrement, ni de relais d'éventuelles déclarations ministérielles. En tout état de cause, il avait la possibilité de refuser de faire droit à la requête de l'administration.
S'agissant de nouveau des contrôles exercés sur le fondement des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3 du code de commerce, les nombreux témoignages recueillies dans les constats précités reflètent bien le climat très agressif de la journée du 2 décembre 2015 et l'atmosphère très tendue, lors des négociations individuelles relatives à cette nouvelle remise sans contrepartie, ce contexte très particulier entre un distributeur et certains fournisseurs ont déterminé le premier juge à écarter les pouvoirs précités au bénéfice de l'enquête lourde et rien ne permet de penser que les documents transmis par le groupe CARREFOUR à l'administration sur le contenu de cette réunion du 2 décembre 2015 n'auraient pas été, le cas échéant, « expurgés » pour que n'apparaisse pas le climat tendu évoqué ci-dessus, ce que le premier juge voulait précisément éviter.
Dès lors, aucun détournement de procédure ne peut être caractérisé, le JLD ayant usé des prérogatives prévues par le code de commerce.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
LE RECOURS :
I - La violation du secret professionnel et des droits de la défense de CARREFOUR :
Les sociétés du groupe CARREFOUR requérantes soutiennent que la pratique des scellés provisoires, puis définitifs serait, par essence, insuffisante et inefficace dans la mesure où les enquêteurs auraient eu la possibilité d'accéder et de prendre connaissance du contenu des documents relevant de la protection accordée par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Il convient de rappeler que cette pratique mise en place par l'Autorité de la concurrence et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il y a trois ou quatre ans, afin de protéger la confidentialité des correspondances avocat-client. A notre connaissance, aucune autre administration (fiscale, douanière...) ne l'a expérimentée à ce jour.
Cette procédure permet à l'entreprise de faire connaître aux enquêteurs les pièces qui, d'après elle, pourraient bénéficier de la protection liée à la confidentialité des correspondances avocat-client. Ainsi, ces documents peuvent être rapidement supprimés des fichiers de messagerie dans lesquels ils figurent, étant précisé que la société visitée peut refuser d'utiliser cette procédure qui lui est proposée.
Cette procédure du scellé provisoire ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux, et notamment aux droits de la défense.
En l'espèce, lors de la visite domiciliaire, les enquêteurs ont saisi des fichiers informatiques et l'occupant des lieux, Madame G., leur a indiqué que les documents relevant de la protection accordée par l'article 66-5 précité étaient susceptibles de se trouver dans les fichiers appréhendés. Dès lors, les enquêteurs ont placé les fichiers retenus sous CD provisoire n° 30 et ont indiqué à l'occupant des lieux qu'une nouvelle réunion, fixée au 23 mars 2016, était retenue pour l'ouverture du CD provisoire et la suppression, le cas échéant, des documents protégés par le secret relevant de la protection avocat-client.
Le 23 mars 2016 une réunion a été organisée entre l'administration et CARREFOUR. Sur la liste de 415 courriels transmise par CARREFOUR le 16 mars 2016, 362 n'avaient pas été retenus en vue d'être saisis et n'avaient donc pas été placés sous le scellé provisoire n° 30, lors des opérations de visite et de saisie. Après avoir procédé à leur authentification numérique, les enquêteurs ont regroupé les messageries informatiques expurgées ainsi que les fichiers informatiques n'ayant pas fait l'objet des expurgations dans un fichier conteneur sécurisé et ont réalisé un inventaire informatique des fichiers informatiques sélectionnés, qu'ils ont gravés et dont ils ont remis une copie aux sociétés du groupe CARREFOUR.
L'argument selon lequel la prise de connaissance par les enquêteurs des documents relevant du privilège légal entrainerait l'annulation des opérations, n'est pas pertinent. En effet, les enquêteurs sont amenés, lors des opérations de visite et de saisies, à visualiser des documents « papiers » et décident ou non de les appréhender et de même, à l'aide du logiciel Encase, utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes - lequel est un logiciel d'investigation et de recherche de preuves cryptées ou effacées directement, avec des mots clés, dans le serveur procèdent à des saisies informatiques permettant, à l'aide de mots discriminants, d'expurger une première fois les correspondances protégées par le privilège légal. La pratique des scellés provisoires offre une seconde garantie pour les sociétés visitées. Aller au delà consisterait à interdire à toute administration ou à toute Autorité administrative indépendante à pratiquer toute forme de saisie.
De surcroît, la prise de connaissance éventuelle par un enquêteur d'un document protégé par l'article 66-5 précité n'a pour effet que l'annulation de ce document et l'interdiction pour l'administration d'en faire état de quelque manière que ce soit, ainsi que le rappelle de manière constante la Haute Juridiction et la CEDH.
Ce moyen sera rejeté.
II - A titre subsidiaire, sur l'impossibilité pour le juge de vérifier, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des saisies des fichiers de messagerie électronique de la régularité de ces dernières.
Il convient de rappeler que la réalisation des inventaires est régie par les dispositions de l'article R. 450-2 du code de commerce, qui mentionne que les procès-verbaux, prévus à l'article L. 450-4 dudit code, relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur le champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.
Il se déduit de cet article et de plusieurs décisions de jurisprudences significatives qu'aucune forme particulière de l'inventaire des pièces et des documents saisis n'est imposée, que celui-ci peut, à titre illustratif, prendre la forme d'une arborescence.
Il est critiqué l'imprécision des inventaires réalisés au cours des opérations du 9 et 10 février 2016 et, lors de la réunion du 23 mars 2016, que cette imprécision ne permettrait pas au second juge de vérifier concrètement la régularité de telles saisies.
Il y a lieu de rappeler qu'il appartient aux sociétés requérantes, qui ont, en leur possession, une copie des documents informatiques saisis d'identifier la pièce relative à la violation du privilège légal, n'entrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance, ou se rapportant à une atteinte à la vie privée pour la soumettre au second juge afin d'obtenir, le cas échéant, son annulation.
S'agissant des inventaires informatiques placés en annexe 3 du second procès-verbal de visite et de saisie, qui ne permettrait pas d'avoir la moindre indication sur le contenu des documents saisis dans les fichiers des messageries électroniques, les 28 fichiers contestés sont, sans aucun doute, des fichiers de messagerie des salariés des sociétés du groupe CARREFOUR et peuvent être identifiés par la première lettre de leur prénom, suivie immédiatement par leur patronyme. De même, le fait que l'inventaire renseigne sur le nom, la taille et le chemin de ces fichiers suffit à les identifier très facilement.
Les sociétés visitées n'identifient pas en quoi ces messageries, qui sont insécables, n'entreraient pas, même en partie, dans le champ d'application de l'ordonnance délivrée par le premier juge.
L'argument selon lequel le caractère insécable des messageries électroniques rendrait a minima nécessaire l'annulation de la saisie de la totalité des fichiers de messagerie listés ci-dessus, n'est pas pertinent dans la mesure où, comme nous l'avons dit précédemment, il appartient à la société visitée d'identifier, de soumettre au juge et d'expliquer en quoi le document litigieux porte atteinte à un secret protégé ou bien serait hors du champ d'application de l'ordonnance délivrée par le JLD, cet examen ayant pour conséquence d'annuler le document contesté et non pas d'annuler l'ensemble des opérations de visite et de saisies.
Ce moyen sera écarté.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort
A titre liminaire :
Écartons des débats la note en délibéré transmise par les sociétés appelantes en date du 22 novembre 2016,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 908 du code de procédure civile
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/11213 ; 16/11138 ; 16/11173 ; 16/11215 ; 16/11263 ; 16/11179 ; 16/11276 (appels) et RG 16/11156 ; 16/11214 ; 16/11292 ; 16/11205 ; 16/11210 ; 16/11270 ; 16/11246 (recours), lesquelles seront regroupées,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention d'ÉVRY en date du 5 février 2016,
Rejetons le recours contre les opérations de visite et de saisies,
Rejetons toute autre demande,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés demanderesses.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karine ABELKALON Philippe FUSARO