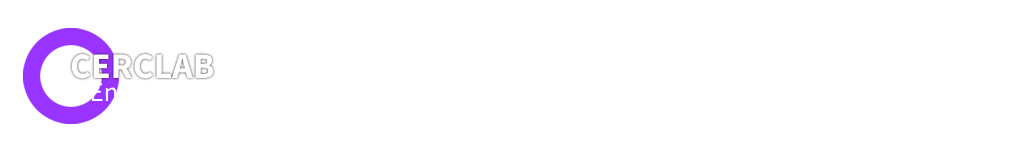9751 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Construction
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 9751 (24 novembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
PRÉSENTATION PAR CONTRAT - CONSTRUCTION
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
A. RELATIONS ENTRE LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET L’ENTREPRENEUR
Annulation de la commande par le maître de l’ouvrage. Absence de preuve que la clause prévoyant qu’en cas d’annulation de la commande le maître de l’ouvrage doit verser une indemnité « consécutive aux frais occasionnés pour la préparation de son projet, de commission de représentation de dommages » crée un déséquilibre significatif, dès lors que, même si elle peut paraître, à certains égards, formulée maladroitement, elle prévoit précisément in fine que cette indemnité « ne pourra être inférieure à 25% du montant du marché ». TJ Saint-Malo (1re ch. civ.), 27 juin 2025 : RG n° 22/00714 ; Cerclab n° 24254 (contrat d’achat et d’installation d’une installation de stockage dans un Gaec ; N. B. le maître de l’ouvrage estimait la clause imprécise). § N.B. Le jugement précise que, comme la clause de dédit ne repose pas sur un préjudice, mais constitue en quelque sorte le prix de l’annulation, il ne peut être reproché au prestataire de ne pas apporter la preuve de la réalité de son préjudice et notamment de ses « frais de commission de représentation de dommages ». Sous l’angle de l’appréciation d’un déséquilibre, l’argument semble conforme au fait que celle-ci se fait en principe à la date de conclusion du contrat, sans tenir compte de l’exécution réelle de celui-ci. Néanmoins, les conditions d’exécution probable du contrat peuvent être prises en compte, ce qui explique notamment que le montant de la clause de dédit est souvent apprécié au regard de la date à laquelle l’exécution est prévue. En l’espèce, le raisonnement aurait mérité d’être creusé et la clause interprétée, compte tenu de sa rédaction. Si le montant de 25 % est un plancher, il est permis de se demander comment est déterminé un chiffre supérieur et il semblerait logique de considérer que l’entrepreneur peut demander plus si justement les frais engagés sont supérieurs. Cela signifierait sinon que le montant est fixé discrétionnairement par ce dernier, ce qui semble source de déséquilibre.
Crée un déséquilibre significatif la combinaison de clauses d’un contrat conclu avec un bureau d’études, dans le cadre d’un projet de construction, dès lors qu’elle fait peser sur ce dernier l’essentiel du risque financier de l’abandon du projet sans que celui-ci n’ait à être particulièrement explicité, la clause de « résiliation-interruption » visant « les raisons techniques, financières administratives, commerciales ou autres », autrement dit pour toutes raisons, sans même que le montant prévisionnel du projet ne soit expressément visé comme une limite impérative ; en ne précisant pas exactement les honoraires du BET au titre de chacune des missions et tranches qui lui incombaient, elle lui fait supporter les risques financiers de l’étude de son projet sans réelle contrepartie à ses missions dont la phase 1 est manifestement plus conséquente que la phase 2, alors qu’en outre, en prévoyant que la rémunération la plus conséquente, celle de la phase 2, est à la charge de l’entreprise de Gros-œuvre, non encore désignée et, en toutes hypothèses, étrangère au contrat, elle fait là aussi supporter le risque de son projet aux tiers. TJ Lyon (ch. 3 cab. 03 D), 28 mars 2024 : RG n° 20/00395 ; Cerclab n° 23116 (contrat d’études techniques pour les structures en béton armé d’un projet de construction).
Délai de contestation du décompte définitif par l’entrepreneur. Ne crée pas un déséquilibre significatif la clause relative aux délais de contestation dès lors que le délai imparti au maître de l'ouvrage pour répondre aux contestations de l'entreprise est de même durée que celui imparti à l'entreprise pour contester le décompte définitif, les parties pouvant choisir de déroger aux dispositions de la norme AFNOR NFP03.001 et de réduire les délais prévus par cette norme. CA Colmar (2e ch. A), 22 novembre 2024 : RG n° 23/02019 ; arrêt n° 478/2024 ; Cerclab n° 23250 (contrat de construction ; la société, professionnelle de la construction, a accepté le CCAP, alors que la réduction les délais ne pouvait lui échapper puisqu'ils sont indiqués en caractères gras et soulignés), confirmant TJ Mulhouse, 12 mai 2023 (Jme) : Dnd.
Ne créent pas de déséquilibre significatif les clauses du CCAP (« cahier des clauses administratives particulières ») relatives aux délais de constatation des droits à paiement, même si elles diffèrent des règles posées par la norme Afnor NF P 03-001, en réduisant de 45 jours à 15 jours le délai de transmission du DGD (« décompte général et définitif ») après la réception des travaux et en dérogeant au principe selon lequel le silence du maître d'ouvrage à l'issue d'un délai de 30 jours vaut acceptation du DGD ; les clauses contestées, qui tendent seulement à renforcer les obligations de l'entreprise dans l'exécution de ses obligations contractuelles et en particulier dans l'achèvement et la conformité de ses travaux, ne sauraient être regardées comme étant un devoir exorbitant qui serait mis à la charge de l'entreprise et pouvant constituer par là même un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ; notamment, la seule circonstance que le délai pour l'entreprise soit de 15 jours pour notifier son DGD alors que celui du maître de l'ouvrage est de 30 jours pour faire connaître ses observations n'apparaît nullement comme constitutif d'un tel déséquilibre eu égard en particulier à la faculté pour le maître de l'ouvrage de disposer d'un temps supérieur à celui de l'entreprise pour vérifier le DGD compte tenu de la multiplicité éventuelle des intervenants sur son marché de travaux. CA Montpellier (ch. com.), 21 mai 2024 : RG n° 22/05099 ; Cerclab n° 23092 (travaux de réalisation du lot gros œuvre d'un immeuble d'habitation ; conséquence sollicitée : clause réputée non écrite et retour à la norme Afnor), sur appel de T. com. Montpellier, 5 septembre 2022 : RG n° 2020012900 ; Dnd. § Le CCAP prévoit classiquement le paiement de situations intermédiaires au profit de l'entreprise au fur et à mesure de l'avancement du chantier, la circonstance que les réserves soient levées pour pouvoir prétendre effectivement au paiement du solde du chantier n'apparaît non plus nullement comme une prérogative exorbitante du maître d'ouvrage. Même arrêt.
B. RELATIONS ENTRE ENTREPRENEURS – SOUS-TRAITANCE
Clause de modification du planning des travaux. Il peut être nécessaire dans le cadre de contrats portant sur la construction d'ouvrage de prévoir une possibilité de modification des plannings en cas d'imprévus dans les conditions d'évolution des conditions de réalisation du chantier ; ne crée pas de déséquilibre significatif la clause des conditions particulières d’un contrat de sous-traitance relative aux délais d'exécution, qui prévoit que les travaux doivent être exécutés dans le délai mentionné aux conditions spéciales à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donnés par l’entrepreneur principal, sauf indication contraire des conditions spéciales, et qui précise que le sous-traitant ne pourra pas s'opposer à une modification des plannings partiels ou globaux qui serait justifiée par des retards à rattraper ou des avances à réduire, des exigences du maître de l'ouvrage ou du maître d’œuvre ou de toute autre cause, dès lors que cette stipulation réserve la possibilité au sous-traitant de contester la modification dans un délai de huit jours, sans quoi celle-ci devient contractuelle, sauf si celles-ci avaient une incidence et pouvaient entraîner une mise en danger. CA Caen (2e ch. civ. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/01120 ; Cerclab n° 9497 (sous-traitance pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures aluminium ; modification portant en l’espèce sur un report de la date d’achèvement de mai 2017 à septembre 2017 ; sous-traitant n’ayant pas fait usage de la faculté qui lui était offerte de contester la modification), sur appel de T. com. Caen, 3 juin 2020 : RG n° 2018/00901 ; Dnd. § N.B. Même si ce n’était pas la situation concernée par l’espèce, la clause analysée par l’arrêt ne peut être validée globalement, sur au moins deux points. Tout d’abord, il semble difficile de traiter identiquement un report des travaux et une avancée de ceux-ci (modification que la clause semble permettre), puisque dans le premier cas, le sous-traitant peut essayer de réaménager son propre planning, alors que cela risque d’être difficile, voire impossible, dans le second. Ensuite, la formule finale « ou toute autre cause » est trop générale, puisqu’elle pourrait englober des modifications imputables à l’entrepreneur principal (ex. suspension du chantier pour non-respect des normes de droit du travail).
Avenants mixtes (modificatifs et transactionnels). Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de travaux, plusieurs avenants autonomes avaient été conclus afin de préciser, au regard du marché initial, les travaux en plus-value et en moins-value, le montant modifié du marché, le nouveau délai contractuel ainsi que les modalités d'exécution de celui-ci. Ils contenaient tous une clause stipulant que « l'entreprise sous-traitante renonce expressément à toute réclamation et recours de quelque nature qu'il soit, amiable ou contentieux, pour tout fait générateur antérieur à la passation du présent avenant qui répute, en outre, régler toutes les conséquences directes ou indirectes de son objet ». Pour justifier l’application de la clause, la cour d’appel ne redresse pas l’argumentation maladroite du sous-traitant en retenant successivement : 1/ sur le fondement de l’art. 1171 C. civ., que le contrat est d’adhésion, mais sans évoquer le fait que l’acceptation de cette clause avait été compensée par des renonciations de l’entrepreneur principal ; 2/ sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com. – alors que la cour d’appel n’a pas compétence pour examiner ce texte – que, compte tenu des renonciations précitées pour régler des différends, les avenants avaient été négociés et ne créaient pas de déséquilibre significatif ; 3/ que la preuve d’une imposition de la clause en violation de l’art. 1143 C. civ. n’est pas établie. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 21 février 2025 : RG n° 21/01688 ; arrêt n° 2025/39 ; Cerclab n° 23485 (contrat de sous-traitance du lot peinture), sur appel de T. com. Marseille, 25 novembre 2020 : RG n° 2019F00992 ; Dnd