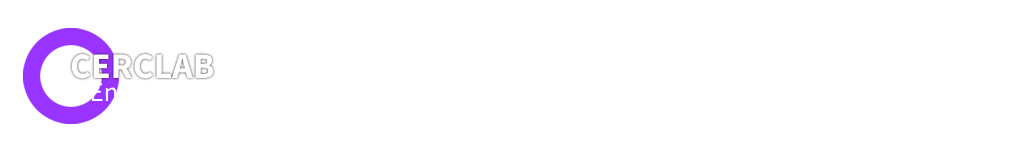CASS. COM., 18 octobre 2016
 CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 3 décembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 6552
CASS. COM., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 15-13834 ; arrêt n° 878
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-13834. Arrêt n° 878.
DEMANDEUR à la cassation : Société Carrefour France - Société Carrefour administratif France
DÉFENDEUR à la cassation : Ministre chargé de l’économie
Mme Mouillard (président), président. SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 avril 2014 et 3 décembre 2014), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-21743), que, reprochant à la société Carrefour administratif France la rupture partielle de relations commerciales établies avec la société Cofim, mise en liquidation judiciaire, M. X., désigné en qualité de liquidateur, l’a poursuivie sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; que la société Carrefour France est intervenue à l’instance ; que le ministre chargé de l’économie est également intervenu pour demander, par conclusions, la condamnation solidaire des sociétés Carrefour administratif et Carrefour France (les sociétés Carrefour) au paiement d’une amende civile pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ; que sa demande ayant été rejetée, il a, par conclusions, déclaré former appel incident et renouvelé sa demande ; que l’arrêt de la cour d’appel a été cassé, mais seulement en ce qu’il déclarait recevable l’intervention du ministre et irrecevable sa demande en paiement d’une amende civile ; qu’à la suite de la saisine par le ministre de la cour de renvoi, les sociétés Carrefour ont saisi d’un incident le conseiller de la mise en état, lequel a déclaré recevable la saisine du ministre, ainsi que son appel incident provoqué ; que la cour d’appel de renvoi a, par un premier arrêt, rejeté le déféré de l’ordonnance et, par un second arrêt statuant au fond, déclaré recevables l’action et les conclusions du ministre et condamné les sociétés Carrefour au paiement d’une amende civile ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l’arrêt du 9 avril 2014 de rejeter leur déféré de l’ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que l’appel incident peut émaner d’une personne, même non intimée, qui a été partie en première instance, pour autant qu’il intervient sur l’appel principal ou incident qui l’a provoqué ; que cette personne doit dès lors établir, pour justifier la recevabilité de son appel provoqué, que la survenance de l’appel principal ou incident était susceptible de « modifier sa situation », créant ainsi pour elle « un intérêt nouveau à user d’une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, elle n’avait pas cru à propos d’exercer » ; que, pour justifier la recevabilité de l’appel prétendument provoqué du ministre de l’économie, qui n’a pas interjeté appel principal contre le jugement du 6 novembre 2009, et qui n’était pas intimé, le juge de la mise en état a retenu que « le ministre de l’économie et des finances a intérêt à agir et à former un appel provoqué pour critiquer un chef de dispositif du jugement du tribunal de commerce qui lui cause un grief et qui n ‘a pas été critiqué par l’appel principal » ; qu’en tirant ainsi l’intérêt à agir du ministre, non pas des effets nouveaux supposément provoqués par l’appel principal, mais des seuls chefs du dispositif du jugement qui lui faisaient grief, et contre lesquels il avait eu la faculté, non exercée, d’interjeter un appel principal, la cour d’appel, à supposer qu’elle ait adopté ces motifs, a violé les articles 548 et 549 du code de procédure civile ;
2°/ que l’appel incident peut émaner d’une personne, même non intimée, qui a été partie en première instance, pour autant qu’il intervient sur l’appel principal ou incident qui l’a provoqué ; qu’ainsi que l’a relevé la cour d’appel, l’appel du ministre de l’économie - qui n’était ni appelant principal ni intimé - n’était « recevable que si l’appel principal ou l’appel incident éventuel l’ont provoqué, remettant en cause [ses] droits et lui donnant ainsi un intérêt nouveau alors qu’il n’avait pas cru utile de faire un recours » ; que l’appel provoqué suppose ainsi deux intérêts chronologiquement distincts, celui qui était révélé par le dispositif du jugement rendu, qui est un intérêt « ancien » au stade de la procédure, et celui qui est causé par l’appel principal ou par un appel incident, et qui est l’intérêt « nouveau », l’intérêt « ancien » ne pouvant donner lieu qu’à un appel principal, ou à un appel incident formé par un intimé ; qu’ainsi, l’appel provoqué ne peut être justifié par l’intérêt « ancien » qu’il y avait à interjeter un appel principal dès lors que la personne concernée a jugé que cet intérêt-là ne justifiait pas cet appel ou qu’elle l’a négligé, sauf à lui permettre à d’interjeter, hors les conditions légales, un appel de substitution ; que pour juger que le prétendu appel provoqué du ministre était recevable, la cour d’appel s’est bornée à retenir que, défenseur de l’ordre public économique dans un litige portant sur une éventuelle rupture brutale des relations commerciales, il pouvait être partie dans la procédure d’appel ; que, cependant, l’intérêt du ministre, qui intervenait en appel pour obtenir la même condamnation, sur le même fondement et les mêmes motifs qu’en première instance, ne se distinguait pas de celui qu’il avait eu à former, au regard du dispositif du jugement du 6 novembre 2009, un appel principal qu’il a renoncé à exercer ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, et comme elle le devait en toute hypothèse en vertu de la loi, si le ministre, non appelant principal et non intimé, justifiait la recevabilité de son appel par l’existence d’un intérêt réellement nouveau, provoqué par l’appel principal, à user d’une voie de recours que, jusque-là, il n’avait pas cru à propos d’exercer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 548 et 549 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en jugeant ainsi que le seul rôle du ministre de l’économie défendant l’ordre public économique suffisait « pour ce seul motif » à justifier la recevabilité de son appel et à satisfaire aux règles de la procédure civile, au motif qu’était en cause une possible rupture brutale de relations commerciales, quand ledit ministre, qui ne justifiait d’aucun intérêt nouveau, n’avait pas jugé utile d’interjeter appel du jugement l’ayant débouté de ses demandes, la cour d’appel, qui l’a ainsi arbitrairement dispensé de satisfaire aux conditions légales de l’appel provoqué, a violé les articles 548 et 549 du code de procédure civile, ensemble l’article 16 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt constate que le ministre, qui agit pour la défense de l’ordre public économique, peut être partie dans la procédure d’appel au cours de laquelle les sociétés Carrefour entendent remettre en cause la décision qui les a condamnées pour rupture brutale des relations commerciales ; qu’en l’état de ces seules constatations, dont elle a déduit l’intérêt nouveau pour le ministre à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas exercée, la cour d’appel, qui n’a pas adopté les motifs de l’ordonnance du conseiller de la mise en état critiqués par la première branche, a exactement retenu que le ministre était recevable en son appel incident provoqué ; que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l’arrêt du 3 décembre 2014 de déclarer recevable l’action et les conclusions du ministre chargé de l’économie et de les condamner à payer, in solidum, une amende civile d’un montant de 100.000 euros alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 avril 2014 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt rendu par la même cour le 3 décembre 2014 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Sur le troisième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les sociétés Carrefour font le même grief à l’arrêt du 3 décembre 2014 alors, selon le moyen :
1°/ que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés ; que pour conclure que l’action du ministre de l’économie et sa demande étaient recevables, la cour d’appel a retenu que, disposant d’un droit propre à agir, ce dernier avait présenté devant les premiers juges une demande de condamnation des sociétés Carrefour au paiement d’une amende civile, de sorte qu’ayant qualité de partie à l’instance, il « [pouvait], en conséquence, par la voie de l’appel incident, demander à la cour d’appel de réformer le jugement en ce que celui-ci a rejeté sa demande civile » ; qu’en se déterminant ainsi, quand le ministre n’avait pas la qualité d’intimé, l’appelant, Maître X., n’ayant interjeté appel du jugement qu’à l’encontre des sociétés Carrefour, la cour d’appel a violé les articles 548 et 554 du code de procédure civile ;
2°/ que l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; que la recevabilité d’une telle forme d’appel incident requiert cependant que celui qui s’en prévaut établisse que son appel a été effectivement provoqué par l’appel principal, lequel a fait naître un « intérêt nouveau à user d’une voie de recours que, dans des conditions jusque là différentes, il n’avait pas cru à propos d’exercer » ; qu’à supposer que la cour d’appel ait entendu se référer à cette forme particulière d’appel incident -ce que rien, dans sa décision, ne permet d’établir- elle ne pouvait juger qu’elle était recevable sans avoir constaté la réalité d’un intérêt nouveau à agir, provoqué par l’appel principal ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, sans opérer ce constat nécessaire, la cour d’appel a en toute hypothèse violé les dispositions de l’article 549 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la recevabilité de l’appel ayant été tranchée par l’arrêt du 9 avril 2014, le moyen, en ce qu’il reproche à l’arrêt du 3 décembre 2014 de déclarer l’appel recevable, est inopérant ;
Et sur le quatrième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les sociétés Carrefour font enfin grief à l’arrêt du 3 décembre 2014 de les condamner in solidum à payer une amende civile alors, selon le moyen :
1°/ qu’en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l’arrêt critiqué du chef du troisième moyen, relatif à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le ministre de l’économie, entraînera, par voie de conséquence, cassation de cet arrêt du chef de l’amende civile que ledit ministre a demandée et obtenu sur le fondement de cet appel irrecevable ;
2°/ que l’amende civile est, selon les termes du Conseil constitutionnel, une « sanction ayant le caractère d’une punition », ce pourquoi elle doit « respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 », au rang desquelles figure notamment le principe de légalité des délits et des peines ; que cette peine suppose, chez celui auquel elle est infligée, la commission d’une acte illégal volontaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’en fixant le préavis à 15 mois au lieu de 20 mois, la société Carrefour avait seulement « minimisé la durée du préavis raisonnable », sans « faire preuve d’aucune déloyauté particulière à l’égard de son partenaire », et sans chercher aucun avantage disproportionné, ce qui excluait toute faute punissable ; qu’elle a également relevé que les « faits de l’espèce » n’avaient rien à voir avec un « usage abusif du pouvoir de marché de Carrefour sur un partenaire », et qu’ils n’étaient « nullement caractérisés par un abus de puissance de marché », ce qui excluait tout comportement nuisible susceptible d’être imité au détriment du marché ; qu’en jugeant dès lors que les sociétés Carrefour devaient être punies, pour cette fixation du préavis à 15 mois, d’une amende civile à un niveau suffisamment dissuasif et frappant l’effet d’entraînement que pouvait avoir leur comportement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 442-6 du code de commerce ;
3°/ qu’en retenant, pour juger que les conditions de préavis de la rupture, fixées par erreur et sans déloyauté à une durée de 15 au lieu de 20 mois, justifiaient l’infliction aux sociétés Carrefour d’une amende civile « dissuasive », c’est-à-dire importante, que la liquidation de la société Cofim n’était pas sans lien avec la perte d’un partenaire avec lequel elle entretenait 75 % de son chiffre d’affaires, sans justifier en quoi la durée jugée trop courte du préavis avait pu avoir une incidence quelconque sur le sort de cette société, qui, en règlement judiciaire, avait elle-même choisi d’y mettre un terme anticipé le 5 septembre 2006 pour demander sa liquidation judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du troisième moyen rend le grief de la première branche sans portée ;
Et attendu, en second lieu, que c’est sans méconnaître les conséquences de ses constatations que la cour d’appel, après avoir constaté la gravité modérée et l’effet limité de la pratique retenue, les sociétés Carrefour ayant seulement réduit la durée du préavis raisonnable, ce dont elle a déduit que la liquidation de la société Cofim, sans être dépourvue de lien avec la perte d’un partenaire avec lequel elle réalisait 75 % de son chiffre d’affaires, ne pouvait être attribuée exclusivement à la rupture litigieuse, et relevé que les faits ne caractérisaient pas un abus de puissance de marché, a retenu qu’il y avait lieu, cependant, de prendre en considération l’importance du chiffre d’affaires des sociétés Carrefour et l’effet d’entraînement que peut avoir le comportement de sociétés de leur taille et de leur notoriété sur les autres opérateurs économiques, et prononcé une amende civile dont elle a apprécié souverainement le montant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour France et la société Carrefour administratif France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au ministre de l’économie et des finances la somme globale de 3.000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour France et Carrefour administratif France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué du 9 avril 2014 D’AVOIR rejeté le déféré dirigé par les sociétés CARREFOUR contre l’ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par le conseiller de la mise en état ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE la recevabilité de l’« appel incident » du ministre du 15 avril 2010 est contestée par les sociétés CARREFOUR, demanderesses au déféré ; que, selon les termes des articles 549 et 550 du Code de procédure civile, ce dernier texte, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2011, l’appel incident peut émaner, sur appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance et que cet appel incident peut être formé en tout état de cause ; que le ministre est partie à l’instance et qu’il peut en cette qualité faire appel incident ; que, toutefois, ce recours n’est recevable que si l’appel principal ou l’appel incident éventuel l’ont provoqué, remettant en cause les droits du ministre et lui donnant ainsi un intérêt nouveau alors qu’il n’avait pas cru utile de faire un recours ; que le ministre qui agit pour la défense de l’ordre public économique peut être partie dans la procédure d’appel au cours de laquelle les sociétés CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE entendent remettre en cause la décision qui les a condamnées pour rupture brutale des relations commerciales ; que, pour ce seul motif, le ministre est recevable en son appel incident provoqué, qu’il s’agit ici non de reconnaître à celui-ci une prérogative dépassant le droit commun mais d’appliquer les règles de procédure civile, ce qui ne saurait remettre en cause le principe du procès équitable ;
ET AUX MOTIFS POSSIBLEMENT ADOPTÉS QUE, selon les pièces de la procédure, le ministre de l’économie et des finances a régulièrement saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation ; qu’exerçant son droit propre et ayant demandé en première instance, par voie de conclusions déposées au visa de l’article L. 470-5 du même code, la condamnation des sociétés CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE au paiement d’une amende civile pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce, il est intervenant à titre principal sur le fondement de ce texte et a la qualité de partie à l’instance ; qu’aux termes de l’article 549 du code de procédure civile « l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance » ; qu’il en résulte que l’appel provoqué, qui est une forme d’appel incident, peut être formé par une personne même non intimée par l’appel principal dès lors qu’elle a été partie en première instance ; qu’en conséquence, le ministre peut, par la voie de l’appel incident, demander à la cour d’appel de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le ministre, qui était partie à l’instance devant le tribunal de commerce, n’a pas formé appel principal contre le jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 2009 ; qu’en revanche, il a, conformément à l’article 551 du code de procédure civile, formé un appel incident par conclusions déposées le 15 avril 2010, puis le 20 juin 2013 devant la cour de renvoi ; qu’il a intérêt à agir et à former un appel provoqué pour critiquer un chef du dispositif du jugement du tribunal de commerce qui lui cause un grief et qui n’a pas été critiqué par l’appel principal ; que l’exigence que l’appel provoqué découle de l’appel qui le provoque et qui modifie la situation de la partie, ne s’applique que lorsque l’appel provoqué émane de l’appelant principal et a pour finalité d’éviter que ce dernier ne fasse un second appel principal hors délai ; que le ministre, qui était partie à l’instance devant le tribunal de commerce, a régulièrement déposé des conclusions d’appel incident devant la cour d’appel, en application des règles du code de procédure civile applicables à tous les justiciables ; qu’en conséquence, son appel incident doit être déclaré recevable ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE l’appel incident peut émaner d’une personne, même non intimée, qui a été partie en première instance, pour autant qu’il intervient sur l’appel principal ou incident qui l’a provoqué ; que cette personne doit dès lors établir, pour justifier la recevabilité de son appel provoqué, que la survenance de l’appel principal ou incident était susceptible de « modifier sa situation », créant ainsi pour elle « un intérêt nouveau à user d’une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, elle n’avait pas cru à propos d’exercer » ; que, pour justifier la recevabilité de l’appel prétendument provoqué du ministre de l’économie, qui n’a pas interjeté appel principal contre le jugement du 6 novembre 2009, et qui n’était pas intimé, le juge de la mise en état a retenu que « le ministre de l’économie et des finances a intérêt à agir et à former un appel provoqué pour critiquer un chef de dispositif du jugement du tribunal de commerce qui lui cause un grief et qui n’a pas été critiqué par l’appel principal » ; qu’en tirant ainsi l’intérêt à agir du ministre, non pas des effets nouveaux supposément provoqués par l’appel principal, mais des seuls chefs du dispositif du jugement qui lui faisaient grief, et contre lesquels il avait eu la faculté, non exercée, d’interjeter un appel principal, la cour, à supposer qu’elle ait adopté ces motifs, a violé les articles 548 et 549 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l’appel incident peut émaner d’une personne, même non intimée, qui a été partie en première instance, pour autant qu’il intervient sur l’appel principal ou incident qui l’a provoqué ; qu’ainsi que l’a relevé la cour, l’appel du ministre de l’économie – qui n’était ni appelant principal ni intimé – n’était « recevable que si l’appel principal ou l’appel incident éventuel l’ont provoqué, remettant en cause [ses] droits et lui donnant ainsi un intérêt nouveau alors qu’il n’avait pas cru utile de faire un recours » ; que l’appel provoqué suppose ainsi deux intérêts chronologiquement distincts, celui qui était révélé par le dispositif du jugement rendu, qui est un intérêt « ancien » au stade de la procédure, et celui qui est causé par l’appel principal ou par un appel incident, et qui est l’intérêt « nouveau », l’intérêt « ancien » ne pouvant donner lieu qu’à un appel principal, ou à un appel incident formé par un intimé ; qu’ainsi, l’appel provoqué ne peut être justifié par l’intérêt « ancien » qu’il y avait à interjeter un appel principal dès lors que la personne concernée a jugé que cet intérêt-là ne justifiait pas cet appel ou qu’elle l’a négligé, sauf à lui permettre à d’interjeter, hors les conditions légales, un appel de substitution ; que pour juger que le prétendu appel provoqué du ministre était recevable, la cour s’est bornée à retenir que, défenseur de l’ordre public économique dans un litige portant sur une éventuelle rupture brutale des relations commerciales, il pouvait être partie dans la procédure d’appel ; que, cependant, l’intérêt du ministre, qui intervenait en appel pour obtenir la même condamnation, sur le même fondement et les mêmes motifs qu’en première instance, ne se distinguait pas de celui qu’il avait eu à former, au regard du dispositif du jugement du 6 novembre 2009, un appel principal qu’il a renoncé à exercer ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, et comme elle le devait en toute hypothèse en vertu de la loi, si le ministre, non appelant principal et non intimé, justifiait la recevabilité de son appel par l’existence d’un intérêt réellement nouveau, provoqué par l’appel principal, à user d’une voie de recours que, jusque-là, il n’avait pas cru à propos d’exercer, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 548 et 549 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU’en jugeant ainsi que le seul rôle du ministre de l’économie défendant l’ordre public économique suffisait [« pour ce seul motif » (p. 5, § 6)] à justifier la recevabilité de son appel et à satisfaire aux règles de la procédure civile, au motif qu’était en cause une possible rupture brutale de relations commerciales, quand ledit ministre, qui ne justifiait d’aucun intérêt nouveau, n’avait pas jugé utile d’interjeter appel du jugement l’ayant débouté de ses demandes, la cour, qui l’a ainsi arbitrairement dispensé de satisfaire aux conditions légales de l’appel provoqué, a violé les articles 548 et 549 du code de procédure civile, ensemble l’article 16 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué du 3 décembre 2014 d’AVOIR déclaré recevable l’action et les conclusions du ministre chargé de l’économie et infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 novembre 2009 en ce qu’il avait débouté ce dernier de sa demande d’amende civile et, statuant à nouveau de ce chef, condamné les sociétés CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE à payer, in solidum, une amende civile d’un montant de 100.000 euros ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le ministre de l’économie a, exerçant un droit propre que lui confère l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, demandé devant les premiers juges par voie de conclusions déposées au visa de l’article L. 470-5 de ce code, la condamnation des sociétés CARREFOUR au paiement d’une amende civile pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° ; que le ministre a donc la qualité de partie à l’instance et peut, en conséquence, par la voie de l’appel incident, demander à la cour d’appel de réformer le jugement en ce que celui-ci a rejeté sa demande civile ; qu’il y a donc lieu de déclarer recevable l’action du ministre, ainsi que sa demande ; que les sociétés CARREFOUR prétendent d’une part, que l’action du ministre ne relèverait pas de la défense de l’ordre public économique mais se limiterait à la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, et d’autre part, que le ministre devrait prouver les effets de la rupture sur la concurrence pour pouvoir demander et obtenir une amende civile ; que l’article L. 442-6 III du code de commerce précise que le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent « demander le prononcé, d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées » ; qu’aux termes de sa décision du 13 mai 2011 (déc. n° 2011-126 QPC), le Conseil constitutionnel a confirmé « que, conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu’il s’assigne en matière d’ordre public dans l’équilibré des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement » ; que, en premier lieu, les pratiques de rupture brutale des relations commerciales font partie des pratiques énumérées à l’article L. 442-6 du code de commerce, pour lesquelles est prévue la faculté, pour le ministre de l’économie, de demander au juge le prononcé d’une amende civile, ces pratiques faisant partie de la rubrique « les pratiques restrictives de concurrence » du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ; que les premiers juges ne pouvaient donc indiquer « qu’il n’est nullement établi qu’en rompant ses relations commerciales avec COFIM, CARREFOUR se soit livré à une pratique restrictive de concurrence » ; qu’en deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a bien précisé, dans la décision citée plus haut, que l’action du ministre de l’économie tend à préserver l’ordre public économique lorsqu’il demande le prononcé d’une amende civile ; qu’il ne fait aucune distinction entre l’action du ministre chargé de l’économie et l’action du ministère public, en ce qui concerne cet objectif de protection de l’ordre public économique ; qu’en troisième lieu, les pratiques restrictives sont présumées porter atteinte au marché, sans qu’il soit requis de démontrer qu’elles ont effectivement affecté ce marché ; que, toutefois, la faculté, pour le ministre, de demander au juge le prononcé d’une amende civile est laissée à son appréciation, selon le principe d’opportunité des poursuites ; qu’il appartient ensuite au juge saisi d’apprécier, au cas par cas, d’une part s’il y a lieu de prononcer une amende civile et, d’autre part, quel quantum de sanction doit être fixé ; qu’en effet, s’agissant du principe même de l’amende civile, qu’il serait contraire au principe d’individualisation des peines qu’une sanction civile soit automatiquement prononcée en cas de pratiques restrictives de concurrence ; que cette appréciation doit être effectuée au cas par cas, nulle peine automatique ne pouvant résulter d’un texte ; que, s’agissant des critères à prendre en considération pour la fixation du quantum, l’amende civile doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives prohibées, ainsi qu’à éviter leur réitération ; que la gravité du comportement en cause et le dommage à l’économie en résultant doivent donc être pris en compte, ainsi que la situation individuelle de l’entreprise poursuivie, en vertu du principe d’individualisation des peines ; qu’en l’espèce, la pratique reprochée aux sociétés CARREFOUR consiste en une rupture brutale des relations commerciales avec la société COFIM, avec laquelle elles entretenaient un partenariat depuis 17 ans ; que les sociétés CARREFOUR ont octroyé à la société COFIM un préavis de rupture de 15 mois, alors que le préavis contractuel était fixé à une durée de trois mois ; que les premiers juges, approuvés par la cour d’appel de Paris, ont porté à 20 mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée par CARREFOUR ; que, compte tenu de ces éléments, la gravité de cette pratique, au regard du trouble à l’ordre public, est modérée, la société CARREFOUR n’ayant fait preuve d’aucune déloyauté particulière à l’égard de son partenaire et ayant seulement minimisé la durée du préavis raisonnable ; que, s’agissant de l’effet des pratiques, que si la liquidation de la société COFIM n’est pas sans lien avec la perte d’un partenaire avec lequel elle entretenait 75 % de son chiffre d’affaires, la responsabilité ne peut en être exclusivement attribuée à la pratique de rupture litigieuse ; qu’en effet, il a été souligné par le précédent arrêt de la cour d’appel que la société COFIM avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 1999, soit antérieurement à la pratique en cause ; que le contexte général du secteur concerné, où la société COFIM a dû faire face à la concurrence d’avancées technologiques, doit être également pris en compte ; qu’en définitive, la sortie du marché de la société COFIM n’est pas entièrement imputable aux sociétés CARREFOUR ; que, de plus, au vu des éléments dont dispose la cour, il semble que cette société opérait sur le marché des sociétés « panéliste » et que ce marché soit caractérisé par la présence de nombreuses sociétés ; que la variété et l’importance de l’offre de ce marché ne sont donc pas affectées par la pratique litigieuse ; qu’enfin, compte tenu du chiffre d’affaires de la société COFIM, de l’ordre de 3 millions d’euros, le marché concerné .est très faiblement affecté par sa disparition ; qu’il y a lieu cependant de prendre en considération la nécessité de fixer l’amende à un niveau suffisamment dissuasif, ce qui exige de tenir compte de l’importance du chiffre d’affaires des sociétés CARREFOUR ; qu’il y a lieu également de prendre en considération l’effet d’entraînement que peut avoir le comportement de sociétés de la taille et de la notoriété de CARREFOUR sur les autres opérateurs économiques ; que le ministre de l’économie verse aux débats un certain nombre d’arrêts de cours d’appel ayant prononcé des amendes, pour des pratiques de rupture brutale, et, notamment un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 février 2010 (07/00606), qui a infligé une amende de 150.000 € à la société CARREFOUR ; que cependant, la pratique en cause consistait, pour cette dernière, à avoir obtenu d’un partenaire des avantages manifestement disproportionnés, contrairement à l’article L. 442-6-I-2 du code de commerce ; que les circonstances de l’affaire, caractérisées par l’usage abusif du pouvoir de marché de CARREFOUR sur un partenaire, et la nature même de la pratique restrictive en cause, ne sont pas comparables aux faits de l’espèce, nullement caractérisés par un abus de puissance de marché ; qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner les sociétés CARREFOUR à payer une amende civile de 100.000 euros ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU’en application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 avril 2014 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt rendu par la même cour le 3 décembre 2014 ;
TROISIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué du 3 décembre 2014 d’AVOIR déclaré recevable l’action et les conclusions du ministre chargé de l’économie ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le ministre de l’économie a, exerçant un droit propre que lui confère l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, demandé devant les premiers juges par voie de conclusions déposées au visa de l’article L. 470-5 de ce code, la condamnation des sociétés CARREFOUR au paiement d’une amende civile pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° ; que le ministre a donc la qualité de partie à l’instance et peut, en conséquence, par la voie de l’appel incident, demander à la cour d’appel de réformer le jugement en ce que celui-ci a rejeté sa demande civile ; qu’il y a donc lieu de déclarer recevable l’action du ministre, ainsi que sa demande ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QUE l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés ; que pour conclure que l’action du ministre de l’économie et sa demande étaient recevables, la cour a retenu que, disposant d’un droit propre à agir, ce dernier avait présenté devant les premiers juges une demande de condamnation des sociétés CARREFOUR au paiement d’une amende civile, de sorte qu’ayant qualité de partie à l’instance, il « [pouvait], en conséquence, par la voie de l’appel incident, demander à la cour d’appel de réformer le jugement en ce que celui-ci a rejeté sa demande civile » ; qu’en se déterminant ainsi, quand le ministre n’avait pas la qualité d’intimé, l’appelant, Maître X., n’ayant interjeté appel du jugement qu’à l’encontre des sociétés CARREFOUR, la cour a violé les articles 548 et 554 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; que la recevabilité d’une telle forme d’appel incident requiert cependant que celui qui s’en prévaut établisse que son appel a été effectivement provoqué par l’appel principal, lequel a fait naître un « intérêt nouveau à user d’une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, il n’avait pas cru à propos d’exercer » ; qu’à supposer que la cour ait entendu se référer à cette forme particulière d’appel incident – ce que rien, dans sa décision, ne permet d’établir - elle ne pouvait juger qu’elle était recevable sans avoir constaté la réalité d’un intérêt nouveau à agir, provoqué par l’appel principal ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, sans opérer ce constat nécessaire, la cour a en toute hypothèse violé les dispositions de l’article 549 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué du 3 décembre 2014 D’AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 novembre 2009 en ce qu’il avait débouté ce dernier de sa demande d’amende civile et, statuant à nouveau de ce chef, d’AVOIR condamné les sociétés CARREFOUR FRANCE et CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE à payer, in solidum, une amende civile d’un montant de 100.000 euros ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les sociétés CARREFOUR prétendent d’une part, que l’action du ministre ne relèverait pas de la défense de l’ordre public économique mais se limiterait à la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence, et d’autre part, que le ministre devrait prouver les effets de la rupture sur la concurrence pour pouvoir demander et obtenir une amende civile ; que l’article L. 442-6 III du code de commerce précise que le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent « demander le prononcé, d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées » ; qu’aux termes de sa décision du 13 mai 2011 (déc. n° 2011-126 QPC), le Conseil constitutionnel a confirmé « que, conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu’il s’assigne en matière d’ordre public dans l’équilibré des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d’assortir la violation de certaines obligations d’une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement » ; que, en premier lieu, les pratiques de rupture brutale des relations commerciales font partie des pratiques énumérées à l’article L. 442-6 du code de commerce, pour lesquelles est prévue la faculté, pour le ministre de l’économie, de demander au juge le prononcé d’une amende civile, ces pratiques faisant partie de la rubrique « les pratiques restrictives de concurrence » du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ; que les premiers juges ne pouvaient donc indiquer « qu’il n’est nullement établi qu’en rompant ses relations commerciales avec COFIM, CARREFOUR se soit livré à une pratique restrictive de concurrence » ; qu’en deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a bien précisé, dans la décision citée plus haut, que l’action du ministre de l’économie tend à préserver l’ordre public économique lorsqu’il demande le prononcé d’une amende civile ; qu’il ne fait aucune distinction entre l’action du ministre chargé de l’économie et l’action du ministère public, en ce qui concerne cet objectif de protection de l’ordre public économique ; qu’en troisième lieu, les pratiques restrictives sont présumées porter atteinte au marché, sans qu’il soit requis de démontrer qu’elles ont effectivement affecté ce marché ; que, toutefois, la faculté, pour le ministre, de demander au juge le prononcé d’une amende civile est laissée à son appréciation, selon le principe d’opportunité des poursuites ; qu’il appartient ensuite au juge saisi d’apprécier, au cas par cas, d’une part s’il y a lieu de prononcer une amende civile et, d’autre part, quel quantum de sanction doit être fixé ; qu’en effet, s’agissant du principe même de l’amende civile, qu’il serait contraire au principe d’individualisation des peines qu’une sanction civile soit automatiquement prononcée en cas de pratiques restrictives de concurrence ; que cette appréciation doit être effectuée au cas par cas, nulle peine automatique ne pouvant résulter d’un texte ; que, s’agissant des critères à prendre en considération pour la fixation du quantum, l’amende civile doit viser à prévenir et dissuader les pratiques restrictives prohibées, ainsi qu’à éviter leur réitération ; que la gravité du comportement en cause et le dommage à l’économie en résultant doivent donc être pris en compte, ainsi que la situation individuelle de l’entreprise poursuivie, en vertu du principe d’individualisation des peines ; qu’en l’espèce, la pratique reprochée aux sociétés CARREFOUR consiste en une rupture brutale des relations commerciales avec la société COFIM, avec laquelle elles entretenaient un partenariat depuis 17 ans ; que les sociétés CARREFOUR ont octroyé à la société COFIM un préavis de rupture de 15 mois, alors que le préavis contractuel était fixé à une durée de trois mois ; que les premiers juges, approuvés par la cour d’appel de Paris, ont porté à 20 mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée par CARREFOUR ; que, compte tenu de ces éléments, la gravité de cette pratique, au regard du trouble à l’ordre public, est modérée, la société CARREFOUR n’ayant fait preuve d’aucune déloyauté particulière à l’égard de son partenaire et ayant seulement minimisé la durée du préavis raisonnable ; que, s’agissant de l’effet des pratiques, que si la liquidation de la société COFIM n’est pas sans lien avec la perte d’un partenaire avec lequel elle entretenait 75 % de son chiffre d’affaires, la responsabilité ne peut en être exclusivement attribuée à la pratique de rupture litigieuse ; qu’en effet, il a été souligné par le précédent arrêt de la cour d’appel que la société COFIM avait déjà fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 1999, soit antérieurement à la pratique en cause ; que le contexte général du secteur concerné, où la société COFIM a dû faire face à la concurrence d’avancées technologiques, doit être également pris en compte ; qu’en définitive, la sortie du marché de la société COFIM n’est pas entièrement imputable aux sociétés CARREFOUR ; que, de plus, au vu des éléments dont dispose la cour, il semble que cette société opérait sur le marché des sociétés « panéliste » et que ce marché soit caractérisé par la présence de nombreuses sociétés ; que la variété et l’importance de l’offre de ce marché ne sont donc pas affectées par la pratique litigieuse ; qu’enfin, compte tenu du chiffre d’affaires de la société COFIM, de l’ordre de 3 millions d’euros, le marché concerné est très faiblement affecté par sa disparition ; qu’il y a lieu cependant de prendre en considération la nécessité de fixer l’amende à un niveau suffisamment dissuasif, ce qui exige de tenir compte de l’importance du chiffre d’affaires des sociétés CARREFOUR ; qu’il y a lieu également de prendre en considération l’effet d’entraînement que peut avoir le comportement de sociétés de la taille et de la notoriété de CARREFOUR sur les autres opérateurs économiques ; que le ministre de l’économie verse aux débats un certain nombre d’arrêts de cours d’appel ayant prononcé des amendes, pour des pratiques de rupture brutale, et, notamment un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 février 2010 (07/00606), qui a infligé une amende de 150 000 € à la société CARREFOUR ; que cependant, la pratique en cause consistait, pour cette dernière, à avoir obtenu d’un partenaire des avantages manifestement .disproportionnés, contrairement à l’article L. 442-6-I-2 du code de commerce ; que les circonstances de l’affaire, caractérisées par l’usage abusif du pouvoir de marché de CARREFOUR sur un partenaire, et la nature même de la pratique restrictive en cause, ne sont pas comparables aux faits de l’espèce, nullement caractérisés par un abus de puissance de marché ; qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner les sociétés CARREFOUR à payer une amende civile de 100.000 euros ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1° ALORS QU’en application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l’arrêt critiqué du chef du troisième moyen, relatif à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le ministre de l’économie, entraînera, par voie de conséquence, cassation de cet arrêt du chef de l’amende civile que ledit ministre a demandée et obtenu sur le fondement de cet appel irrecevable ;
2° ALORS QUE l’amende civile est, selon les termes du Conseil constitutionnel, une « sanction ayant le caractère d’une punition », ce pourquoi elle doit « respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 », au rang desquelles figure notamment le principe de légalité des délits et des peines ; que cette peine suppose, chez celui auquel elle est infligée, la commission d’une acte illégal volontaire ; qu’en l’espèce, la cour a relevé qu’en fixant le préavis à 15 mois au lieu de 20 mois, la société CARREFOUR avait seulement « minimisé la durée du préavis raisonnable », sans « faire preuve d’aucune déloyauté particulière à l’égard de son partenaire », et sans chercher aucun avantage disproportionné, ce qui excluait toute faute punissable ; qu’elle a également relevé que les « faits de l’espèce » n’avaient rien à voir avec un « usage abusif du pouvoir de marché de Carrefour sur un partenaire », et qu’ils n’étaient « nullement caractérisés par un abus de puissance de marché » (arrêt, p. 7, § 4), ce qui excluait tout comportement nuisible susceptible d’être imité au détriment du marché ; qu’en jugeant dès lors que les sociétés CARREFOUR devaient être punies, pour cette fixation du préavis à 15 mois, d’une amende civile à un niveau suffisamment dissuasif et frappant l’effet d’entraînement que pouvait avoir leur comportement, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 442-6 du code de commerce ;
3° ALORS QU’en retenant, pour juger que les conditions de préavis de la rupture, fixées par erreur et sans déloyauté à une durée de 15 au lieu de 20 mois, justifiaient l’infliction aux sociétés CARREFOUR d’une amende civile « dissuasive », c’est-à-dire importante, que la liquidation de la société COFIM n’était pas sans lien avec la perte d’un partenaire avec lequel elle entretenait 75 % de son chiffre d’affaires, sans justifier en quoi la durée jugée trop courte du préavis avait pu avoir une incidence quelconque sur le sort de cette société, qui, en règlement judiciaire, avait elle-même choisi d’y mettre un terme anticipé le 5 septembre 2006 pour demander sa liquidation judiciaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce.