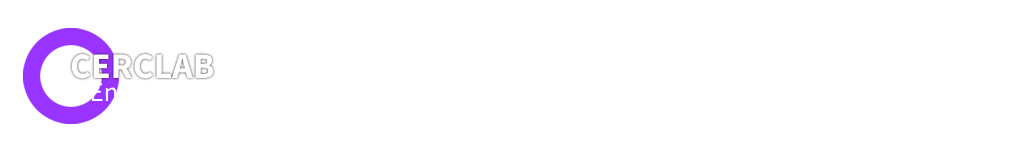CEPC (AVIS), 17 avril 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 6591
CEPC (AVIS), 17 avril 2015 : avis n° 15-08
Publication : Site CEPC
COMMISSION D’EXAMEN DES PRATIQUES COMMERCIALES
Avis n° 15-08 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur la place des conditions générales de vente et des conditions générales d’achat
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Avis n°15-08 relatif à une demande d’avis d’une entreprise sur la place des conditions générales de vente et des conditions générales d’achat - 17/04/2015.
La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu la lettre enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 14-80, par laquelle une entreprise interroge la Commission sur la question de la primauté des conditions générales de vente (CGV) dans les contrats franco-français et/ou contrat international sauf si les deux parties ont signé les conditions générales d’achat (CGA).
Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;
Le rapporteur entendu lors de ses séances plénières des 22 septembre 2014 et 26 mars 2015 ;
AVIS ET RÉPONSE DE LA CEPC (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - Contrat franco-français
Les conditions générales de vente constituent le « socle unique » de la négociation commerciale dans les relations commerciales établies au niveau national.
Les fournisseurs ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients. Elles constituent le socle unique de la négociation et comprennent les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
A la question : Est-il légal de refuser, avant l’ouverture des négociations, les conditions générales de vente y compris les barèmes, la CEPC a déjà répondu par la négative.
Selon les dispositions de l’article L 441-6, la négociation commerciale a pour point de départ les CGV. Encore faut-il que les parties aient acceptées de rentrer en négociation. Rappelons que, eu égard à la position de la CEPC, refuser, avant l’ouverture des négociations, les CGV est illégal, au motif que la négociation commerciale a pour socle les CGV et les barèmes du fournisseur, et que les refuser avant l’ouverture de la négociation revient à ne pas vouloir traiter avec ce fournisseur.
L’opposition entre CGV et CGA a déjà été sujette à contestation entre parties aux contrats, ce d’autant plus du fait de la notion de déséquilibre significatif prévu de façon expresse par le Code de Commerce (article L.442-6-I-2°).
Dans une affaire récente (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 18 décembre 2013, n° 12/00150, Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie contre GALEC), il s’agissait d’une opposition entre les conditions générales d’achat du GALEC (Groupement d’Achats des Centres distributeurs LECLERC) et les conditions générales de vente de 58 fournisseurs.
Il était ainsi inséré dans les contrats liant le GALEC aux différents fournisseurs que les conditions générales d’achat se substituaient purement et simplement aux conditions générales de vente, et ce dès lors que les CGA et les CGV seraient contradictoires.
La Cour d’appel de Paris a sanctionné cette clause au motif qu’elle avait pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les obligations et droits des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du Code de Commerce, et ce au détriment des fournisseurs.
Le code de commerce précise désormais que les conditions générales de vente sont le socle unique de la négociation commerciale, ce qui exclut ainsi expressément une organisation de cette négociation sur le seul fondement des conditions d’achat ou de contrats types des clients. Ceux-ci peuvent néanmoins être pris en compte dans le cadre de la négociation.
II - Contrat international
Au niveau international, l’application dans l’espace de la loi LME du 4 août 2008, telle que codifiée dans le Titre IV du Livre IV du Code de commerce, ne peut être envisagée « en bloc », mais seulement disposition par disposition, en distinguant celles dont l’inobservation est sanctionnée pénalement et celles dont l’inobservation est sanctionnée civilement.
a) Dispositions sanctionnées pénalement
S’agissant, en premier lieu, des dispositions dont l’inobservation est sanctionnée pénalement, il convient d’appliquer l’article 113-2 du Code pénal aux termes duquel « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». La nationalité de l’auteur de l’infraction est donc indifférente. Ce qui compte, c’est que l’infraction ait été commise – en tout ou partie – sur le territoire français. Aux termes de l’article 113-2 alinéa 2 du même code : « L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». La notion de fait constitutif a été conçue et est interprétée largement pour embrasser à la fois les éléments constitutifs de l’infraction et les faits participant au processus infractionnel même s’ils se situent en amont ou en aval des éléments constitutifs de l’infraction (D. Rebut, Droit pénal international, Précis Dalloz 2012 n° 49).
Dans les relations entre un fournisseur établi à l’étranger et un client français, on peut en déduire que les dispositions de la loi LME dont l’inobservation est sanctionnée pénalement s’appliquent lorsque l’acte matériel de l’infraction réside dans l’achat et que l’acheteur est établi en France. La jurisprudence l’a admis dans les rapports entre un fournisseur belge de tomates et un client français à propos de l’application dans l’espace de l’article 31 de l’ordonnance du 1erdécembre 1986 relatif à l’obligation de facturation « qui s’impos(e) tant au vendeur qu’à l’acheteur » (v. en ce sens, Cass. crim. 18 juin 1998, pourvoi n° 97-81510), même si les produits doivent être distribués ou revendus à l’étranger (Cass. com. 16 juin 1998, n° 96-20182 dans les rapports entre un vendeur et un exportateur, l’un et l’autre établis en France).
Même lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont localisés à l’étranger, les faits peuvent tomber sous le coup de la loi pénale française si leurs effets se produisent en France. La conception large des effets consacrée par la jurisprudence permet d’étendre le champ de la loi pénale française. La DGCCRF s’est prononcée dans ce sens à propos de l’application dans l’espace de l’article L. 441-7 du Code de commerce imposant la formalisation du contrat de distribution sous peine de sanction pénale en énonçant que « tout contrat qui a un effet sur la revente de produits ou la fourniture de services en France entre dans les dispositions de l’article » (v. Réponses aux principales questions des opérateurs pour l’application de la Loi de modernisation de l’économie : dossier 28 novembre 2008, www.economie.gouv.fr/dgccrf/Les-relations-industrie-commerce).
Dans la mesure où les dispositions concernées par la présente saisine ne sont assorties d’aucune sanction pénale, il importe de considérer l’application dans l’espace des sanctions civiles du titre IV du livre IV du Code de commerce.
b) Dispositions sanctionnées civilement
S’agissant, en second lieu, des dispositions de la loi LME dont l’inobservation est sanctionnée civilement, leur applicabilité aux contrats internationaux de vente, d’une part, de distribution, d’autre part, dépend de règles partiellement distinctes.
Le cas des contrats de vente internationale de marchandises sera mentionné brièvement. Pour ce qui les concerne, il faut en effet composer avec la convention de Vienne du 11 avril 1980 qui énonce un droit matériel uniforme de la vente internationale de marchandises. Ratifiée par 79 Etats, cette convention est applicable lorsque le vendeur et l’acheteur sont établis dans deux Etats distincts parties à la convention (art. 1-1 a) ou lorsque la règle de conflit de lois désigne la loi d’un Etat partie (art. 1-1 b). Cette convention n’a pas pour autant une vocation exclusive à régir toute question relative à la formation et à l’exécution de la vente. D’une part, elle « régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur » (art. 4). Elle ne s’applique ainsi qu’aux relations entre les parties contractantes à l’exclusion des rapports avec les tiers. D’autre part, la convention comporte des lacunes. Tout ce qui concerne la validité du contrat et de ses clauses demeure ainsi en dehors de son champ d’application (art. 4 a). Toute question de validité sera donc déterminée en application de la lex contractus (v. par exemple Cass. com. 13 février 2007, n° 05-13538). Or s’agissant des ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, la loi applicable est désignée devant le juge français en application de la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la vente internationale d’objets mobiliers corporels dont le règlement « Rome I » (infra) préserve l’application dans les Etats membres qui l’ont ratifiée. En vertu de cette convention, le contrat est en principe soumis à la loi choisie par les parties et à défaut de choix, par la loi du pays de résidence habituelle du vendeur. L’article 6 admet cependant, par exception, que « Dans chacun des Etats contractants, l'application de la loi déterminée par la présente Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public ». Applicables aux ventes internationales, ces deux conventions sont en revanche inapplicables aux contrats internationaux de distribution.
S’agissant des contrats internationaux de distribution, la question de savoir si les dispositions de la loi LME dont l’inobservation est sanctionnée civilement ont vocation à s’appliquer dans les rapports entre un fournisseur étranger et un distributeur français dépend du type de sanction civile encourue. S’il s’agit d’une sanction de nature contractuelle, il convient en effet d’appliquer le règlement « Rome I » n° 593/2008 du 17 juin 2008 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Si la sanction relève à l’inverse de la matière extra-contractuelle, l’applicabilité de la loi LME devrait dépendre du règlement « Rome II » n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations extra-contractuelles.
A titre liminaire, deux questions peuvent toutefois être soulevées.
La première est de savoir si ces textes européens s’appliqueraient en cas d’action exercée par le ministre de l’économie au titre de l’article L. 442-6 III du Code de commerce dès lors que ces règlements excluent « la matière administrative » de leur champ d’application (article 1er des règlements). Dans la mesure où l’action portée devant les juridictions civiles par le ministre de l’économie a un objet civil, il est permis de penser que telle qu’elle existe aujourd’hui, l’action ne relève pas de la matière administrative de sorte que ces règlements s’appliquent.
La seconde question liminaire consiste à se demander lequel de ces règlements s’applique. La question de savoir si la sanction imposée relève de la matière contractuelle ou extra-contractuelle au sens des règlements « Rome I » et « Rome II » doit – en vertu d’une jurisprudence européenne constante – faire l’objet d’une interprétation autonome fondée sur le système et les objectifs de ces règlements, quelles que soient les conceptions nationales (v. CJCE, 14 octobre 1976, aff. 29/76, Eurocontrol ; adde Règlement « Rome II », cons. 11 ). Ainsi, la qualification retenue en droit français pour la mise en œuvre de l’article L. 442-6 du Code de commerce n’est pas forcément la même que celle retenue pour la mise en œuvre des règles européennes de conflit de lois et de juridictions. On ne peut pas non plus exclure que certaines obligations relèvent de la matière contractuelle tandis que d’autres relèveraient de la matière extracontractuelle.
Dès lors que la Cour de justice n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la qualification - contractuelle ou extra-contractuelle - des actions civiles fondées sur la violation de la loi LME et que l’interprétation de règlements européens relève de cette dernière, il convient, en l’état, de rechercher dans quelles hypothèses ces textes européens peuvent, l’un et l’autre, permettre de retenir la compétence de la loi LME pour régir les rapports entre un fournisseur établi dans un Etat membre de l’Union européenne et un client français.
1) Application du règlement « Rome I »
Si l’on applique le règlement « Rome I », la compétence de la loi LME pourra être retenue dans deux séries d’hypothèses. La loi française est susceptible de s’appliquer, tout d’abord, dans le cas où la règle de conflit de lois donne compétence à la loi française (a) et ensuite, si elle s’analyse comme une loi de police et que la situation en cause entre dans son champ d’application (b).
a) Désignation de la loi française par la règle de conflit de lois
Il se peut, tout d’abord, que la règle de conflit de lois donne compétence à la loi française, en tant que loi du contrat (lex contractus).
En application du règlement « Rome I », le contrat de distribution sera ainsi soumis au droit français si les parties ont choisi de soumettre le contrat à la loi française (article 3).
A défaut de choix, c’est la loi du pays de résidence habituelle du distributeur qui s’applique (article 4 § 1 f ; contra, sous l’empire de la convention de Rome du 11 juin 1980, les arrêts Optelec, Cass. 1re civ. 15 mai 2001, n° 99-17132 puis Cass. 1re civ. 25 novembre 2003, n° 01-01414). Lorsque le contrat de distribution ne comporte pas de clause d’electio juris désignant une loi étrangère et que le distributeur est établi en France, la loi française a donc vocation à s’appliquer.
b) Application de la loi française en tant que loi de police
Dans les hypothèses où c’est une loi étrangère qui est désignée par la règle de conflit de lois, la loi LME peut encore s’imposer si elle s’analyse comme une loi de police et que la situation en cause entre dans son champ d’application.
En vertu de l’article 9 du règlement « Rome I » :
« 1. Une loi de police est une disposition jugée cruciale par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation sociale, politique ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application ».
La question de savoir si les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce s’analysent comme des lois de police est très débattue.
D’un côté, le Titre IV assure en effet la protection des intérêts particuliers des entreprises victimes d’un rapport de forces déséquilibré dans la négociation et l’exécution de la relation commerciale, par opposition au titre II protecteur du marché concurrentiel. D’ailleurs, les pratiques tarifaires et restrictives du Titre IV sont interdites per se, en tant que telles, indépendamment de leur impact sur la concurrence sur le marché. En cela, on pourrait considérer que ces dispositions d’ordre public interne ne sont pas pour autant internationalement impératives car elles assurent la sauvegarde d’intérêts privés et non d’intérêts publics au sens de l’article 9 du règlement « Rome I ». La doctrine a interprété l’article 9 du règlement « Rome I » comme excluant désormais l’intervention des lois de police de protection (v. en particulier L. d’Avout, « Le sort des règles impératives dans le règlement Rome I », D. 2008 p. 2165). Ainsi conçus, le plafonnement des délais de paiement ou l’interdiction des déséquilibres significatifs ne pourraient s’imposer comme loi de police, même si le fournisseur est établi en France.
De l’autre côté pourtant, les dispositions du Titre IV du Livre IV visent à équilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs en imposant de bonnes pratiques et en interdisant les mauvaises. Leur objet n’est donc pas seulement de protéger la partie faible dans la relation commerciale, mais aussi d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs et par là-même, une meilleure égalité des conditions de concurrence sur le marché. En cela, elles pourraient recevoir la qualification de loi de police. Pour les pratiques restrictives, l’action reconnue au ministre de l’économie par l’article L.442-6 III du Code de commerce et qualifiée par la jurisprudence d’« action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence» milite d’ailleurs en ce sens (Cass. com. 8 juillet 2008, n° 07-16761). Dès avant l’adoption de la loi LME, certains arrêts l’ont admis (v. Lyon 9 septembre 2004, RG n° 2004/00108 à propos de la rupture brutale d’une relation commerciale établie). L’Administration s’est également prononcée en ce sens (v. l’article 6 § 3 de la circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales pour ce qui concerne le régime des enchères électroniques inversées ; adde Note d’information DGCCRF n°2009-28 et Fiche CEPC sur les délais de paiement). Si l’on considère ainsi que le plafonnement des délais de paiement et l’interdiction du déséquilibre significatif ont pour fonction d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales et une meilleure égalité des conditions de concurrence entre les fournisseurs, il paraît possible de retenir la qualification de loi de police car il ne s’agit plus des seuls intérêts privés mais des intérêts collectifs de la profession et du marché (sur ce glissement, v. J.-B. Racine, « Droit économique et lois de police » RIDE 2010 p.61). Le même raisonnement s’applique pour les autres dispositions de la loi LME.
Si l’on retient l’hypothèse que les dispositions issues de la loi LME s’analysent comme des lois de police au sens de l’article 9§1 du règlement « Rome I », se pose la question de savoir quel en serait le champ d’application. Deux types de rattachement sont en effet concevables : soit un rattachement personnel, fondé sur l’établissement en France du créancier de l’obligation (en principe, le fournisseur), soit un rattachement territorial qui pourrait être fondé sur la destination des produits ou services contractuels au marché français ou sur leur vocation à être distribués en France. En l’état du droit positif, le second rattachement semble l’emporter.
Dans le premier cas de figure (rattachement personnel), seraient exclues du champ d’application de la loi LME les relations commerciales entre un fournisseur établi à l’étranger et un client français, même si les produits ou services contractuels ont vocation à être distribués en France. Il en résulterait une rupture d’égalité entre les fournisseurs français et étrangers de produits ou services distribués en France puisque dans les rapports avec les fournisseurs français, la loi LME s’appliquerait, ce qui ne serait pas le cas dans les rapports avec les fournisseurs étrangers (comp. sous l’empire de la convention de Rome, la jurisprudence qui retient l’application en tant que loi de police de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance « en ses dispositions protectrices du sous-traitant » non pas lorsque le sous-traitant est établi en France mais « s’agissant de la construction d’un immeuble en France », Cass. Mixte 30 novembre 2007, n° 06-14006 et les conclusions de l’avocat général Guérin).
A l’inverse, dans la seconde hypothèse (rattachement territorial), les dispositions de la loi LME s’appliqueraient dès lors que les produits ou services contractuels seraient vendus en France pour y être distribués. Dans ce cas, tous les fournisseurs – français ou étrangers – relèveraient de la loi LME dès lors que la relation commerciale concerne des produits ou services distribués en France. Contrairement à la précédente, cette analyse permet de maintenir une égalité des conditions de concurrence entre tous les produits ou services distribués sur le marché français. Lors de l’adoption de la loi LME, la DGCCRF a indiqué qu’elle veillerait « à ce que les débiteurs établis en France règlent leurs créanciers résidant à l’étranger sans entrainer de distorsion de concurrence vis-à-vis d’opérateurs résidant en France » (Note d’information DGCCRF n° 2009-28 ; Fiche CEPC sur les délais de paiement). La réponse va dans le sens d’une application territoriale de la loi LME, que le fournisseur soit établi en France ou qu’il soit établi à l’étranger. Cette analyse rejoint également l’article 6§3 de la circulaire du 8 décembre 2005 qui s’est prononcé dans le sens de l’application de l'article L. 442-10 du code de commerce « à tous les contrats qui ont pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente en France ».
A supposer que les obligations issues du Titre IV – ou certaines d’entre elles – relèvent de la matière extra-contractuelle, leur applicabilité dans les rapports entre un fournisseur étranger et un client français dépend du règlement « Rome II ».
2) Application du Règlement « Rome II »
Le règlement « Rome II » a vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité extracontractuelle exercées devant les juridictions d’un Etat membre de l’Union européenne. En application de ce règlement, la loi LME est applicable si la loi française est désignée par la règle de conflit de lois pour régir le délit. Même si la loi française n’est pas la lex loci delicti, la loi LME peut s’imposer dans certains cas.
a) La règle de conflit de lois désigne la loi française pour régir le délit
Pour désigner la loi applicable au délit, le règlement « Rome II » contient plusieurs règles de conflit spéciales concernant des délits spéciaux, notamment les délits de « concurrence déloyale et atteinte à la concurrence » (article 6). Pour tous les comportements qui n’entrent pas dans le champ de ces règles de conflit spéciales, c’est la règle générale énoncée par l’article 4 qui s’applique.
L’article 6 du règlement « Rome II » énonce une règle de conflit spéciale pour les délits concurrentiels. En vertu de l’article 6 § 1, « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays où les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ».
Pour savoir si ce texte s’applique aux actions en responsabilité de l’article L. 442-6 du Code de commerce, il importe de déterminer si la responsabilité encourue résulte d’un « acte de concurrence déloyale » au sens de ce texte. On peut le penser dans la mesure où la Commission, dans les actes préparatoires du règlement, indique qu’il s’agit aussi bien de « protéger les concurrents que les consommateurs et le public en général ». Sont en particulier visées les pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs. Par extension, il est permis d’y inclure les pratiques déloyales des entreprises dans leurs rapports mutuels (v. également en ce sens, M. Behar-Touchais, « L’article 6 du règlement Rome II et les pratiques restrictives de concurrence », RLDC 2010-1 p. 31).
Si les actions civiles fondées sur la violation des dispositions de la loi LME entrent bien dans le champ de l’article 6§1, elles relèvent de la loi du « pays où les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Si le client est établi en France, on peut penser que c’est en France que les relations de concurrence entre les fournisseurs se nouent. Si les produits sont revendus en France, la France est également le lieu où les intérêts des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être.
Mais lorsque, aux termes de l’article 6 § 2, un acte de concurrence déloyale « affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé », l’article 6 § 1 est inapplicable et l’on en revient à l’application de la règle de conflit générale énoncée par l’article 4. A supposer que les pratiques restrictives du Titre IV « affectent exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé » et non les intérêts collectifs des concurrents, des consommateurs et du marché - ce dont il est permis de douter -, la loi applicable à la responsabilité engagée par leur auteur relèverait de la règle de conflit générale énoncée par l’article 4 § 1 qui confère une compétence de principe à la loi du lieu où le préjudice est directement subi (par opposition, notamment, au lieu où sont subies ses conséquences financières). Pour la mise en œuvre de l’article 4 § 1, la localisation du préjudice dépend de sa nature. Ainsi, certains préjudices devraient être localisés au lieu où les produits contractuels doivent être revendus. On songe, par exemple, aux pratiques de déréférencement abusif. On peut penser que d’autres, en revanche, à supposer qu’elles portent atteinte aux seuls intérêts du fournisseur, sont directement subis au siège du fournisseur. On songe aux conditions de règlement abusives sauf si, en vertu de la lex contractus, le paiement est quérable à l’établissement de l’acheteur et non portable à celui du fournisseur (v. faisant ce détour par la règle de conflit de lois pour localiser une obligation de paiement, CJCE 6 octobre 1976, Tessili, aff. C-12/76).
L’application de la loi du lieu du dommage peut toutefois être écartée par exception si le fait dommageable présente un lien manifestement plus étroit avec un autre Etat, lien qui « pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ». Dans les relations entre un fournisseur et son distributeur, la mise en œuvre de cette exception au profit de la loi du contrat aboutirait à donner compétence à la lex contractus (v. supra).
b) La règle de conflit de lois ne désigne pas la loi française pour régir le délit
Si l’article 6 § 1 du règlement est inapplicable et qu’en application de l’article 4, la loi applicable au délit est la loi étrangère du fournisseur, la loi française du distributeur peut néanmoins être prise en compte voire s’appliquer dans deux hypothèses.
La première a vocation à jouer que le litige soit porté devant le juge français ou devant un juge étranger. Dans tous les cas où la lex loci delicti n’est pas la loi du lieu où l’auteur du dommage a agi, l’article 17 prévoit en effet : « Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entrainé la responsabilité ». Dans les relations commerciales, il est permis de penser que ce texte permet de prendre en compte les règles de comportement imposées au distributeur établi en France par la loi LME pour en évaluer le caractère fautif, quand bien même ses conséquences civiles relèveraient d’une autre loi.
La seconde hypothèse a vocation à jouer lorsque c’est le juge français qui est saisi de l’action. L’article 16 du règlement « Rome II » ménage en effet l’application des lois de police du for en ces termes : « Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l’application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle » (sans référence aux intérêts publics promus par la loi de police). Il en résulte que si les dispositions de la loi LME s’analysent comme des lois de police et que la situation litigieuse entre dans leur champ d’application (v. supra), le juge français pourra en imposer le respect.
Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 26 mars 2015, présidée par Monsieur Daniel TRICOT
Fait à Paris, le 26 mars 2015
Le vice-président de la Commission d’examen des pratiques commerciales
Daniel TRICOT