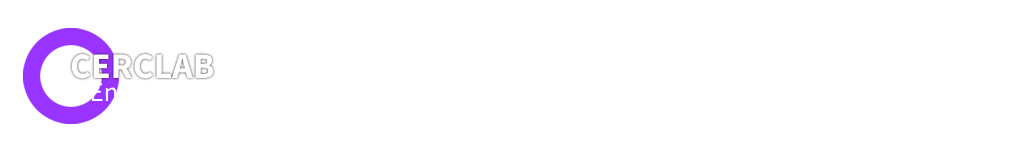CA TOULOUSE (3e ch.), 9 avril 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8934
CA TOULOUSE (3e ch.), 9 avril 2021 : RG n° 20/00544
Publication : Jurica
Extrait : « La clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie et les parties admettent avec le tribunal que le litige porte sur une clause de limitation de la garantie répondant aux mêmes exigences quant à la charge de la preuve. En effet, l'assuré ne se voit imposer aux termes de la loi que la preuve des conditions de la garantie, définies comme les exigences précises auxquelles la garantie est subordonnée.
Au cas d'espèce, la clause litigieuse 2.4.3. stipule (p. 26) qu'en cas de blessures, s'il est établi qu'au moment du sinistre, l'assuré, victime de l'accident était en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise d'un état alcoolique tel que défini par les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, l'indemnité à verser sera réduite de moitié sans pouvoir excéder la moitié du plafond de garantie, à moins que l'assuré ne prouve que cet état n'a eu aucune influence sur la survenance de l'accident.
Il convient en premier lieu d'écarter les considérations de la GMF sur le fait que déclarer la clause abusive contredirait les dispositions de la loi Badinter et reviendrait à valider toute conduite en état alcoolique. Au cas d'espèce, le débat est celui du libellé de la clause litigieuse et non celui d'une inopposabilité générale et de principe d'une clause sanctionnant la conduite en état alcoolique. Un tel comportement, pénalement répréhensible, est en effet susceptible d'exclure la garantie dès lors que la clause d'exclusion qui s'y réfère est libellée en des termes conformes à la loi.
Pour le même motif, ne peut pas plus être retenu l'argument selon lequel la jurisprudence citée de la première chambre civile de la Cour de Cassation (Civ. 1re, 12 mai 2016, pourvoi n° 14-24.698) serait isolée et non conforme à la jurisprudence de la 2ème chambre de la dite Cour, juge « naturel » de l'indemnisation corporelle en matière accident de la route. Il ne s'agit pas d'appliquer en l'espèce la loi du 5 juillet 1985 mais bien d'apprécier le caractère abusif ou non d'une clause insérée dans un contrat d'assurance.
La Cour observe en second lieu que si les parties sont contraires sur le taux d'alcoolémie (1,07 g/l ou 1,7 g/l), aucune des deux ne conteste que ce taux caractérise bien, au sens du contrat, une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique tel que défini par les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route.
En troisième lieu, l'appelante ne produisant pas le procès-verbal de police dressé après l'accident, les autres éléments recueillis sur les circonstances de celui-ci (constatations matérielles et témoignages) auxquelles elle se réfère dans ses écritures ne peuvent être vérifiées par la Cour.
Sur l'examen de la clause litigieuse, celle-ci rédigée en caractère gras et apparents, se présente sous la forme légale d'une clause d'exclusion dont la preuve des conditions d'application repose sur le seul assureur, et la GMF reconnaît qu'il lui appartient de démontrer l'état d'alcoolémie et son lien avec l'accident mais aussi (conclusions p. 3) que la définition donnée par le tribunal du régime juridique de l'exclusion ou limitation conventionnelle ne fait pas débat.
L'appelante prétend toutefois vainement que la clause n'opérant aucun renversement de la charge de la preuve, il n'y a pas lieu d'examiner son caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 susvisé. Ce faisant, elle opère une confusion entre les effets de la clause quant à la charge de la preuve et la validité de celle-ci et ajoute à la loi. En effet, le code de la consommation s'applique aux contrats d'assurance et le juge a même l'obligation d'examiner d'office la nature éventuellement abusive d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En insérant en fin de paragraphe, une faculté pour l'assuré d'éviter la limitation de garantie, la GMF tente d'échapper à l'obligation qui pèse sur elle, ce qu'elle admet implicitement indiquant dans ses écritures (p. 5) que l'assuré peut prouver le rétablissement de la garantie, à savoir que l'alcool n'a eu aucune conséquence sur les conditions de réalisation de l'accident. Ainsi que le souligne la note de M. B. (Responsabilité civile et assurances n° 9, septembre 2016, comm. 263) la clause « renversant la charge de la preuve, c'est naturellement le risque de la preuve qui serait désormais supporté par l'assuré ou ses ayants droit ; de la sorte, à chaque fois que les circonstances exactes de l'accident ne seront pas connues et que l'assuré aura été surpris en état d'ébriété, l'assureur pourra se prévaloir de l'exclusion ». Au surplus, cette preuve imposée à l'assuré est une preuve négative. Cette stipulation crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et il sera jugé qu'elle est réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 AVRIL 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00544. N° Portalis DBVI-V-B7E-NOQ7. Décision déférée du 13 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/02788
APPELANTE :
SA GMF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal [adresse], [...], Représentée par Maître Laurent DE C. de la SCP DE C. L.- F. J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur X.
Assisté de son curateur M. Y., suivant jugement de curatelle simple rendu par le TI de Z. le [date], [...], [...], Représenté par Maître Michel D.-B., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président, P. POIREL, conseiller, V. BLANQUE-JEAN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
M. X., né le [date 1991], a souscrit le 25 février 2012 auprès de la SA GMF Assurances (la GMF) un contrat individuel « garantie du conducteur » garantissant plusieurs postes de préjudices avec un plafond d'un million d'euros.
Une réduction de moitié de l'indemnité était prévue en cas de blessures, lorsque la victime de l'accident était en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique.
Le 8 octobre 2014, [...], M. X., a été grièvement blessé après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a heurté un platane.
Une expertise amiable et contradictoire a été effectuée le 14 décembre 2017 par les Drs H. et C. concluant à un déficit fonctionnel permanent de 85 %.
Une ordonnance de référé du 21 juin 2018 a alloué à M. X. une provision de 150.000 €, s'ajoutant à des provisions versées à l'amiable à hauteur de 200.000 €.
PROCÉDURE :
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2018, M. X., assisté de son curateur M. Y., a assigné la SA GMF Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse sollicitant, en exécution du contrat d'assurance,
- les sommes de :
* 518.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 880.630 € au titre de l'assistance par tierce personne
* 2.023,56 € au titre des dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures
- qu'il soit jugé que la GMF doit pleinement sa garantie à hauteur d'un million d'euros et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme résiduelle de 650.000 €, compte tenu des provisions versées.
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2020, le tribunal a :
- jugé que la clause contenue dans l'articles 2.4.3 du contrat d'assurance souscrit entre la GMF Assurances et M. X. Gaëtan portant le n° 003XXX091X à effet au 25 février 2012 est abusive et donc réputée non écrite,
- condamné la SA GMF assurance à payer à M. X., assisté de son curateur M. Y., en deniers et quittances, la somme de 1.000.000 (un million) en indemnisation de son préjudice corporel ayant résulté de l'accident du 8 octobre 2014, en exécution du contrat d'assurance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SA GMF Assurances à payer à M. X., assisté de son curateur M. Y., la somme de 3000€ (trois mille) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA GMF assurances aux dépens.
Le tribunal a retenu que :
- quelque soit le caractère direct ou indirect de la clause d'exclusion ou de limitation de garantie, il appartient à l'assureur de prouver que l'état d'alcoolémie de l'assuré a été la cause directe, certaine et exclusive du sinistre,
- le contrat ne peut inverser la charge de la preuve,
- l'article 2-4-3 aux termes « en cas de blessures, s'il est établi qu'au moment du sinistre, l'assuré victime de l'accident était un état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par les articles L. 234-1et R. 234-1 du code de la route français,..., l'indemnité sera réduite de moitié sans pouvoir excéder la moitié du plafond de garantie à moins que l'assuré ne prouve que cet état n'a eu aucune influence sur la survenance de l'accident » inverse la charge de la preuve
- la clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat souscrit le 25 février 2012.
Par déclaration en date du 12 février 2020, la SA GMF Assurances a interjeté appel de la décision. Tous les chefs de la décision sont critiqués.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le magistrat délégué par le Premier Président a :
- autorisé la GMF à consigner la somme de 500.000 € entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- condamné la GMF au paiement immédiat d'une somme complémentaire de 150.000 € à M. X., venant compléter les 350.000 € de provision déjà versée au titre de ce contrat,
- condamné également la GMF aux dépens de procédure et au règlement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues par voie électronique le 20 avril 2020, au visa des articles 1103 et 1315 du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code civile, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la clause limitative de garantie est acquise,
- dire et juger en conséquence que la GMF doit sa garantie à hauteur de 500.000 €,
- dire et juger que M. X., assisté de son curateur M. X. reste à percevoir la somme de 150.000€, déduction faite de la provision versée à hauteur de 350.000 €,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- il s'agit d'une clause limitative de garantie,
- la définition donnée par le tribunal du régime juridique de l'exclusion ou limitation conventionnelle ne fait pas débat, et il appartient bien à l'assureur de prouver l'état d'ivresse manifeste ou la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ainsi que son lien avec l'accident,
- il n'y a pas lieu de se référer à la notion de clause abusive, la clause litigieuse ne renversant pas la charge de la preuve,
- l'assureur doit prouver l'état d'alcoolémie de l'assuré conducteur et son lien de cause à effet dans la survenance du sinistre, l'assuré peut quant à lui combattre cette démonstration pour voir rétablir la garantie,
- l'arrêt produit par l'intimé, selon lequel il incombe à la cour d'appel de rechercher d'office le caractère abusif des clauses d'un contrat d'assurance prévoyant une exclusion de garantie en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, est isolé, il n'émane pas de la chambre qui est le juge naturel du contentieux des accidents de la circulation, il fait une appréciation critiquable de ce que serait l'application du droit commun au cas d'espèce qui ne prévoit pas l'indemnisation du conducteur victime d'un accident de la route n'impliquant aucun autre véhicule, enfin son interprétation aboutirait à ne pas sanctionner l'alcoolémie lorsqu'elle est la cause d'un accident de la circulation,
- et en l'espèce il s'agit d'une clause de limitation de garantie et non une clause d'exclusion,
- enfin, le jugement du 5 mars 2018 du tribunal de grande instance de Toulouse invoqué par l'intimé n'est pas pertinent, puisqu'au cas d'espèce le véhicule circulait sur une chaussée recouverte de boue, alors que le véhicule conduit par M. X. circulait sur une chaussée éclairée, sèche et rectiligne, à une vitesse excessive (environ 100 km/h au lieu de 50 km/h) et que les témoins ont entendu des crissements de pneus et constaté un freinage tardif et brutal, toutes circonstances de l'accident correspondant aux effets constatés de l'alcool sur la conduite,
- elle formule les offres suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 150 €
* perte de gains professionnels actuels du 8/10/14 au 8/10/17 : 12.996,75 €
* déficit fonctionnel permanent : 85 % x 5.000 € le point = 425.000 €
* perte de gains professionnels futurs : la GMF accepte le revenu de référence de 15.923 €, dont doit être déduite la pension d'invalidité CPAM de 8011,76 € et de AAH de 142 € par mois = 7.769,24 x 35,60 (BCRIV 18) = 276.584,94 €
* tierce personne : la GMF est en accord avec le calcul de Monsieur X.
- elle en déduit qu'au regard des préjudices subis, le plafond de garantie est atteint et, compte tenu de la somme de 350.000 déjà versée, M. X. doit percevoir une somme complémentaire de 150.000 euros,
- aucune résistance abusive ne peut être imputée à l'assureur qui a déjà versé des indemnités et avait, dès le départ proposé à M. X. le versement de la somme de 500.000 euros au titre du contrat.
[*]
M. X., dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2020, demande à la cour, de :
rejetant l'appel comme injuste et mal fondé,
- dire et juger que la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat est à la fois illicite et abusive et donc réputée comme non écrite,
- condamner en conséquence la société GMF à payer à M. X. le solde de l'indemnité restant due soit la somme de 500.000 € avec intérêts légaux à compter du 14 décembre 2017,
- condamner la société GMF au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la société GMF aux dépens.
Il expose en substance que :
- la GMF reconnaît qu'il appartient bien à l'assureur de prouver que l'exclusion de garantie est acquise et, ce faisant, elle admet que la clause litigieuse est illicite pour avoir inversé la charge de la preuve,
- l'assureur souhaite vainement écarter l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, alors qu'il a voulu tromper l'assuré en faisant reposer sur lui la charge d'une preuve négative, à savoir prouver que l'état alcoolique n'a pas eu d'influence sur la survenance de l'accident, ce qui est difficile voire impossible à démontrer,
- il résulte de la jurisprudence qu'une telle clause est abusive dès lors elle est réputée non écrite et ni l'assuré, ni l'assureur n'ont à prouver un quelconque lien de causalité entre l'alcoolémie et l'accident,
- les jurisprudences invoquées par l'appelante ne sont pas pertinentes, dans l'une le caractère abusif de la clause n'était pas en litige et dans la seconde, la victime n'apportait pas la preuve des conditions d'application de la garantie vol,
- le plafond contractuel étant fixé à un million d'euros, l'assureur, qui a déjà versé à M. X. la somme de 500.000 euros, doit lui verser le solde restant dû d'un montant de 500.000 euros, sachant que le préjudice global subi par M. X. s'élève à 2.621.553 € est très supérieur au montant garanti,
- à titre subsidiaire, il convient de préciser d'une part que le taux n'est pas de 1,7 mais 1,07 gramme par litre de sang, que le premier juge n'a pas indiqué que cet état alcoolique était la cause de l'accident, enfin que la preuve du lien de causalité entre cet état alcoolique, la vitesse excessive et l'accident est purement hypothétique.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le plafond de la garantie :
En l'état de la date de souscription de la police, le litige est soumis aux dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte que l'appelante vise à tort l'article 1103 du code civil aux lieu et place de l'article 1134 selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs selon l'article 1315 du dit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et, l'article L. 113-1 dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».
Enfin, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au contrat souscrit le 25 février 2012, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie et les parties admettent avec le tribunal que le litige porte sur une clause de limitation de la garantie répondant aux mêmes exigences quant à la charge de la preuve. En effet, l'assuré ne se voit imposer aux termes de la loi que la preuve des conditions de la garantie, définies comme les exigences précises auxquelles la garantie est subordonnée.
Au cas d'espèce, la clause litigieuse 2.4.3. stipule (p. 26) qu'en cas de blessures, s'il est établi qu'au moment du sinistre, l'assuré, victime de l'accident était en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise d'un état alcoolique tel que défini par les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route, l'indemnité à verser sera réduite de moitié sans pouvoir excéder la moitié du plafond de garantie, à moins que l'assuré ne prouve que cet état n'a eu aucune influence sur la survenance de l'accident.
Il convient en premier lieu d'écarter les considérations de la GMF sur le fait que déclarer la clause abusive contredirait les dispositions de la loi Badinter et reviendrait à valider toute conduite en état alcoolique. Au cas d'espèce, le débat est celui du libellé de la clause litigieuse et non celui d'une inopposabilité générale et de principe d'une clause sanctionnant la conduite en état alcoolique. Un tel comportement, pénalement répréhensible, est en effet susceptible d'exclure la garantie dès lors que la clause d'exclusion qui s'y réfère est libellée en des termes conformes à la loi.
Pour le même motif, ne peut pas plus être retenu l'argument selon lequel la jurisprudence citée de la première chambre civile de la Cour de Cassation (Civ. 1re, 12 mai 2016, pourvoi n° 14-24.698) serait isolée et non conforme à la jurisprudence de la 2ème chambre de la dite Cour, juge « naturel » de l'indemnisation corporelle en matière accident de la route. Il ne s'agit pas d'appliquer en l'espèce la loi du 5 juillet 1985 mais bien d'apprécier le caractère abusif ou non d'une clause insérée dans un contrat d'assurance.
La Cour observe en second lieu que si les parties sont contraires sur le taux d'alcoolémie (1,07 g/l ou 1,7 g/l), aucune des deux ne conteste que ce taux caractérise bien, au sens du contrat, une conduite sous l'emprise d'un état alcoolique tel que défini par les articles L. 234-1 et R. 234-1 du code de la route.
En troisième lieu, l'appelante ne produisant pas le procès-verbal de police dressé après l'accident, les autres éléments recueillis sur les circonstances de celui-ci (constatations matérielles et témoignages) auxquelles elle se réfère dans ses écritures ne peuvent être vérifiées par la Cour.
Sur l'examen de la clause litigieuse, celle-ci rédigée en caractère gras et apparents, se présente sous la forme légale d'une clause d'exclusion dont la preuve des conditions d'application repose sur le seul assureur, et la GMF reconnaît qu'il lui appartient de démontrer l'état d'alcoolémie et son lien avec l'accident mais aussi (conclusions p. 3) que la définition donnée par le tribunal du régime juridique de l'exclusion ou limitation conventionnelle ne fait pas débat.
L'appelante prétend toutefois vainement que la clause n'opérant aucun renversement de la charge de la preuve, il n'y a pas lieu d'examiner son caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 susvisé.
Ce faisant, elle opère une confusion entre les effets de la clause quant à la charge de la preuve et la validité de celle-ci et ajoute à la loi. En effet, le code de la consommation s'applique aux contrats d'assurance et le juge a même l'obligation d'examiner d'office la nature éventuellement abusive d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En insérant en fin de paragraphe, une faculté pour l'assuré d'éviter la limitation de garantie, la GMF tente d'échapper à l'obligation qui pèse sur elle, ce qu'elle admet implicitement indiquant dans ses écritures (p. 5) que l'assuré peut prouver le rétablissement de la garantie, à savoir que l'alcool n'a eu aucune conséquence sur les conditions de réalisation de l'accident. Ainsi que le souligne la note de M. B. (Responsabilité civile et assurances n° 9, septembre 2016, comm. 263) la clause « renversant la charge de la preuve, c'est naturellement le risque de la preuve qui serait désormais supporté par l'assuré ou ses ayants droit ; de la sorte, à chaque fois que les circonstances exactes de l'accident ne seront pas connues et que l'assuré aura été surpris en état d'ébriété, l'assureur pourra se prévaloir de l'exclusion ». Au surplus, cette preuve imposée à l'assuré est une preuve négative. Cette stipulation crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et il sera jugé qu'elle est réputée non écrite.
Sur l'indemnisation du préjudice de M. X. :
La GMF qui se limite à rappeler ses offres d'indemnisation, ne formule aucune critique étayée sur l'évaluation du préjudice subi par M. X. à hauteur de 2.621.553 €, montant qui dépasse le plafond de garantie contractuelle d'un million d'euros.
Il convient seulement de rappeler que le contrat garantit les postes de préjudices suivants, dès lors qu'ils sont imputables directement à l'accident et médicalement reconnus nécessaires :
- perte de gains professionnels actuels,
- dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures,
et, dès lors que le taux 'AIPP' est supérieur à 10 % :
- déficit fonctionnel permanent,
- pertes de gains professionnels futurs,
- frais d'assistance par une tierce personne,
- frais de logement adapté.
Les conclusions définitives du rapport amiable et contradictoires des docteurs H. et C. qui reposent sur un examen complet de la victime et sont admises par les parties comme base d'évaluation, sont les suivantes :
- M. X., monteur en réseau électrique, était inscrit à l`ANPE « en formation » et a perçu des indemnités journalières jusqu'à attribution d'une allocation d'adulte handicapé le 1er février 2015 reconduite le 31 décembre 2016 avec complément de ressources. Il a été classé en invalidité deuxième catégorie le 1er janvier 2017,
- il a subi polytraumatisme sévère avec un traumatisme crânio encéplialique (Glasgow 3) dans un contexte d'imprégnation éthanolique de type fracture du crâne et de la face, avec lésions hémorragiques sous-durales et sous-arachnoïdiennes et œdème cérébral, contusion thoracique, facture du cotyle et il a été sédaté jusqu'au 17 octobre 2014,
- il a été hospitalisé de manière permanente du 8 octobre 2014 au 11 septembre 2015, en hôpital ou en service de rééducation, et a fait l'objet d'une crâniectomie sur hypertension intra-crânienne réfractaire,
- le 23 octobre 2014, son Glasgow est remonté à 7. Il a fait l'objet d'une chirurgie faciale. Le tableau a été dominé par une hémiparésie gauche, une paralysie faciale gauche avec agitation motrice,
- son état a évolué vers une hémiparésie gauche et des troubles cognitifs sévères,
- la date de consolidation peut être fixée au 8 octobre 2017, la victime ayant alors 26 ans,
- le retentissement fonctionnel, analysé à travers le barème concours médical 2011, correspond à un trouble visuel sévère retenu à 1/10e à 1/20e sur atrophie optique et à une atteinte cognitive permettant de retenir un taux raisonné de 85 %,
- une aide humaine avant consolidation est retenue de l'ordre de six heures d'aide humaine active, six heures d'aide humaine de surveillance et d'incitation. L'aide humaine après consolidation reste superposable soit six heures actives et six heures passives. Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une intervention nocturne des parents, ces 12 heures d'aide humaine correspondent à des interventions ponctuelles et s'entendent sur le nycthémère.
- aucune reprise d'activité professionnelle n'est envisageable,
- la conduite automobile est désormais définitivement interdite,
- les frais post-consolidation sont tous pris en charge dans le cadre de la protection sociale.
Au vu de ces éléments et des termes du contrat, le tribunal a indemnisé le préjudice comme suit :
I. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) dépenses actuelles de santé
Une somme de 2023,56 € pour frais de suivi psychologique et frais d'hébergement en centre de rééducation au sein de l'association Solbame a été allouée en première instance. La GMF n'explicite pas son offre à hauteur de 150 €. Cependant les frais d'hébergement (1.383,56 €) ne sont pas des dépenses de santé mais des frais divers de sorte que la somme allouée sera limitée à 640 €.
b) tierce personne temporaire
La GMF adhère au calcul de M. X. qui sollicitait devant le tribunal la somme de 88.458 €.
c) perte de gains professionnels actuels (PGPA)
La GMF offre une somme de 12.996,75 € pour la période du 8 octobre 2014 au 8 octobre 2017, ce dont il convient de prendre acte.
2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Préjudices professionnels ou économiques (pertes de gains professionnels futurs)
Les parties se sont accordées devant le tribunal sur le revenu annuel de référence (15.923 €), une perte mensuelle de 6.191 € compte tenu du montant de la pension d'invalidité et de l'allocation adulte handicapé, enfin sur l'emploi du barème de capitalisation BCR IV 2018 aboutissant à une indemnisation de 220.399,60 €.
Il convient de prendre acte de l'offre actuelle de la GMF à hauteur de 276.584,94 € sur la base des éléments suivants : un revenu de référence de 15.923 €, déduction de la pension d'invalidité CPAM de 8.011,76 € et de l'AAH de 142 € par mois, soit une indemnisation de 7.769,24 x 35,60 (BCRIV 18).
b) dépenses consécutives à la réduction d'autonomie (Assistance Tierce Personne -ATP)
Les parties se sont accordées devant le tribunal sur un montant de 1.793.172 € sur la base horaire de 13 euros pour l'aide humaine active et 10 euros pour l'aide humaine passive.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
Le contrat ne garantit que le déficit fonctionnel permanent.
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce taux d'incapacité a été fixé par les experts à 85 % chez un homme âgé de 26 ans à la date de consolidation et le tribunal a fixé une indemnité de 518.500 € (soit 6.100 € le point) alors que la GMF propose 5000 €, somme qui indemnise insuffisamment le handicap compte tenu de l'âge de M. X. Le montant alloué sera confirmé.
Le montant global du préjudice indemnisable peut donc être évalué à la somme de 2.690.351,69 € ; néanmoins, M. X. ne critiquant pas dans ses écritures la somme allouée par le tribunal à hauteur de 2 621 553,16 €, ce dernier montant sera retenu.
Il est, en toute hypothèse, supérieur au plafond de garantie d'un million d'euros que M. X. est fondé à obtenir en exécution du contrat d'assurance et la condamnation de la GMF à verser ce montant sera confirmée, ainsi que la déduction des provisions déjà versées à hauteur de 350.000 €.
Ce montant sera alloué avec intérêts légaux à compter du 30 juillet 2018, date de l'assignation valant mise en demeure.
Sur les autres demandes :
La GMF, partie perdante en appel, supportera les dépens et devra verser à M. X. une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Dit que la condamnation prononcée portera intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2018,
Condamne la SA GMF assurances à verser à M. X. une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
Condamne la GMF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6344 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Présentation générale
- 6373 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile