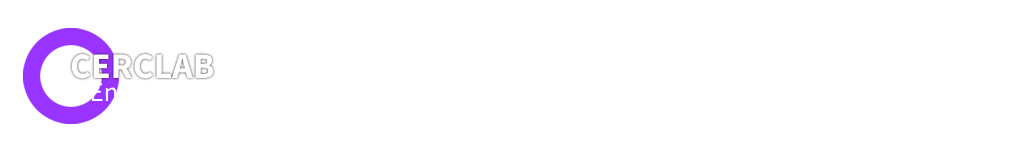CA VERSAILLES (17e ch.), 1er juillet 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8499
CA VERSAILLES (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, par avenant du 1er avril 2015 (pièce 13 de la salariée), Mme X. a été admise au bénéfice d'un congé de mobilité externe qui avait pour effet la suspension du contrat de travail du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016. L'article 3 de l'avenant stipule : « ARTICLE 3 - Retour dans l'entreprise - A son retour dans l'association Groupe Essec, la salariée retrouvera de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, avec une qualification et une rémunération au moins équivalente, ainsi que le maintien à titre personne, au minimum, de sa classification. » L'article 4 prévoit, pour sa part : « ARTICLE 4 - Cessation du contrat de travail - Dans le cas où la salariée ne souhaiterait pas réintégrer l'ESSEC, elle devra avertir la Direction des Ressources Humaines avant le 4 janvier 2016. Le contrat de travail sera alors conventionnellement rompu dans les meilleurs délais de ladite notification. Cette rupture ne sera soumise à aucun préavis effectué par la salariée ».
En pièce 14 de la salariée figure un courriel adressé par elle à l'association Groupe Essec le 3 janvier 2016. Il en ressort que Mme X. indiquait avoir fait part de ses ambitions soit d'être directrice juridique soit « a minima » d'avoir plus de moyens pour sa fonction ; que déplorant que ces ambitions ne soient pas satisfaites par l'association Groupe Essec et que sa rémunération ne soit pas augmentée, la salariée en tirait la conséquence suivante : « A l'issue de ma période de mobilité externe volontaire débutée en juin 2015, j'en tire à nouveau les conséquences en confirmant préférer la rupture conventionnelle du contrat de travail qui me lie à l'Essec plutôt que ma réintégration selon ses actuelles stipulations ».
La salariée a donc clairement manifesté, le 3 janvier 2016, son intention de ne pas réintégrer l'ESSEC pour des raisons qui, en définitive, sont indifférentes à la solution du litige. Ce choix fait par la salariée déclenchait nécessairement l'application de l'article 4 du contrat : « Le contrat de travail sera alors conventionnellement rompu dans les meilleurs délais de ladite notification. Cette rupture ne sera soumise à aucun préavis effectué par la salariée ».
Cette clause est en contrariété avec l'article L. 1222-15 du code du travail. En effet, schématiquement, le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité :
- le code du travail prévoit que le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu que cette constitue une démission,
- tandis que le contrat liant Mme X. à l'association Groupe Essec renvoie à une rupture conventionnelle.
Certes, l'association Groupe Essec invoque l'article 1171 du code civil et conclut au caractère abusif de la clause litigieuse, indiquant en substance que cette clause a été rédigée par Mme X. elle-même et qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cependant, l'association Groupe Essec vise manifestement un article du code civil qui n'était pas applicable à l'époque du litige puisqu'il est issu de l'ordonnance du 10 février 2016. En outre, et à supposer même que cette disposition trouve application, la loi n'envisage la question d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que dans le cadre d'un contrat d'adhésion pour des clauses non négociables. Tel n'est de toute évidence pas le cas de l'avenant litigieux. Ainsi, à double titre, le moyen invoqué par l'association Groupe Essec est inopérant et la clause discutée doit trouver application. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DIX-SEPTIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 1er JUILLET 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/05012. N° Portalis DBV3-V-B7B-R4T6. CONTRADICTOIRE. Code nac : 80A. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE (Section E) : R.G. n° F16/00477.
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
ASSOCIATION GROUPE ESSEC
[...], [...], [...], Représenté par Maître Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Maître Richard R. de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R095
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité française, [adresse], Représentant : Maître Antonio A. de la SELARL D. - V. & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Composition de la cour : L'affaire a été fixée à l'audience publique du 15 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller.
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces même magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X. à la somme brute de 4 370 euros,
- requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association Groupe Essec à verser à Mme X. les sommes suivantes :
* 4.370 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 12.960 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.296 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et ordonne la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
- ordonné à l'Association Groupe Essec de remettre à Mme X. une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes au jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de l'Association Groupe Essec.
Par déclaration adressée au greffe le 23 octobre 2017, l'Association Groupe Essec a interjeté appel de ce jugement.
Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 20 avril 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2020.
[*]
Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2019, l'Association Groupe Essec demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Cergy en ce qu'il est entré en voie de rejet des demandes de condamnation à son encontre au titre d'une quelconque discrimination et d'heures supplémentaires au profit de Mme X.,
- infirmer le jugement du 7 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Cergy en ce qu'il :
- a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X. à la somme brute de 4.370 euros,
- a requalifié la démission de Mme X. en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à Mme X. les sommes suivantes :
* 4.370 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.960 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.296 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et ordonne la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
- lui a ordonné de remettre à Mme X. une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes au jugement,
- a mis les éventuels dépens de l'instance à sa charge,
- l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et rejugeant à nouveau,
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- constater la mauvaise foi et le caractère infondé de l'action de Mme X.,
- qualifier la rupture du contrat de Mme X. en démission,
- condamner Mme X. à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 mars 2020, Mme X. demande à la cour de :
- débouter le Groupe Essec de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné et débouté le Groupe Essec au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un certificat de travail conforme à son jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- mis les dépens à la charge du Groupe Essec,
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de :
- reconnaissance d'iniquité salariale et de condamnation du Groupe Essec à un rappel de salaire et à une indemnité de congés payés y afférente,
- privation d'effet de sa convention de forfait et de condamnation du Groupe Essec au paiement d'heures supplémentaires,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- fixé le salaire de référence et l'indemnité de licenciement qu'à 4.370 euros,
- fixé l'indemnité compensatrice de préavis qu'à 12.960 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents qu'à 1.296 euros,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes qu'aux chiffres précités,
- fixé l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à 30.000 euros,
- dit que les condamnations prononcées n'emportaient intérêts au taux légal qu'à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales,
en conséquence de quoi et statuant à nouveau,
- condamner le Groupe Essec à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Groupe Essec aux entiers dépens,
- dire qu'elle a fait l'objet d'iniquité salariale,
- condamner le Groupe Essec à un rappel de salaire de 92.422,49 euros pour iniquité salariale,
- condamner le Groupe Essec à une indemnité de congés payés de 9.242,25 euros y afférente,
- dire que la convention de forfait a été privée d'effet,
- condamner le Groupe Essec au paiement de 115.860,32 euros d'heures supplémentaires,
- fixer le salaire de référence à 5.916,67 euros,
- fixer la condamnation du Groupe Essec à :
* 5.916,67 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 17.750 euros d'indemnité de préavis,
* 1.775 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 35.000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner au Groupe Essec de remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie modifié conformes aux chiffres précités,
- rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2016 concernant les créances salariales,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR,
L'Essec est un établissement d'enseignement supérieur privé ayant pour objet principal de diffuser et de promouvoir, par l'enseignement et la recherche appliquée notamment aux sciences sociales, économiques, commerciales et juridiques, la formation et le perfectionnement des responsables de la gestion des entreprises industrielles et commerciales du secteur public et privé.
Mme X. a été engagée par l'Association Groupe Essec en qualité de chargée de mission RH pour remplacer Mme Y., par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mai 2011.
Mme X. percevait une rémunération brute mensuelle de 3.333,33 euros.
Un avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2011 prévoyait l'embauche de Mme X. pour une durée indéterminée. Mme X. était alors embauchée en qualité d'expert juridique RH, spécialiste fiscalité.
En mars 2015, Mme X. a sollicité le bénéfice d'un congé de mobilité externe de 7 mois, de juin à décembre 2015. Un avenant a été signé le 1er avril 2015, prévoyant que le contrat de travail liant la salariée à l'Association Groupe Essec était suspendu du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016.
Fin 2015, Mme X. sollicitait, par courriel du 3 janvier 2016, l'obtention d'un poste de directrice juridique. Des pourparlers étaient engagés entre les parties et une rupture conventionnelle était envisagée.
Mme Mme X. refusant les propositions formulées, l'Essec prenait acte de sa démission de ses fonctions, à compter du 31 janvier 2016, et lui adressait ses éléments de fin de contrat.
Le 21 juillet 2016, Mme X. a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester la rupture de son contrat de travail, lui faire prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur l'égalité de traitement :
Mme X. qui rappelle qu'elle était cadre, affirme que malgré la qualification de chargée de mission et de son emploi de responsable, elle ne percevait pas une rémunération identique à celle d'autres chargés de mission ou responsables alors même qu'elle encadrait. En particulier, elle compare sa situation à celle de M. Nicolas T., ancien responsable du recrutement Étudiants pour en déduire une inégalité de traitement. Aussi, elle reproche à l'association Groupe Essec de n'avoir pas déféré à sa sommation de communiquer, en s'abstenant de produire les éléments relatifs à six autres salariés qui, comme elle, occupaient des postes de responsables (Mmes K., M., S., M., M. et Y.).
En réplique, l'association Groupe Essec soutient que Mme X. n'avait pas de responsabilité d'encadrement puisqu'elle n'avait personne sous ses ordres ; que le service juridique d'une institution académique n'est qu'un service support de l'activité et qu'ainsi, Mme X., qui occupait un poste sédentaire, ne peut prétendre à une rémunération équivalente à un poste au sein d'un service commercial pour la vente des programmes académiques ayant un périmètre mondial ; que les personnes auxquelles Mme X. se compare disposaient de missions supérieures en ce qu'elles étaient vouées à manager des équipes, à se déplacer sur les différents campus de l'ESSEC à travers le monde, et/ou avaient une ancienneté plus importante que l'intimée ; qu'au surplus, la comparaison de Mme X. avec d'autres salariés ayant son âge, son ancienneté et n'effectuant pas de déplacements internationaux (tels que Mme C.-F., Mme C., M. S., M. M., Mme Y., Mme F.) dément l'inégalité de traitement dont elle se prévaut.
S'agissant de M. T., l'association Groupe Essec en présente le profil et relève plus particulièrement qu'il occupait un poste clé sur le recrutement annuel de plus de 1.500 étudiants, qu'il devait accomplir de nombreux déplacements internationaux et qu'il a occupé un poste de directeur Développement avec 30 personnes à manager.
Le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
En l'espèce, Mme X. a été engagée le 12 mai 2011 en qualité de chargée de mission RH puis, à compter du 1er octobre 2011, en qualité d'expert juridique RH, spécialiste fiscalité. Le dernier avenant à son contrat de travail classe Mme X. en catégorie 6, échelon B, statut « cadre autonome ». Son contrat prévoit qu'elle percevait une rémunération annuelle de 42.000 euros bruts versés en douze mensualités.
Bien qu'elle le déplore et relie cette question à l'accomplissement de nombreuses heures de travail, Mme X. n'avait aucune fonction d'encadrement, n'ayant pas d'équipe à diriger. Elle ne peut donc nullement se comparer à d'autres salariés ayant, quant à eux, des fonctions managériales, ce qui est le cas de M. T. (lequel était « responsable communication » au sein de la direction générale de la formation initiale).
De fait, M. T. percevait en 2015 une rémunération annuelle de 71.000 euros bruts comme en atteste la pièce 33 de la salariée (bulletin de salaire de M. T. du mois de juin 2015). Cependant, tant le bulletin de paie que l'organigramme que la salariée produit en pièce 27 (organigramme 2015), montrent que M. T. n'était plus seulement, en 2015, « responsable » mais « directeur business development ». Il en résulte que l'élément de comparaison n'est pas pertinent.
L'organigramme que la salariée produit en pièce 26 (organigramme 2014) montre que Mme X. était placée sous la responsabilité du directeur général adjoint chargé des affaires internes. Ce dernier dirigeait huit directeurs et trois responsables, dont Mme X. (« responsable juridique ») et Mme K. à laquelle elle se compare.
Le même organigramme montre que les salariées suivantes occupaient, comme Mme X., des postes de « responsable » au sein d'autres directions de l'association Groupe Essec :
- Mme M. (responsable programmes au sein de la direction de la formation permanente),
- Mme S. (responsable promo admission au sein de la direction de la formation initiale),
- Mme M. (responsable service doyen au sein de la direction des affaire académiques).
L'organigramme que Mme X. produit en pièce 27 (organigramme 2015) montre que Mme M. occupait le poste de responsable contrôle de gestion au sein de la direction de la formation permanente.
Quant à Mme Y., il s'agit de la salariée que Mme X. a remplacée.
Le panel de comparaison présenté par Mme X. offre l'apparence d'une pertinence en ce que toutes les salariés ci-dessus « à savoir Mmes K., M., S., M. et M. » occupaient, comme elle, des postes de « responsables ».
Toutefois, hormis le positionnement hiérarchique de ces salariées - comparable à celui de Mme X. ' et l'appellation du poste qu'elles occupaient - poste de « responsable » - Mme X. ne dit rien du contenu substantiel de leurs fonctions et, en particulier, ne dit pas en quoi les fonctions concrètement exercées par ces salariées étaient comparables aux siennes.
En revanche, la situation de Mme Y. est manifestement comparable à celle de Mme X. puisque cette dernière l'a remplacée. Les deux salariées sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle et Mme X. a en outre le CAPA (cf. pièce 19 de l'employeur).
En pièce 18, l'association Groupe Essec produit deux bulletins de paie de Mme Y. : celui du mois de mars 2009 (pour la période du 17 mars 2009 au 31 mars 2009) et celui du mois de juin 2015. En 2009 (année de son engagement), Mme Y. « responsable RH » percevait un salaire de 3 333,33 euros (ce qui représente un revenu brut annuel de 40.000 euros à comparer aux 42.000 euros de Mme X.). En juin 2015, après 6 ans d'ancienneté (à comparer avec l'ancienneté de Mme X. à la même époque : environ 4 ans), Mme Y. percevait une rémunération annuelle brute d'environ 61.500 euros mais il n'est pas discuté qu'à cette époque, elle encadrait 3 personnes.
En définitive, Mme X. qui pour l'essentiel se fonde sur des organigrammes échoue dans la démonstration qui lui incombe, à savoir de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en lien avec une inégalité de traitement.
Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires :
Mme X. conclut au caractère inopposable de sa convention de forfait.
Au soutien de cette prétention, la salariée reproche en substance à l'association Groupe Essec :
- de ne pas avoir établi un décompte précis de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses jours de repos,
- de ne pas préciser que son accord collectif stipule 210 jours et non 218 jours de travail et se garde de le produire, étant précisé qu'en 2014, elle a travaillé 215 jours soit 5 jours de plus que la garantie prévue par l'accord collectif de l'ESSEC,
- de ne pas avoir systématiquement tenu l'entretien annuel.
Elle réclame ensuite paiement des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées.
En réplique, l'association Groupe Essec expose que si l'accord collectif ne prévoit rien en matière de suivi du salarié, une convention de forfait peut toujours être valablement conclue par l'employeur, mais seulement si ce dernier remplit les conditions prévues par l'article L. 3121-65 du code du travail parmi lesquelles figure l'obligation d'établir un document de contrôle indiquant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées par le salarié ; qu'or, elle dispose d'un document de contrôle des jours travaillés.
Elle conteste ensuite l'accomplissement, par Mme X. des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées, estimant en outre n'avoir jamais demandé à la salariée d'effectuer de telles heures.
L'article L. 3121-46 du code du travail prévoit qu'un entretien annuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'association Groupe Essec ait organisé avec Mme X., sur l'intégralité de la période durant laquelle la salariée était liée à elle par un contrat de travail prévoyant un forfait annuel en jours, l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 dans sa version applicable visé ci-dessus. Mme X. apporte même la démonstration de ce que cet entretien n'avait pas systématiquement lieu (cf. l'attestation de son ancienne DRH - Mme B. - en pièce 48 de la salariée)
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens présentés par la salariée, dès lors que l'employeur n'établit pas que les années litigieuses ce constat suffit à lui seul, à faire droit à la demande de la salariée et, infirmant le jugement, de dire que la convention de forfait de Mme X. lui est inopposable.
La convention de forfait étant inopposable à Mme X., celle-ci peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires s'il s'avère qu'elle en a accomplies.
Avant d'examiner au fond la demande d'heures supplémentaires, il convient de préciser qu'en page 12 des conclusions de l'association Groupe Essec, cette dernière rappelle certaines règles de prescription en exposant : « Pour être plus sérieux, rappelons que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a par la suite réduit les délais de prescription, qui dépendent désormais de la nature de la demande :
- 12 mois (…),
- 2 ans (…),
- 3 ans : rappels de salaires (heures supplémentaires, rémunération variable) ;
en l'espèce 2013 »
La cour comprend de cette argumentation que l'association Groupe Essec soulève une prescription qu'elle situe à 2013.
Mme X. n'offre pas sur ce point la réplique.
Il convient d'examiner la question de la prescription avant de trancher au fond.
(a) Sur la prescription :
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Ce texte est issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013.
Avant l'entrée en vigueur de cette loi, la prescription de l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par le code civil et se prescrivait par cinq ans s'agissant d'une action personnelle (article 2224 du code civil).
Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de 5 à 3 ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.
La demande de rappel de salaires de Mme X. porte sur la période comprise entre le 16 mai 2011 et le 29 mai 2015. Une partie de cette demande de rappel de salaire était régie par la prescription antérieure (la demande portant sur les salaires entre le 16 mai 2011 et le 16 juin 2013) et l'autre partie de cette demande est régie par la loi de prescription telle qu'issue de la loi du 14 juin 2014 (la demande portant sur les salaires entre le 16 juin 2013 et le 29 mai 2015).
L'action portant sur les salaires de Mme X. du 16 mai 2011 au 16 juin 2013 était prescrite par 5 ans sous l'empire de la loi antérieure. Mme X. pouvait donc saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 31 mai 2016 (le salaire étant payé en fin de mois) pour obtenir le rappel de salaire le plus ancien. Est entre temps intervenue la loi du 14 juin 2013 s'appliquant immédiatement à compter du 17 juin 2013. L'application immédiate de la loi de prescription conduirait à allonger le délai de prescription de l'action de Mme X. jusqu'au 17 juin 2016 sous réserve que le délai de prescription antérieur ne soit pas dépassé. Mme X. a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 21 juillet 2016 (cf. courrier d'envoi de sa saisine du conseil de prud'hommes). Elle est donc partiellement prescrite en ses demandes. Plus précisément, ses demandes de rappel de salaire antérieures au mois de juillet 2011 sont prescrites. La demande de la salariée est donc recevable pour la période du mois de juillet 2011 au 29 mai 2015.
(b) Au fond, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme X. apporte aux débats les éléments factuels suivants :
- des courriels montrant qu'il pouvait lui arriver de travailler tardivement,
- une copie d'écran de ses fichiers professionnels, montrant, pour chaque fichier, les heures parfois tardives et parfois le week-end, d'enregistrement desdits fichiers,
- des décomptes (en pièces 40, 41, 44, 46 et 47) couvrant la période comprise entre le mois de mai 2011 inclus et le mois de mai 2015 inclus, et récapitulant, de façon quotidienne (avec à chaque fois une synthèse hebdomadaire), les heures qu'elle prétend avoir effectuées.
Certes, l'employeur indique ne jamais avoir demandé à Mme X. d'accomplir des heures supplémentaires. L'association Groupe Essec, se croyant liée à Mme X. par une convention de forfait en jour, peut effectivement n'avoir jamais demandé à sa salariée d'accomplir des heures supplémentaires. Mais cette observation ne fait pas sens dès lors qu'à l'époque à laquelle les heures ont été accomplies, l'employeur, qui se croyait lié à la salariée par une convention de forfait, n'avait nullement à lui demander l'accomplissement d'heures supplémentaires. Il sera incidemment observé que l'accomplissement d'heures supplémentaires peut simplement résulter d'un accord implicite de l'employeur, lequel peut résulter des circonstances de l'accomplissement des heures supplémentaires, et en particulier, comme c'est le cas en l'espèce, de l'envoi tardif de certains courriels de la salariée.
En revanche, c'est à raison que l'employeur fait observer que les journées de Mme X. ne démarraient pas à 8 heures, les pièces de la salariée (hormis ses décomptes en pièces 40, 41, 44, 46 et 47) montrant surtout qu'elle finissait son travail tard le soir plutôt que tôt le matin. Toutefois, il n'est pas inutile de rappeler qu'il appartient à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
En définitive, la cour dispose d'éléments suffisants pour estimer que Mme X. a accompli des heures supplémentaires sur la période non prescrite.
Elles lui seront rétribuées sur la base de son salaire horaire contractuel et non sur le salaire horaire que la salariée évalue par suite d'un rappel en lien avec sa demande, rejetée, fondée sur l'inégalité de traitement.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra, infirmant de ce chef le jugement, de condamner l'association Groupe Essec à payer à Mme X. la somme de 37.582,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Sur la rupture :
Mme X. se fonde sur l'avenant du 1er avril 2015 à son contrat de travail, sur l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ainsi que sur l'article L. 1222-14 du code du travail. Elle expose qu'elle a réalisé une mobilité externe de sept mois de juin à janvier 2016 et qu'à sa réintégration, en janvier 2016, après qu'une négociation sur la rupture a achoppé, aucun poste ne lui a été proposé et qu'au visa de son avenant, c'est à tort que l'employeur a considéré qu'elle avait démissionné.
Pour sa part, l'association Groupe Essec analyse le courriel de Mme X. en date du 3 janvier 2016 comme une démission, en application de l'article L. 1222-15 du code du travail. Elle soutient que l'article 4 de l'avenant du 1er avril 2015 ne trouve pas à s'appliquer et à tout le moins, qu'il constitue une clause abusive, au regard de l'article 1171 du code civil.
L'article L. 1222-13 du code du travail dispose que la période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.
Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possibles à tout moment avec l'accord de l'employeur.
L'article L. 1222-14 précise qu'à son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Pour sa part, l'article L. 1222-15 prévoit que lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13.
Enfin, l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, par avenant du 1er avril 2015 (pièce 13 de la salariée), Mme X. a été admise au bénéfice d'un congé de mobilité externe qui avait pour effet la suspension du contrat de travail du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016. L'article 3 de l'avenant stipule : « ARTICLE 3 - Retour dans l'entreprise - A son retour dans l'association Groupe Essec, la salariée retrouvera de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, avec une qualification et une rémunération au moins équivalente, ainsi que le maintien à titre personne, au minimum, de sa classification. » L'article 4 prévoit, pour sa part : « ARTICLE 4 - Cessation du contrat de travail - Dans le cas où la salariée ne souhaiterait pas réintégrer l'ESSEC, elle devra avertir la Direction des Ressources Humaines avant le 4 janvier 2016. Le contrat de travail sera alors conventionnellement rompu dans les meilleurs délais de ladite notification. Cette rupture ne sera soumise à aucun préavis effectué par la salariée ».
En pièce 14 de la salariée figure un courriel adressé par elle à l'association Groupe Essec le 3 janvier 2016. Il en ressort que Mme X. indiquait avoir fait part de ses ambitions soit d'être directrice juridique soit « a minima » d'avoir plus de moyens pour sa fonction ; que déplorant que ces ambitions ne soient pas satisfaites par l'association Groupe Essec et que sa rémunération ne soit pas augmentée, la salariée en tirait la conséquence suivante : « A l'issue de ma période de mobilité externe volontaire débutée en juin 2015, j'en tire à nouveau les conséquences en confirmant préférer la rupture conventionnelle du contrat de travail qui me lie à l'Essec plutôt que ma réintégration selon ses actuelles stipulations ».
La salariée a donc clairement manifesté, le 3 janvier 2016, son intention de ne pas réintégrer l'ESSEC pour des raisons qui, en définitive, sont indifférentes à la solution du litige. Ce choix fait par la salariée déclenchait nécessairement l'application de l'article 4 du contrat : « Le contrat de travail sera alors conventionnellement rompu dans les meilleurs délais de ladite notification. Cette rupture ne sera soumise à aucun préavis effectué par la salariée ».
Cette clause est en contrariété avec l'article L. 1222-15 du code du travail. En effet, schématiquement, le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité :
- le code du travail prévoit que le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu que cette constitue une démission,
- tandis que le contrat liant Mme X. à l'association Groupe Essec renvoie à une rupture conventionnelle.
Le code du travail qui est un droit protecteur du salarié, érige un socle de protection minimum et les parties sont toujours libres de convenir d'une protection plus ample. C'est manifestement le cas de l'avenant conclu entre Mme X. et l'association Groupe Essec le 1er avril 2015, cet avenant constituant la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil.
Certes, l'association Groupe Essec invoque l'article 1171 du code civil et conclut au caractère abusif de la clause litigieuse, indiquant en substance que cette clause a été rédigée par Mme X. elle-même et qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cependant, l'association Groupe Essec vise manifestement un article du code civil qui n'était pas applicable à l'époque du litige puisqu'il est issu de l'ordonnance du 10 février 2016. En outre, et à supposer même que cette disposition trouve application, la loi n'envisage la question d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que dans le cadre d'un contrat d'adhésion pour des clauses non négociables. Tel n'est de toute évidence pas le cas de l'avenant litigieux. Ainsi, à double titre, le moyen invoqué par l'association Groupe Essec est inopérant et la clause discutée doit trouver application.
En manifestant le choix de ne pas réintégrer l'entreprise, ce n'étaient donc pas les dispositions de l'article L. 1222-15 du code du travail qui s'appliquaient, mais les stipulations plus favorables du contrat. Les parties devaient par conséquent convenir d'une « rupture conventionnelle dans les meilleurs délais » sans que la décision de Mme X. puisse revêtir les effets d'une démission puisque l'avenant renvoyait à une négociation.
Il ressort des explications de Mme X. que les parties ne s'accordant pas sur les termes de la rupture conventionnelle, elle a demandé sa réintégration à son poste ce que confirment le contenu du courriel adressé par la salariée à son employeur le 14 janvier 2016 (cf. pièce 15) et celui que son employeur lui a adressé le 19 janvier 2016 (cf. pièce 16).
Puisque le contrat écartait l'application de l'article L. 1222-15 du code du travail et puisqu'il vient d'être jugé que la décision prise par la salariée le 3 janvier 2016 ne produisait pas les effets d'une démission, il faut admettre que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter que d'un accord entre les parties et donc d'une rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle ayant échoué, Mme X. était donc toujours en lien avec son employeur, et pouvait, comme cela a été le cas à partir du 14 janvier 2016 (cf. courriels échangés entre la salariée et l'employeur dans le courant du mois de janvier 2016 en pièces 14 à 21) revenir sur sa position et demander sa réintégration.
Force est d'ailleurs de constater incidemment que la demande de réintégration a été formée par la salariée avant le 31 janvier 2016, terme de sa mobilité externe.
Il reste donc à savoir si l'association Groupe Essec a ou non satisfait à son obligation de réintégrer la salariée à son précédent emploi ou à un emploi similaire. L'association Groupe Essec prétend qu'elle a satisfait à cette obligation, ce que Mme X. conteste.
Sur cette question, il apparaît que par courriel du 19 janvier 2016, l'association Groupe Essec écrivait à Mme X. en lui indiquant quelles étaient les conditions financières de la rupture conventionnelle (qui n'étaient pas acceptées par Mme X.) et achevait ainsi son courrier : « Nous n'irons pas plus loin que le cadre légal et ne donnerons en conséquence pas suite à votre contre proposition. Votre contrat sera donc réputé rompu le 31 janvier 2016 et votre solde de tout compte vous sera adressé ».
Cette dernière mention ne laisse rigoureusement aucune place au doute l'association Groupe Essec n'entendait aucunement réintégrer Mme X. et a manifesté par ce courriel sa volonté de rompre le contrat de travail, sans notifier de motifs de licenciement.
La rupture du contrat de travail est donc bien imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes qui sera confirmé sur ce point.
Mme X. peut prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (près de 4 ans), de son niveau de rémunération brute, du fait que Mme X. a été déclarée comme démissionnaire dans son attestation Pôle emploi, il convient d'évaluer à 30 000 euros le préjudice lié à la perte, par Mme X., de son emploi. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc de ce chef confirmé en ce qu'il s'est livré à une juste appréciation du préjudice.
L'article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d'ordonner, d'office, le remboursement par l'association Groupe Essec aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
La demande de Mme X. n'ayant pas été accueillie du chef d'une inégalité de traitement, le conseil de prud'hommes a évalué les indemnités de rupture sur la base des références salariales appropriées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et la demande tendant à leur capitalisation :
Les condamnations à des rappels de salaire et à des indemnités de rupture produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à savoir le 25 juillet 2016. La condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui fait l'objet d'une confirmation, produit intérêts à compter de la date du jugement du conseil de prud'hommes c'est-à-dire le 7 septembre 2017. Le jugement sera donc confirmé sur la question des intérêts.
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande ayant été formée par Mme X. et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à l'association Groupe Essec de remettre à Mme X. une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie modifié conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'association Groupe Essec sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner l'association Groupe Essec à payer à Mme X. une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au mois de juillet 2011,
CONDAMNE l'association Groupe Essec à payer à Mme X. la somme de 37 582,80 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
DONNE injonction à l'association Groupe Essec de remettre à Mme X. une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie modifié conformes au présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par l'association Groupe Essec aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'association Groupe Essec à payer à Mme X. la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE l'association Groupe Essec aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8261 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 -Loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Domaine d'application
- Protection contre les clauses abusives en droit du travail - Argument invoqué par l’employeur
- 9748 - Protection contre les clauses abusives en droit du travail – Droit commun de l’art. 1171 C. civ.