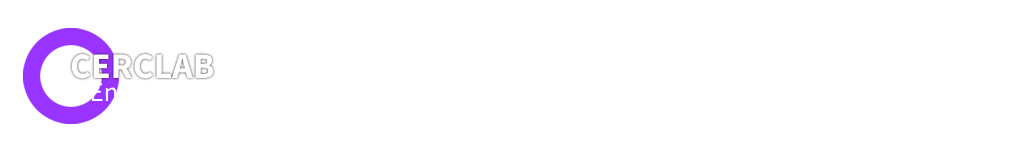CA NÎMES (1re ch. civ.), 12 juillet 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7787
CA NÎMES (1re ch. civ.), 12 juillet 2018 : RG n° 16/02919
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « M. X. et Mme Y. épouse X. ont conclu avec la Sa Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au cours de l'année 2004 trois prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de plusieurs immeubles au titre d'opérations de construction. S'estimant victimes de l'escroquerie « Apollonia », dont l'instruction est toujours en cours, ils ont cessé de régler les échéances de prêts contractés. »
Extraits (motifs) : 1/ « Sur la demande de sursis à statuer : L'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation de dommages causés par l'infraction. En dehors de cette hypothèse le sursis à statuer est apprécié discrétionnairement par le juge dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au cas d'espèce, il est constant que la demande de la banque ne tend pas à la réparation d'un dommage mais à l'exécution d'un contrat de sorte que le prononcé du sursis à statuer est facultatif. Il sera relevé par ailleurs que le CIFD n'est pas à ce jour mis en examen.
Enfin, l'action en paiement des sommes dues au titre des prêts après déchéance du terme n'est pas fondée sur l'acte authentique de prêt dont la force probante et le caractère exécutoire sont contestés, mais sur les actes sous signature privée constituée par l'offre préalable de prêt acceptée, de sorte que les dispositions de l'article 312 du code de procédure civile ne peuvent pas non plus être invoquées. L'appréciation par le juge civil de la validité de l'offre au regard des règles d'ordre public du code de la consommation et les conséquences civiles qu'il convient d'en tirer sur le principe et l'étendue des obligations du débiteur dans l'instance en recouvrement de sommes restant dues ne dépend pas de l'issue de l'instance en cours. La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer. »
2/ « Sur la demande de renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne :La question préjudicielle qui est soumise à la cour par les époux X. porte sur le point de savoir si les dispositions du droit de l'Union européenne, et en particulier celles de la Directive du 25 octobre 2011 qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux, développant leur patrimoine, constituent des consommateurs.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs propose, sur le modèle des autres directives communautaires, une définition du consommateur qui est la reprise exacte de la définition donnée par la proposition de directive du 8 octobre 2008 relative aux droits des consommateurs. Le consommateur est ainsi désigné, dans l'article 2 de la directive de 2011, comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Il est constant que tant la directive de 2011 retranscrite en droit interne par la loi Hamon que celle de 2008 n'avaient aucune existence juridique à la date de la signature des prêts litigieux par les époux X.
Il est tout aussi vrai qu'avant cette directive, les textes européens, les directives ou les règlements de Bruxelles et de Rome, et la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes limitent le bénéfice des dispositions consuméristes destinées à corriger le déséquilibre entre les parties aux personnes physiques contractant pour la satisfaction de leurs besoins personnels et pour un usage étranger à leur activité professionnelle. Le conseil des communautés européennes puis de l'Union européenne a été conduit à plusieurs reprises à élaborer des directives tendant à harmoniser la réglementation des rapports entre professionnels et consommateurs au nombre desquelles la directive 93/13/ « contribution à l'entretien et l'éducation » du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'élimination des clauses abusives dont l'article 2, sous b) définit le consommateur comme toute personne physique qui dans les contrats... agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et sous c), définit le terme «professionnel» comme visant « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée ».
L'analyse de la définition de consommateur en droit communautaire permet d'établir que celle-ci repose sur deux critères, un critère finaliste qui renvoie au fait que le consommateur doit agir à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et plus particulièrement de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (en d'autres termes, le consommateur ne peut être que celui qui contracte pour ses besoins personnels ou domestiques) et une finalité personnelle du contrat conclu, critère essentiel qui permet de savoir si on est en présence ou non d'un consommateur nécessitant d'être protégé sur le terrain du droit de la consommation.
L'article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu L. 313-2 du dit code) exclut du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques qui à titre habituel même accessoire à une autre activité, procurent sous quelque forme que ce soit des fractions d'immeuble en jouissance.
Les époux X. ne démontrent pas que cet article serait contraire aux dispositions communautaires, aucune d'elle ne visant expressément « une activité professionnelle » exclusive de l'exercice par une même personne physique de deux activités professionnelles à titre habituel, l'une à titre principal et l'autre à titre accessoire, qui l'une comme l'autre relèvent de la qualification « professionnelle ».
Les époux X. estiment que la Cour de Cassation dans ses deux arrêts du 12 octobre 2016 et du 25 janvier 2017 n'a pas fait application du critère de finalité professionnelle de la transaction pour définir le statut ou non du consommateur, conformément au principe 2014/17/EU du 4 février 2014 et à la directive 93/13 CE modifié par la directive 2011 ‘83 du 25 octobre 2011.
La Cour de Cassation relevant que les lots de copropriété acquis étaient destinés à la location et que le propriétaire emprunteur était inscrit au registre du commerce des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, en a déduit que le prêt contracté pour financer l'acquisition des dits lots était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire.
La location habituelle, et ce, bien que saisonnière, de tels lots en meublés caractérise, aux termes d'une jurisprudence bien établie émanant tant de la Cour de cassation que du Conseil d'Etat, préexistante aux affaires dites « Appolonia », l'utilisation professionnelle des lots et l'exercice par le loueur en meublés d'une activité professionnelle. La jurisprudence apprécie au cas par cas le caractère habituel de la location.
Dès lors, la cour de cassation a bien fait dans ses arrêts critiqués des 12 octobre 2016 et 25 janvier 2017 application du critère de finalité professionnelle. Le reproche n'est pas fondé.
M. X. pour des raisons fiscales s'est inscrit au RCS en qualité de Loueur en Meublé Professionnel. L'ampleur des investissements immobiliers réalisés par le couple, ne s'est pas limité à la seule acquisition des trois appartements en copropriété financée par le CIFD mais en a acquis plusieurs pour plus de 1.367.711 d'euros, investissement financé à 100 % par des prêts d'une durée oscillant entre 15 et 20 ans avec pour chaque lot acquis un contrat de réserve location accompagné d'un bail signé le même jour. Le montant de remboursement annuel qui atteint 61.110 euros HT devait être remboursé pour une grande partie par les revenus des locations. Il n'est pas contesté que certains des lots acquis sont toujours loués à ce jour. La location habituelle des lots acquis est établie.
M. X. a certes une activité professionnelle principale qui est celle de médecin. Il n'en demeure pas moins qu'il a également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité.
Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 2018 qui va l'amener à déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l'article 151 septies § VII du code général des impôts, ne renvoie pas à la question de l'objectif poursuivi, donc de la finalité, mais à celle des critères fixés pour poursuivre cet objectif. Le conseil a considéré qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération fiscale à une condition spécifique aux commerçants, (en l'espèce l'inscription au registre du commerce et des sociétés) alors même que l'activité de loueur de biens immeubles ne constitue pas en soi un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé.
Il s'en déduit que le caractère professionnel du loueur d'immeuble (que l'activité soit civile ou commerciale) n'est pas la question posée au Conseil constitutionnel et donc ne remet pas en question l'analyse de la cour de cassation qui consiste à considérer que l'activité de loueur en meublé fut-elle accessoire, écarte la notion de consommateur de même que l'inscription au registre du commerce et des sociétés.
La jurisprudence de la cour de cassation n'étant pas contraire à la notion de consommateur définie par les instances communautaires et plus particulièrement à l'article 2 b et c de la directive précitée du 5 avril 1993 rien ne justifie le renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne. »
3/ « Sur la prescription de l'action de la banque : L'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur.
Aux termes de l'article L. 312-3, 2°, ancien, du code de la consommation, sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, en propriété ou en jouissance.
Ainsi si l'investissement immobilier locatif d'un particulier peut relever du régime propre au crédit immobilier à la consommation, encore faut-il qu'il ne corresponde pas à l'exercice d'une activité professionnelle.
Enfin la soumission volontaire des parties aux dispositions régissant le crédit immobilier à la consommation ne suffit pas à emporter son application.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les trois opérations de crédit étaient destinées à permettre l'acquisition d'appartements dans une copropriété, en vue de leur location, et avaient nécessité l'inscription de M. X. au RCS en tant que loueur en meublé professionnel.
Il a été conclu ci-dessus à l'existence d'une activité professionnelle des emprunteurs en raison de leur statut de loueur en meublé professionnel, de l'ampleur de l'investissement global dans lequel s'inscrivaient les prêts litigieux, et de la conclusion de baux commerciaux sur les biens acquis.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la prescription biennale applicable au seul consommateur conformément à l'article L. 312-3-2°devenu L. 313-2-2° du Code de la consommation en vertu de l'ordonnance 2006-301 du 14 mars 2016, s'appliquait à l'espèce.
L'action en paiement de la banque est soumise à la prescription quinquennale. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JUILLET 2018
- 5729 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Devoirs du juge
- 5824 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Crédit à la consommation
- 5832 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : crédit
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes