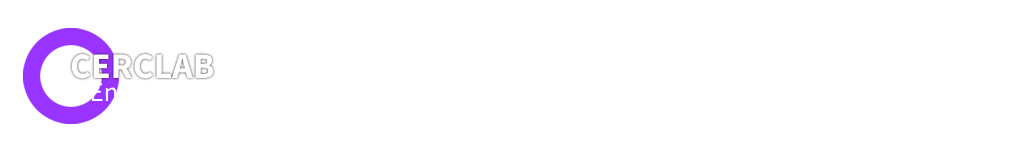CASS. CIV. 1re, 18 février 1997
 CA TOULOUSE (2e ch.), 17 janvier 1995
CA TOULOUSE (2e ch.), 17 janvier 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 2068
CASS. CIV. 1re, 18 février 1997 : pourvoi n° 95-12962 ; arrêt n° 333
Extrait : « Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant ; que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l’emprunt avait été souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’application à la cause de la législation relative aux clauses abusives ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 95-12962. Arrêt n° 333.
DEMANDEUR à la cassation : 1°/ Société Comte X. 2°/ Monsieur X. 3° Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : °1/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn-et-Garonne 2°/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance SCC 3°/ Monsieur Y.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Comte X., société anonyme, dont le siège est […], 2°/ Monsieure X., 3°/ Madame X., demeurant ensemble […], en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est […], 2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance SCC, dont le siège est […], 3°/ de Monsieur Y., demeurant […], défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comte X. et des époux X., de Maître Ricard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance SCC, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, par un acte du 4 octobre 1989, M. X., président-directeur général de la société anonyme Comte X., a souscrit auprès du Crédit agricole un emprunt d’un million de francs destiné à couvrir les besoins de trésorerie de cette société ; que, par le même acte, M. X. et son épouse, ainsi que M. Y., se sont portés cautions du remboursement de ce prêt ; que, le 7 avril 1990, M. Y. a fait connaître à la banque une transaction qu’il avait conclue avec M. X. pour mettre fin à ses fonctions d’administrateur et de directeur général sous la condition que M. X. et la société assument l’intégralité des obligations financières souscrites envers le Crédit agricole ; que, par le même courrier, il informait la banque de la révocation immédiate de son engagement de caution ; qu’après avoir, en vain, d’abord sommé la société de fournir une garantie de substitution, puis l’avoir mise en demeure, ainsi que les cautions, de régler la totalité du prêt devenu selon lui immédiatement exigible, le Crédit agricole a assigné la société et les trois cautions en paiement ; que l’arrêt attaqué a condamné la société et les époux X. à payer au Crédit agricole la somme de 1.000.000 francs avec intérêts au taux légal et les a déboutés des demandes reconventionnelles qu’ils avaient formées contre cette banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société anonyme Comte X. et les époux X. font grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors que, d’une part, en érigeant en principe que la débitrice principale étant une société anonyme et, par conséquent, une commerçante, ne pouvait se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, au lieu de rechercher si, à supposer qu’elle n’eût pas agi comme simple consommateur, cette société ne pouvait pas être considérée à l’égard de la banque comme un non-professionnel, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; et que, d’autre part, en déclarant que n’était pas abusive la clause suivant laquelle le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes, la cour d’appel aurait violé le même texte ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant ; que la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l’emprunt avait été souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’application à la cause de la législation relative aux clauses abusives ; que le moyen est donc mal fondé en sa première branche et de ce fait inopérant en sa seconde ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors que, d’une part, en décidant que le fait pour l’un des associés d’avoir révoqué son engagement de caution justifiait l’application de l’article 7 du contrat, sans constater que la révocation, retenue comme prétexte de la déchéance du terme, était imputable au fait ou à la faute légère de l’emprunteur, la cour d’appel n’aurait pas justifié sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ; et que, d’autre part, en ne précisant pas sur quelle stipulation elle se fondait pour affirmer que l’associé avait pu unilatéralement révoquer son engagement de caution, la cour d’appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’application de l’article 7 du contrat était subordonnée, soit à la dépréciation des garanties, soit à un changement dans les dirigeants ou dans la majorité des associés et que la cour d’appel a constaté la modification notable dans la composition des instances dirigeantes de la société du fait de la démission de M. Y. de ses fonctions d’administrateur, justifiant légalement sa décision par ce seul motif ; qu’il s’ensuit que le moyen, dont le premier grief, qui s’attaque à un motif surabondant, est inopérant, et dont le second grief est, par voie de conséquence, également inopérant, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu’il est formulé par le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la banque n’avait pas abusé de son droit de révocation puisqu’elle avait, tout au contraire, accepté un rééchelonnement de la dette, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le quatrième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour refuser à la société Comte X. et aux époux X. le bénéfice de la suspension des poursuites, la cour d’appel a énoncé que le visa, maintenu par l’article 67 de la loi du 13 janvier 1989, de l’article 10 de la loi du 16 janvier 1987, liait nécessairement la suspension de plein droit des poursuites au passif consolidable, c’est-à-dire celui là seul qui avait été contracté avant le 31 décembre 1985, conformément à ce dernier texte, et que le dernier alinéa de l’article 67 n’avait d’autre objet que de régler l’application dans le temps de la réforme opérée par la loi du 13 janvier 1989 ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l’article 67 de la loi de 1989 est lié au seul dépôt de la demande de prêt et s’applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation, quelle que soit la date à laquelle la dette est née, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance SCC aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Alliance SCC à payer à la société Comte X. et aux époux X. la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Comte X. et a.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement un emprunteur (la société COMTE X., exposante) et deux de ses cautions (M. Bernard X. et Mme Jacqueline X., également exposants) à payer à une banque (la CRCAM SUD ALLIANCE) la somme de 1.000.000 F en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1990 et, pour ce faire, d'avoir débouté l'emprunteur et ses cautions de leur demande reconventionnelle tendant à voir juger que l'article 7 du contrat permettant au prêteur de le rompre unilatéralement était une clause abusive ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 7 des conditions générales le prêt devenait immédiatement exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes ou dans la majorité des associés de la société X. ou si les garanties consenties à la banque subissaient une importante dépréciation par le fait ou la faute, même légère, de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. A. avait démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société le 7 avril 1990 et qu'il avait révoqué le même jour son engagement de caution ; que cette démission était constitutive d'une modification notable dans la composition des instances dirigeantes de la société et justifiait par conséquent la déchéance du terme ; qu'en outre, le fait pour l'emprunteur de n'avoir fourni à la banque aucune garantie de substitution après que M. Paul A. eut révoqué son engagement de caution conduisait à une dépréciation importante des garanties prises par le CREDIT AGRICOLE puisqu'il ne disposait pas d'autres sûretés que le cautionnement personnel et solidaire des associés et justifiait de plus fort l'exigibilité immédiate du prêt ; que la législation sur les clauses abusives ne régissait que les contrats conclus entre les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs et ne pouvait recevoir application s'agissant d'un prêt contracté auprès d'une banque par une société anonyme ; que, de toute façon, le fait pour le prêteur d'avoir voulu conserver les mêmes interlocuteurs tout au long des relations contractuelles et d'avoir exigé que les garanties ne subissent aucune dépréciation notable en cours d'exécution du contrat ne lui avait conféré aucun avantage excessif et n'avait pas relevé d'un abus de puissance économique mais uniquement d'un souci de bonne gestion (v. arrêt attaqué, p. 4, second attendu ; p. 5, 1er attendu) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d'une part, en interdisant les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, le législateur a entendu protéger non seulement le consommateur, c'est-à-dire celui qui contracte pour satisfaire les besoins de sa vie privée, mais aussi le non-professionnel qui, commerçant ou non, traite dans le cadre de son activité professionnelle mais avec un professionnel n'ayant pas la même spécialité que lui et à l'égard duquel il se trouve, en raison même de son incompétence, dans la même situation que le consommateur ; qu'en érigeant en principe que la débitrice principale, étant une société anonyme et, par conséquent, une commerçante, ne pouvait se prévaloir de la législation sur les clauses abusives au lieu de rechercher si, à supposer qu'elle n'eût pas agi comme simple consommateur, cette société ne pouvait pas être considérée à l'égard de la banque comme un non-professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;
ALORS QUE, d'autre part, la clause aux termes de laquelle une banque se réserve le droit de révoquer le crédit consenti à une personne morale en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes confère à cet établissement un avantage excessif en créant un déséquilibre entre les droits et obligations de chaque cocontractant dans la mesure où le premier peut se soustraire à ses engagements dans des hypothèses où le second n'y a pas manqué, en se prévalant d'événements, tels le décès ou la démission de dirigeants sociaux, qu'il n'est au pouvoir de l'emprunteur ni de prévoir ni même d'éviter ; qu'en déclarant que n'était pas abusive la clause suivant laquelle le prêt deviendrait immédiatement et de plein droit exigible en cas de changement dans la composition des instances dirigeantes, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement un emprunteur (la société COMTE X., exposante) et deux de ses cautions (M. Bernard X. et Mme Jacqueline X., également exposants) à payer à une banque (la CRCAM SUD ALLIANCE) la somme de 1.000.000 F en principal et, pour ce faire, d'avoir débouté les intéressés de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cet établissement à payer une somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale du contrat de prêt ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 7 des conditions générales, le prêt devenait immédiatement exigible si les garanties consenties à la banque subissaient une importante dépréciation par le fait ou la faute, même légère, de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il était constant que M. A. avait démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société le 7 avril 1990 et qu'il avait révoqué le même jour son engagement de caution ; que le fait pour l'emprunteur de n'avoir fourni à la banque aucune garantie de substitution après que M. Paul A. eut révoqué son engagement de caution conduisait à une dépréciation importante des garanties prises par le CREDIT AGRICOLE puisqu'il ne disposait pas d'autres sûretés que le cautionnement personnel et solidaire des associés et justifiait de plus fort l'exigibilité immédiate du prêt (v. arrêt attaqué, p. 4, second attendu) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d'une part, selon l'article 7 du contrat, le prêt ne devenait immédiatement et de plein droit exigible que si les garanties consenties à la banque subissaient une importante dépréciation par le fait ou la faute, même légère, de l'emprunteur ; qu'en décidant que le fait pour l'un des associés d'avoir révoqué son engagement de caution justifiait l'application de cette stipulation, sans constater que la révocation, retenue comme prétexte pour faire jouer la déchéance du terme, était imputable au fait ou à la faute légère de l'emprunteur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties contractantes ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en ne précisant pas sur quelle stipulation elle se fondait pour affirmer que l'associé avait pu unilatéralement révoquer son engagement de caution, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement un emprunteur (la société COMTE X., exposante) et deux de ses cautions (M. Bernard X. et Mme Jacqueline X., également exposants) à payer à une banque (la CRCAM SUD ALLIANCE) la somme de 1.000.000 F en principal et, pour ce faire, d'avoir débouté les intéressés de leur demande reconventionnelle tendant à la condamnation de cet établissement à payer une somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale et abusive du contrat de prêt ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité dirigée contre la banque sur le fondement de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 devait être rejetée dès lors que le prêteur n'avait fait qu'appliquer les stipulations contractuelles en révoquant le crédit et qu'il n'avait pas abusé de son droit puisqu'il avait tout au contraire accepté un rééchelonnement de la dette ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, selon a loi, à laquelle les conventions particulières ne peuvent déroger, un établissement financier ne peut révoquer le crédit, qu'il s'agisse d'un prêt à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans respecter un délai de préavis à moins que la révocation ne soit justifiée par le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou bien si la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, l'inobservation de cette disposition pouvant entraîner la responsabilité pécuniaire du prêteur ; qu'en retenant que la banque n'avait commis aucun abus puisqu'elle n'avait fait qu'appliquer les stipulations contractuelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant ces clauses, le prêteur n'avait pas commis un abus de droit en révoquant le crédit avec effet immédiat bien qu'aucune des deux seules conditions prévues n'eût été remplie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement un emprunteur (la société COMTE X., exposante) et deux de ses cautions (M. Bernard X. et Mme Jacqueline X., également exposants) à payer à une banque (la CRCAM SUD ALLIANCE) la somme de 1.000.000 F en principal et, pour ce faire, d'avoir débouté les intéressés de leur demande reconventionnelle tendant à voir juger qu'ils bénéficiaient de plein droit de la suspension de toutes poursuites en leur qualité de rapatriés ayant fait une demande de prêt de consolidation ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 44 III de la loi du 30 décembre 1986, qui n'avait pas été abrogé, prévoyait la suspension des poursuites dirigées contre des rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des dettes fiscales, et contractés avant le 31 décembre 1985 ; que l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 avait élargi le champ d'application de cette loi et disposait que les rapatriés dont l'exploitation de heurtait à de graves difficultés financières pouvaient bénéficier d'un prêt destiné à consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 décembre 1985 ; que l'article 11, alinéa 2, de cette loi, ultérieurement abrogé, prévoyait la possibilité pour les personnes désignées à l'article 10 de bénéficier de la suspension des poursuites prévues à l'article 66, paragraphe 3, de la loi du 30 décembre 1986, la demande de suspension étant soumise à l'appréciation du juge de référés (v. arrêt attaqué, p. 6, § V, 1er attendu) ; qu'il était manifeste, en l'état des textes en vigueur jusqu'au 13 janvier 1980 (lire 1989), date d'abrogation de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 1987, que la suspension des poursuites ne pouvait concerner que les dettes contractées avant le 31 décembre 1985 ; que le ministère de l'Economie et des Finances l'avait d'ailleurs expressément reconnu dans sa circulaire du 26 janvier 1988 (v. arrêt attaqué, p. 7, 1er et 2ème attendu) ; que l'abrogation par l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 1987 n'affectait en rien cette corrélation voulue par le législateur entre le passif consolidable, c'est-à-dire contracté avant le 31 décembre 1985, et la suspension des poursuites ; que ce texte n'avait pas d'autre objet que de supprimer l'intervention du juge des référés et de préciser que la suspension des poursuites était de plein droit pour les personnes ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, par ce visa de l'article 10, le législateur avait nécessairement lié la suspension de plein droit des poursuites au passif consolidable ; qu'il était certes indiqué au dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 que "ces dispositions s'appliqu (aient) à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours" (v. arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu) ; que, cependant, cet alinéa n'avait pas d'autre objet que de régir l'application de la loi dans le temps et de préciser qu'elle serait immédiatement applicable, y compris pour les poursuites déjà engagées au jour de son entrée en vigueur ; qu'il ne pouvait en être déduit que les dettes non consolidables parce que postérieures au 31 décembre 1985 pouvaient bénéficier de la suspension ; que les textes ultérieurs n'avaient fait que proroger le délai de la suspension mais ne modifiaient en rien les données du litige puisqu'ils faisaient tous référence implicitement ou explicitement à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, par conséquent, ni la société cautionnée ni les cautions ne pouvaient se prévaloir de la suspension des poursuites pour une dette dont il n'était pas contesté qu'elle avait été contractée après cette date (v. arrêt attaqué, p. 8, 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 6ème alinéas) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, selon l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989, les personnes ayant formé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les poursuites, y compris celles en cours ; qu'abrogeant l'alinéa 2 de l'article 11 de cette loi qui instituait une suspension facultative des seules poursuites relatives aux dettes liées à l'exploitation et contractées avant le 31 décembre 1985, le nouveau texte ne distingue plus selon la nature de la dette qui fonde les poursuites, ni selon la date à laquelle elle a été contractée, mais prévoit au contraire expressément qu'il n'y a pas lieu de prendre ces circonstances en considération puisqu'il précise expressément que le bénéfice de la suspension s'applique à toutes les poursuites ; qu'en décidant que cette disposition profitait aux seules poursuites concernant le passif consolidable, c'est-à-dire les dettes liées à l'exploitation et contractées avant le 31 décembre 1985, lui apportant ainsi une restriction que non seulement il ne comporte plus mais qu'il a formellement écartée, la Cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989.
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5874 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : rapport direct
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5936 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Conventions de compte et trésorerie
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements