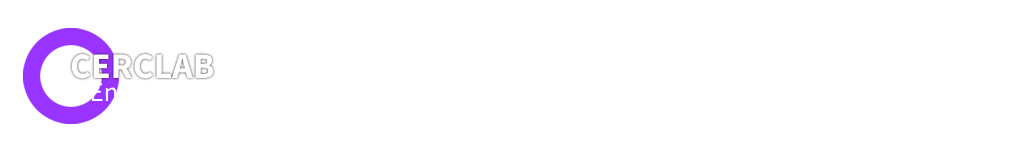6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6015 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Régime initial (L. 10 janvier 1978)
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6018 (20 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
CLAUSES PORTANT SUR L’OBJET PRINCIPAL DU CONTRAT OU L’ADÉQUATION AU PRIX - RÉGIME POSTÉRIEUR À LA LOI N° 95-96 DU 1er FÉVRIER 1995 - EXCEPTIONS : CLAUSES OBSCURES
Présentation. L’art. L. 212-1, alin. 3, C. consom. (alin. 7 de l’ancien art. L. 132-1) autorise le contrôle du caractère abusif des clauses portant sur la définition de l’objet principal ou l’adéquation au prix qui ne sont pas rédigées de façon « claire et compréhensible » (V. aussi Cerclab n° 6016).
Le texte donne donc un effet particulier au principe général posé par l’ancien art. L. 133-2 alin. 1, devenu l’art. L. 211-1 alin. 1 C. consom. Pour une illustration de décision semblant confondre les deux dispositions : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; « cette rédaction insidieuse, qui est contraire au principe de clarté institué par l'article L. 132-1 [L. 212-1] du code de la consommation » ; N.B. la clause de déchéance pour déclaration tardive ne peut être considérée comme portant sur l’objet principal du contrat), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.
Caractère impératif de la possibilité d’un contrôle des clauses obscures. Les dispositions de l’art. 4 § 2 de la Directive font partie de l’harmonisation minimale exigée des États Membres : a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive, l’État néerlandais qui n’a pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer la transposition complète dans son droit interne de l’art. 4 § 2 (possibilité de déclarer abusives des clauses portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix, lorsque ces clauses ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible). CJCE (5e ch.), 10 mai 2001, Commission / Pays-Bas : Aff. C-144/99 ; Rec. p. I-3541 ; Cerclab n° 4378 (point n° 22 ; arrêt estimant notamment que les Pays-Bas n’ont pas apporté la preuve que leur droit interne contenait déjà des dispositions équivalentes et soulignant, point n° 21, qu’une jurisprudence nationale, à la supposer établie, interprétant des dispositions de droit interne dans un sens estimé conforme aux exigences d’une directive ne saurait présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l’exigence de sécurité juridique).
Pour se conformer à cette obligation et prévenir une éventuelle condamnation en manquement que cet arrêt pouvait laisser présager, la France a rapidement modifié l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. L’ordonnance n° 2001-741 du 23 août
Généralité de l’exigence d’une rédaction claire. L’exigence de rédaction claire et compréhensible s’applique en tout état de cause, y compris lorsqu’une clause relève de l’art. 4 § 2 de la directive 93/13 et échappe donc à l’appréciation de son caractère abusif visée à l’art. 3 § 1 de cette directive ; l’exigence figurant à l’art. 4 § 2 a la même portée que celle visée à l’art. 5 de cette directive. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 68 et 69).
Explicitation de l’exigence par la CJUE. L’art. 4 § 2 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives qui est d’interprétation stricte. CJUE (9e ch.), 26 février 2015, Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 50 ; arrêt citant l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, point n° 37 et 38). § Dans le même sens : CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler : précité (point n° 38) - CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197. (n° 51 ; arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16).
L’exigence de transparence des clauses contractuelles posée aux articles 4, § 2 et 5 de la directive 93/13, dispositions ayant au demeurant une portée identique, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible de celles-ci sur les plans formel et grammatical. CJUE (9e ch.), 26 février 2015, Bogdan Matei - Ioana Ofelia Matei / SC Volksbank România SA : aff. C‑143/13 ; Cerclab n° 7053 (point n° 73) - CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (point n° 71) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 44 ; arrêt citant l’arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, point 52).
Il résulte des articles 3 et 5 de la directive 93/13 ainsi que des points 1-j) et l), et 2-b) et d), de l’annexe de cette directive que revêt une importance essentielle aux fins du respect de l’exigence de transparence le point de savoir si le contrat de prêt expose de manière transparente les motifs et les particularités du mécanisme de modification du taux d’intérêt et la relation entre cette clause et d’autres clauses relatives à la rémunération du prêteur, de sorte qu’un consommateur informé puisse prévoir, sur la base de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CJUE (9e ch.), 26 février 2015, précité (point n° 74 ; point n° 76 ; nécessité de vérifier, au titre de la rédaction claire et compréhensible, la prévisibilité pour le consommateur des augmentations du taux pouvant être effectuées par le prêteur en fonction du critère, à première vue peu transparent, relatif à la « survenance de changements significatifs sur le marché monétaire », même si cette dernière formulation est en soi grammaticalement claire et compréhensible ; arrêt citant l’arrêt Kásler et Káslerné Rábai, points 73). § Dans le même sens : CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (dispositif et points n° 73 à 75 ; point n° 73 évoquant les points 1, sous j) et l), et 2, sous b) et d), de l’annexe de cette directive pour justifier l’importance essentielle pour le respect de l’exigence de transparence de l’information complète du consomamateur) - CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc e.a./ Banca Românească SA : Aff. C‑186/16 ; Cerclab n° 7151 (point n° 45 ; arrêt citant les arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, points 75, et du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, point 50). § Pour apprécier le respect de cette exigence, la juridiction de renvoi doit statuer au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d’un contrat de prêt. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2017 : précité (point n° 46 ; arrêt citant l’arrêt du 26 février 2015, Matei, C‑143/13, point 75).
Selon une jurisprudence constante relative à l’exigence de transparence, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale ; c’est notamment sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (point n° 62 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; il s’ensuit que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’art. 4 § 2, et de l’art. 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; en conséquence, ladite exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (points n° 61 à 78). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198.
L’article 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cas où un contrat de crédit à la consommation, d’une part, n’indique pas le taux annuel effectif global et ne contient qu’une équation mathématique de calcul de ce taux annuel effectif global non assortie des éléments nécessaires pour procéder à ce calcul et, d’autre part, ne mentionne pas le taux d’intérêt, une telle circonstance est un élément décisif dans le cadre de l’analyse par la juridiction nationale concernée du point de savoir si la clause dudit contrat relative au coût du crédit est rédigée de façon claire et compréhensible, au sens de ladite disposition. CJUE (8e ch.), 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko - Margita Danková / Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS : Aff. C 448/17 ; Cerclab n° 8150.
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate : - d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et - d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CJUE (3e ch.), 23 avril 2015, Van Hove / CNP Assurances SA : aff. n° C-96/14 ; Cerclab n° 5479, sur question préjudicielle de TGI Nîmes, 26 février 2014 : Dnd. § Les art. 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de son appréciation du caractère abusif, au sens de l’art. 3, § 1 et 3, de cette directive, des clauses d’un contrat de crédit à la consommation, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat ; à cet égard, il lui incombe de vérifier que, dans l’affaire en cause, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention dans le contrat de crédit à la consommation des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles, et en particulier celles visées à l’article 4 de la directive 87/102, telle que modifiée. CJUE (6e ch.), 9 juillet 2015, Maria Bucura / SC Bancpost SA : Aff. C-348/14 ; Cerclab n° 5482 ; Juris-Data n° 2015-020467.
Explicitation de l’exigence par les juridictions nationales. Dans le même sens en droit interne : la clause contractuelle qui relève de la notion d'objet principal du contrat s'entend comme celle qui fixe les prestations essentielles du contrat et qui, comme telle, caractérise celui-ci ; l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical ; le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; la clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci ; elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd. § L’exigence de transparence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières, ce qui implique notamment que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence, ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 janvier 2024 : RG n° 21/15519 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10815 (assurance-crédit ; garantie invalidité permanente totale). § L'exigence de clarté et de compréhension doit être comprise comme imposant à l'assureur, non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur, présumé profane, sur les plans formel et grammatical, mais également qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure d'en comprendre le fonctionnement concret et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et non susceptibles d'interprétation, les conséquences, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations. TJ Draguignan (1re ch.), 16 juillet 2024 : RG n° 19/01490 ; jugt n° 2024/388 ; Cerclab n° 24818.
Préexistence du raisonnement. Même avant l’introduction par l’ordonnance de 2001 de l’exception au principe posé par l’al. 7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., des décisions postérieures à la loi du 1er février 1995 ont pris en compte l’absence de clarté de la rédaction, pour retenir le caractère abusif d’une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat. V. par exemple : TGI Tarascon, 28 mars 1997 : RG n° 96/01306 ; Cerclab n° 997 (assurance garantissant le maintien de revenus ; contrat affichant clairement un montant garanti tout en stipulant par ailleurs que le montant ne peut excéder les revenus de l’assuré à la date du sinistre ; jugement, estimant de façon discutable, que la clause portait sur les modalités d’exécution et non sur l’objet principal et affirmant par ailleurs « que le caractère abusif de la disposition litigieuse ne doit pas s'apprécier en fonction de sa seule littéralité ; que certes les parties disposent du droit de limiter contractuellement l'objet des prestations réciproques en vertu de circonstances qu'elles ont préalablement défini, si ces limitations sont clairement et librement consenties » ; N.B. cette analyse resterait compatible avec l’exigence de clarté, présente dans la directive, mais introduite en droit français en 2001, donc après le jugement), infirmé par CA Aix-en-Provence (15e ch.), 10 octobre 2002 : RG n° 97/10636 ; arrêt n° 1119 ; Cerclab n° 747 ; Juris-Data n° 2002-217598 (clause suffisamment apparente et dépourvue d’ambiguïté, portant sur l’objet principal).
V. aussi pour la Commission : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses qui ont pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s’ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux restant éventuellement à exposer. Recomm. n° 96-03/2° : Cerclab n° 2189 (généalogiste).
Charge de la preuve du caractère clair et compréhensible. La directive 93/13 ne contient aucune disposition relative à la charge de la preuve en ce qui concerne le caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 4 § 2, de cette directive (point n° 80) ; dès lors, de telles modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, étant précisé que ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (n° 81). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197.
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’art. 4 § 2, de cette directive, incombe au consommateur. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (prêt avec une monnaie de compte étrangère). § Sur le raisonnement employé par la Cour pour arriver à cette conclusion : 1/ la directive vise notamment à rééquilibrer l’asymétrie entre les positions du professionnel et du consommateur résultant de la situation d’infériorité de ce dernier en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (n° 2) ; pour que soit satisfaite l’exigence de transparence le professionnel doit fournir au consommateur les informations suffisantes et exactes qui permettent à ce dernier d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses contractuelles sur ses obligations financières (n° 83 et 78) ; 3/ dans cette perspective, il y a lieu de relever que le respect du principe d’effectivité et la réalisation de l’objectif sous-tendant la directive 93/13 ne pourraient être assurés si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle reposait sur le consommateur (n° 84), s’agissant de la preuve d’un fait négatif (à savoir que le professionnel ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires afin de satisfaire à l’exigence de transparence) (n° 85) ; 4/ cette solution ne porte pas une atteinte démesurée au droit du professionnel à un procès équitable (n° 86).
S’agissant des « documents relatifs aux techniques de vente » employés par le professionnel, l’obligation du professionnel de justifier de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles doit couvrir la preuve relative à la communication des informations contenues dans de tels documents au consommateur par le professionnel, ou par toute autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation des prêts en cause, dès lors qu’il est considéré que ces documents peuvent s’avérer utiles aux fins de l’appréciation du caractère clair et compréhensible de la clause (n° 87), puisqu’il appartient au professionnel de maîtriser les canaux de distribution de ses produits, qu’il s’agisse du choix des intermédiaires ou de la communication commerciale vis-à-vis du consommateur (n° 88). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (preuve incluant également le fait que les documents n’étaient le cas échéant plus utilisés).
Dans le même sens, en droit interne : la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 - TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 janvier 2024 : RG n° 21/15519 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10815 (assurance-crédit) - TJ Draguignan (1re ch.), 16 juillet 2024 : RG n° 19/01490 ; jugt n° 2024/388 ; Cerclab n° 24818 (assurance-crédit).
Appréciation du caractère incompréhensible : prise en compte de la qualité du consommateur ? Sur la prise en compte de la profession du consommateur pour apprécier le caractère clair et compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal au sens de l’art. L. 212-1 C. consom. : dès lors que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère et compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, l’emprunteur, qui déclare exercer la profession de directeur commercial, doit être considéré comme un consommateur normalement avisé, qui a été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour lui ; en conséquence, la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 juin 2017 : RG n° 15/23333 ; Cerclab n° 6937 (Helvet immo ; outre huit autres arrêts du même jour, précités), confirmant TGI Paris, 29 septembre 2015 : RG n° 14/07116 ; Dnd. § V. pour un autre arrêt, avec une formulation différente, adaptée à la profession des emprunteurs : compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les emprunteurs, qui déclarent exercer la profession de chef d'entreprise employant plus de dix salariés, pour madame, de conducteur d'engins, pour monsieur et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement comprendre, d'une part, que les frais de change leur incombaient et quelle était leur assiette, et d'autre part que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour permettre le remboursement du solde du prêt et que surtout ils pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total et qu'ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd. § V. aussi : CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel ; appréciation du caractère clair et compréhensible pour une SCI, qui n'est pas un consommateur moyen, mais un emprunteur averti, compte tenu notamment du fait qu’un des co-gérants est un professionnel du chiffre), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 décembre 2018 : RG n° 16/25325 ; Cerclab n° 8163 (Helvet Immo ; prise en compte de la qualité de notaire de l’emprunteur pour apprécier le caractère clair et compréhensible de la clause, ainsi que le point de départ de la prescription), sur appel de TGI Paris, 2 septembre 2016 : RG n° 14/14317 ; Dnd.
Appréciation du caractère incompréhensible : illustrations. Ayant ainsi fait ressortir que l’article n’était pas clair et compréhensible, au sens de l’ancien art. L. 132-1, alin. 7, C. consom. [L. 212-1 al. 3], en ce qu’il ne définissait pas précisément l’ITT, de sorte qu’entraînant une restriction substantielle de garantie, il avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, la cour d’appel a, hors toute dénaturation et sans contrevenir aux art. L. 113-1 et L. 112-4 C. assur., retenu, à bon droit, qu’il présentait un caractère abusif, qui en commandait la suppression. Cass. civ. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-19107 ; arrêt n° 430 ; Cerclab n° 5605 (assurance-crédit ; ITT définie comme l’impossibilité absolue, pour un assuré ayant une activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, sans autre précision, alors que, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 janvier 2015 : RG n° 12/02971 ; Cerclab n° 5047, sur appel de TGI Grenoble, 7 mai 2012 : RG n° 09/05854 ; Dnd. § Rejet du pourvoi contre un arrêt estimant que la clause définissant l’état d’invalidité permanente et absolue, au regard des critères précis et intelligibles de l’octroi de la garantie mentionnés, était claire et compréhensible et ne nécessitait pas d’interprétation. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-24216 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 6716 (assurance crédit garantissant les risques « décès/ invalidité permanente et absolue (IPA) » : selon la clause, « l’état d’invalidité permanente et absolue (IPA) est réalisé lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément : - survenir en cours d’assurance et avant le 65e anniversaire ; - mettre l’assuré dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou profit ; - l’obliger, en outre, à recourir, pendant toute son existence à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se laver, s’habiller, s’alimenter) » ; arrêt notant qu’en conséquence, l’appréciation du caractère abusif ne peut porter sur cette clause et précisant que la cour d’appel avait par ailleurs recherché si le fait pour l’assureur d’exiger la preuve du caractère définitif de l’invalidité subie par l’assuré ne privait pas d’effet la garantie précitée), rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (ch. 2 sect. 1), 8 avril 2015 : RG n° 13/06073 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 7326, sur appel de TGI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 13/02372 ; Dnd.
Rappr., rendu sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978 ne connaissant pas la prohibition de l’al. 7 (al. 3 actuel de l’art. L. 212-1 C. consom.) et son exception, un arrêt estimant, après avoir démontré l’absence de déséquilibre, que par ailleurs le mécanisme d’assurance mis en place est exposé clairement et qu’en outre, cette clause faisant partie d’un acte passé en la forme authentique, elle a donc été lue et explicitée par le notaire rédacteur de l’acte et les emprunteurs ont eu la possibilité d’interroger ce professionnel si des doutes ou incompréhensions subsistaient. CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891, sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd.
* Critères d’appréciation du caractère clair et compréhensible. L’art. 4 § 2 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 (points n° 61 à 78). § Dans le même sens : CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198 (même sens pour les clauses qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, l’allongement de la durée dudit contrat et l’augmentation du montant des mensualités). § Sur le raisonnement tenu par la CJUE pour arriver à cette solution (C-776/19), V. sur un plan global : selon une jurisprudence constante relative à l’exigence de transparence, l’information, avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale ; c’est notamment sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (point n° 62 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; il s’ensuit que l’exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu’elle résulte de l’art. 4 § 2, et de l’art. 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci ; le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18) ; en conséquence, ladite exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (n° 63 ; arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18). § Pour le raisonnement plus spécifique concernant l’espèce : 1/ la question de savoir si, en l’occurrence, l’exigence de transparence a été respectée doit être examinée par la juridiction nationale à la lumière de l’ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l’information fournies, dans le cadre de la négociation des contrats de prêt en cause au principal, non seulement par le prêteur lui-même, mais aussi par toute autre personne ayant participé, au nom de ce professionnel, à la commercialisation des prêts concernés ; plus particulièrement, il lui incombe, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt ; jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses de ce contrat sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention, dans le contrat de crédit, des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 52 et jurisprudence citée) (n° 66 et 67) ; 2/ en l’espèce, si les requérants au principal ont reçu, avant la souscription de leurs prêts, des informations sur l’incidence des variations de la parité entre l’euro et le franc suisse sur la durée du contrat et sur les règlements aux fins du paiement du solde du compte, le risque de change n’aurait toutefois été nullement mentionné (n° 68) ; en ce qui concerne les contrats de prêt libellés en devise étrangère, il y a lieu de constater, en premier lieu, qu’est pertinente, aux fins de ladite appréciation, toute information fournie par le professionnel qui vise à éclairer le consommateur sur le fonctionnement du mécanisme de change et le risque lié à celui-ci ; constituent des éléments d’une importance particulière les précisions concernant les risques encourus par l’emprunteur en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (arrêt citant la recommandation du Comité européen du risque systémique CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises : JO 2011, C 342, p. 1) ; l’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en concluant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; en outre, le professionnel doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la conclusion d’un tel contrat (n° 71 ; voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17) : 3/ il en découle que, pour respecter l’exigence de transparence, les informations communiquées par le professionnel doivent pouvoir permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé non seulement de comprendre que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également de comprendre, dans le cadre de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte (n° 72) ; 4/ les simulations chiffrées, telles que celles incluses dans certaines offres de prêt litigieuses, peuvent constituer un élément d’information utile, si elles sont fondées sur des données suffisantes et exactes, et si elles comportent des appréciations objectives qui sont communiquées de manière claire et compréhensible au consommateur […] ; comme toute autre information relative à la portée de l’engagement du consommateur, communiquée par le professionnel, les simulations chiffrées doivent contribuer à la compréhension par ce consommateur de la portée réelle du risque, à long terme, lié aux possibles variations des taux de change et ainsi, des risques inhérents à la conclusion d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère (n° 73) ; 5/ ainsi, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère exposant le consommateur à un risque de change, ne saurait satisfaire à l’exigence de transparence la communication à ce consommateur d’informations, même nombreuses, si celles-ci sont fondées sur l’hypothèse que la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement restera stable tout au long de la durée de ce contrat ; il en est notamment ainsi lorsque le consommateur n’a pas été averti par le professionnel du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations des taux de change, de sorte que le consommateur n’a pas été mis en mesure de comprendre concrètement les conséquences potentiellement lourdes, qui peuvent découler de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, sur sa situation financière (n° 74) ; parmi les éléments pertinents, figurent aussi, le langage utilisé par l’établissement financier dans les documents précontractuels et contractuel (n° 75) et la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale (n° 76) (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10), même si ce dernier élément ne saurait à lui seul établir automatiquement cette absence de transparence.
Est abusive la clause d’un contrat de prêt en devise étrangère qui ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre et comment s'effectuent les remboursements en francs suisses, étant précisé que l’emprunteur ne percevait que des revenus en euros et qu'il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu'un taux de change soit appliqué ; la clause ne précise pas, contrairement à ce qui est prévu en matière d'intérêts, quel est le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise en considération la variation de ce taux et se fait la conversion et comment l'emprunteur peut avoir connaissance de celui-ci et aucune pièce n'établit que ces informations ont été communiquées antérieurement à la conclusion du contrat, la banque ne pouvant se contenter d’indications vagues et sommaires sur le risque de change, alors que ces éléments fondamentaux sont susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement en lui permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il sera confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; caractère abusif d’une clause de conversion de monnaie ; réouverture des débats en raison du fait que l’emprunteur et la banque, à titre subsidiaire, ne se sont pas expliqués sur les conséquences du caractère abusif ; N.B. les développement sur l’information s’inscrivent dans l’appréciation, conforme à la CJUE, de la rédaction claire et compréhensible), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (résumé ci-dessous).
N’est ni claire, ni compréhensible, la clause qui ne fournit aucune définition de l'incapacité fonctionnelle, en se contentant de se référer « au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard », dès lors que l’assureur ne saurait sérieusement soutenir que la notion d'« incapacité fonctionnelle physique ou mentale » tombe sous le sens commun, que le barème et règle visés, même s'il s'agit d'éléments objectifs, n'ont de sens que pour des seuls et rares initiés, non pour un consommateur moyen. CA Versailles (3e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 19/03738 ; Cerclab n° 8626 (conséquence : lors de l'adhésion, les emprunteurs n'étaient en réalité pas en mesure de connaître ce que recouvre l'incapacité fonctionnelle et, par voie de conséquence, le taux d'invalidité ; ils se sont trouvés ainsi privés de la faculté d'appréhender concrètement le mécanisme de prise en charge résultant du tableau à double entrée, puisque celui-ci repose notamment sur le taux d'incapacité fonctionnelle, notion non clairement définie pour un consommateur moyen, et d'évaluer les conséquences économiques en découlant pour eux, soit la portée réelle de la garantie offerte), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 30 avril 2019 : RG n° 17/02780 ; Dnd.
Caractère compréhensible et langue étrangère. V. pour une illustration : CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (prêt immobilier avec possibilité de tirage dans une monnaie étrangère ; un document rédigé en langue anglaise ne peut contribuer à établir le caractère clair et compréhensible de la clause, s'agissant d'un contrat proposé à un citoyen français, résidant sur le territoire français ; clause n’informant pas non plus correctement sur le risque de change, mais in fine jugée non abusive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003
Impossibilité de contrôler les clauses claires et compréhensibles. * Commission des clauses abusives. Non-lieu à avis pour des clauses définissant, selon la Commission, l’étendue de la garantie consentie à l’emprunteur par l’assureur qui, exemptes d’obscurité ou d’inintelligibilité sont rédigées de façon claire et compréhensible et ne peuvent être déclarées abusives : CCA (avis), 18 septembre 2003 : avis n° 03-01 ; Cerclab n° 3377 (exclusion de garantie ; N.B. la jurisprudence estime plutôt, majoritairement, que les clauses d’exclusion ne concernent pas la définition de l’objet principal, V. Cerclab n° 6017).
* Juges du fond. Pour la validation de clauses définissant l’objet principal de façon claire et compréhensible, V. par exemple : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 janvier 2014 : RG n° 11/03986 ; Cerclab n° 4674 (assurance ; incapacité ; est rédigée en des termes parfaitement clairs et dénués de toute ambiguïté, la clause d’une garantie incapacité temporaire de travail qui emploie l’article indéfini « une » signifiant que l’assuré doit être dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non celle qu’il exerçait avant son arrêt de travail), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 28 janvier 2009 : RG n° 07/00167 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 31 octobre 2013 : RG n° 13/00080 ; Cerclab n° 4509 (assurance habitation ; clause claire et non abusive prévoyant que la garantie des murs extérieur du jardin est une option que le consommateur n’a pas choisie), sur appel de TI Limoges, 5 décembre 2012 : Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 4 février 2009 : RG n° 08/00437 ; Cerclab n° 2634 (assurance ; arrêt écartant le caractère abusif d’un questionnaire de santé pour une question sur les troubles nerveux posée en termes précis et compréhensibles, même si elle n’était pas limitée dans le temps ; N.B. arrêt se référant à l’avantage excessif, alors que le contrat a été conclu en 2001), sur appel de TGI Besançon, 15 janvier 2008 : RG n° 06/2664 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. A), 18 mai 2016 : RG n° 14/00937 ; Legifrance ; Cerclab n° 5591 (contrat d’expertise de sinistre ; en absence d'obscurité du contrat, il n'y a pas lieu à interprétation, étant rappelé qu'aucune nullité du contrat ne saurait résulter d'une éventuelle incertitude), sur appel de TGI Ajaccio, 6 novembre 2014 : RG n° 13/00144 ; Dnd.
V. aussi : la brièveté du contrat écrit, qui comporte une clause d'engagement et une clause de rémunération, met en évidence sa simplicité, qui exclut toute interprétation en application des dispositions des anciens art. 1156 [1188 nouveau] et 1161 C. civ. [1189 nouveau]. CA Bastia (ch. civ. A), 18 mai 2016 : RG n° 14/00937 ; Legifrance ; Cerclab n° 5591 (contrat d’expertise de sinistre ; consommateur ne rapportant pas la preuve d’une clause abusive, source de déséquilibre significatif), sur appel de TGI Ajaccio, 6 novembre 2014 : RG n° 13/00144 ; Dnd.
Rappr., estimant que la clause d’un contrat de bail obligeant les locataires à se fournir en chaleur et en eau chaude auprès d’un tiers n’est pas abusive, dès lors que le bailleur n’a commis aucune faute en précisant dans les contrats de location, que les locataires devaient faire leur affaire personnelle de la chaleur nécessaire au chauffage et en leur faisant signer un avenant qui précisait clairement toutes les modalités. TI Boissy-Saint-Léger 17 septembre 1998 : RG n° 1174/97 ; Cerclab n° 40, sur appel CA Paris (6e ch. C), 5 juin 2001 : RG n° 1999/05376 ; Cerclab n° 915 ; Juris-Data n° 2001-148848.
Régime des clauses obscures : retour à la possibilité d’apprécier le caractère abusif. En cas de non-respect de la condition posée par l’al. 7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. [L. 212-1, al. 3, la conséquence littérale est que le contrôle du caractère abusif redevient possible. § V. en ce sens : si une clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’art. 4 de la directive 93/13, la juridiction interne a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, la clause est abusive. CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C‑76/10 ; Cerclab n° 4418 (point n° 72).
L’absence de transparence manifeste une asymétrie d’information, qui est un indice du déséquilibre. § V. en ce sens : le caractère transparent d’une clause contractuelle, tel qu’exigé à l’art. 5 de la directive 93/13, constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause qu’il appartient au juge national d’effectuer en vertu de l’art. 3 § 1 de cette directive (n° 94 ; arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 49 ainsi que jurisprudence citée). CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197
En revanche, sauf disposition légale contraire, cette absence de transparence ne justifie pas à elle seule la consécration du caractère abusif de la clause. § V. en ce sens : L’art. 3 § 1 de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l’objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence prévue à l’art. 4 § 2, de cette directive, telle que modifiée, sauf si l’État membre dont le droit national s’applique au contrat en cause a, conformément à l’art. 8 de ladite directive, telle que modifiée, expressément prévu que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait. CJUE (4e ch.), 12 janvier 2023 : aff. C-395/21 ; Cerclab n° 10009.
L’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses. ». CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, VB et autres / BNP Paribas Personal Finance SA : affaire C-776/19 à C-782/19 ; Cerclab n° 9197 - CJUE (1re ch.), 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance SA / VE : Affaire C‑609/19 ; Cerclab n° 9198 (même sens pour les clauses d’un contrat de prêt qui stipulent que les paiements à échéances fixes sont imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient, afin de payer le solde du compte, lequel peut augmenter de manière significative à la suite des variations de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, l’allongement de la durée de ce contrat et l’augmentation du montant des mensualités). § Sur le raisonnement utilisé par la Cour pour justifier cette position (C-776/19) : 1/ En l’espèce, les clauses litigieuses, insérées dans des contrats de prêt libellés en devise étrangère, prévoient que les deux parties subissent un risque de change, mais que le risque supporté par le professionnel, en l’occurrence l’établissement bancaire, est plafonné, tandis que celui supporté par le consommateur ne l’est pas ; ces clauses font ainsi peser, en cas de dépréciation importante de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère, le risque de change sur le consommateur (n° 95) ; à cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre des contrats de prêt libellés en devise étrangère, tels que ceux en cause au principal, le juge national doit apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, et, en tenant notamment compte de l’expertise et des connaissances du professionnel en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, au sens de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 (n° 96 ; voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 56). 2/ En ce qui concerne l’exigence de bonne foi, il importe de relever, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de la directive 93/13, que, dans le cadre de cette appréciation, il faut notamment tenir compte de la force des positions respectives de négociation des parties et de la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause concernée (n° 97) ; […] le juge national doit vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte cette clause à la suite d’une négociation individuelle (n° 98 ; voir, notamment, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 93 ainsi que jurisprudence citée) ; dès lors, pour apprécier si ces clauses créent un déséquilibre, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances dont le prêteur professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion de ce contrat, compte tenu notamment de son expertise, en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un tel prêt et qui étaient de nature à avoir des répercussions sur l’exécution ultérieure du contrat ainsi que sur la situation juridique du consommateur (n° 99) ; au regard des connaissances et des moyens supérieurs du professionnel pour anticiper le risque de change, qui peut se matérialiser à n’importe quel moment au cours de la durée du contrat, ainsi que du risque non plafonné relatif aux variations des taux de change que les clauses contractuelles telles que celles en cause au principal font peser sur le consommateur, il y a lieu de considérer que de telles clauses peuvent donner lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de prêt concerné au détriment du consommateur (n° 100) ; en effet, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, les clauses contractuelles en cause au principal semblent faire peser sur le consommateur, dans la mesure où le professionnel n’a pas respecté l’exigence de transparence à l’égard de ce consommateur, un risque disproportionné par rapport aux prestations et au montant du prêt reçus, puisque l’application de ces clauses a pour conséquence que le consommateur doit supporter le coût de l’évolution des taux de change à terme. En fonction de cette évolution, ce consommateur peut se trouver dans une situation dans laquelle, d’une part, le montant du capital restant dû en monnaie de paiement, en l’occurrence en euros, est considérablement plus important que la somme initialement empruntée et, d’autre part, les mensualités versées ont presque exclusivement couvert les seuls intérêts. Il en est notamment ainsi lorsque cette augmentation du capital restant dû en devise nationale n’est pas équilibrée par la différence entre le taux d’intérêt de la devise étrangère et celui de la devise nationale, étant précisé que l’existence d’une telle différence constitue l’avantage principal d’un prêt libellé en devise étrangère pour l’emprunteur (n° 101) ; dans de telles conditions, compte tenu notamment de l’exigence de transparence qui découle de l’art. 5 de la directive 93/13, il ne pourrait être considéré que le professionnel pouvait raisonnablement s’attendre, en traitant de façon transparente avec le consommateur, à ce que ce dernier accepte de telles clauses à la suite d’une négociation individuelle (voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 96), ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier (n° 102). § Pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-19107 ; arrêt n° 430 ; Cerclab n° 5605.
Néanmoins, il convient de remarquer que, dans un tel cas de figure, le juge dispose déjà, par hypothèse, de certains indices en faveur d’un déséquilibre significatif, notamment la rédaction de la clause qui peut être confuse ou incompréhensible (Cerclab n° 6003) ou vague et imprécise (Cerclab n° 6004) et l’asymétrie d’information qui en résulte (Cerclab n° 6026).
Par ailleurs, par hypothèse aussi, les clauses contrôlées concernent la définition de l’objet principal ou l’adéquation au prix (pour le prix V. Cerclab n° 6019), ce qui peut avoir des conséquences sur le contrat dans son ensemble. V. en ce sens, pour une clause de prix : TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472 (détective privé ; le dénouement du litige ne pouvant donner lieu à la simple cancellation des clauses déclarées abusives, puisque celles-ci sont relatives au prix et au déroulement de l’enquête, objets principaux du contrat, le contrat sera déclaré nul), infirmé par CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Legifrance ; Juris-Data n° 2007-345679 (clauses jugées lisibles). § Comp. sous l’angle du dol incident : la durée des communications téléphoniques constitue une qualité substantielle du service en portant sur les conditions de son utilisation et en ayant une incidence sur le calcul de son prix ; l’opérateur a utilisé la formule « illimitée », alors qu'en réalité les communications étaient plafonnées selon un calcul difficilement accessible résultant de l'application d'une clause dont la rédaction obscure faisait référence à un calcul compliqué à partir de la consommation dite « normale » d'un client virtuel grand public, laquelle ressortait des statistiques périodiquement publiées par l'ARCEP dans l'observatoire annuel des marchés, sans pour autant que ne soit précisé le mode opératoire du calcul de manière claire et précise, ne permettant pas ainsi au client d'effectuer simplement le calcul le concernant afin d'appréhender la mesure correspondant à son cas particulier. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 14/22083 ; Cerclab n° 5579 (contrat triple play ; client agissant sur le fondement d’un dol incident, l’arrêt admettant que cette présentation est une manœuvre ; dommages et intérêts pour le préjudice lié à la privation régulière de téléphonie portable en fin de mois, alors qu'il avait souscrit une formule dite « illimitée »), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 28 janvier 2014 : RG n° 11-13-000845 ; Dnd
Comp. se contentant d’apprécier le contrat en faveur du consommateur, en présence de clauses contradictoires concernant la définition de l'invalidité totale, par application de l’art.
Illustrations de clauses obscures. * Commission des clauses abusives. N’est pas rédigée de façon claire et compréhensible une clause d’un contrat d’assurance contre les vols de portable excluant la garantie en cas de vol commis sans violence ou sans effraction, alors que la garantie concernait les « vols caractérisés », rédaction qui implique seulement que l’infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. CCA (avis), 17 avril 2008 : avis n° 08-01 ; Cerclab n° 3752 (clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, et abusive selon la Commission dès lors qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel), sur demande de Jur. prox. Paris (17e arrdt), 20 février 2008 : Dnd. § Dès lors qu’eu égard aux circonstances de la souscription du crédit en cause et de l’adhésion à l’assurance de groupe, la stipulation litigieuse qui porte sur l’objet principal du contrat, est dénuée de clarté et d’intelligibilité, cette clause énonçant que les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur, qui ne permet pas à chacun des coemprunteurs solidaires de connaître clairement l’étendue de l’obligation de l’assureur, déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. CCA (avis), 16 octobre 2003 : avis n° 03-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3490. § V. aussi, moins net, le lien de la clause avec la définition de l’objet principal pouvant se discuter : la Commission des clauses abusives est d’avis que sont abusives les clauses d’un contrat de garantie automobile aboutissant, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurance la fixation du montant pris en charge. CCA (avis), 21 septembre 2006 : avis n° 06-03 ; Cerclab n° 3754 (pouvoir d’appréciation résultant apparemment d’une rédaction particulièrement complexe des stipulations, sur l’interprétation de laquelle la Commission reste prudente), sur demande de Jur. prox. Béziers, 6 juillet 2006 : Dnd, suivi par Jur. prox. Béziers, 23 novembre 2006 : RG n° 91-06-000024 ; jugt n° 1875/06 ; Cerclab n° 3781 (clauses abusives en ce qu’elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté à partir d’un kilométrage de
* Cour de cassation. Ayant ainsi fait ressortir que l’article n’était pas clair et compréhensible, au sens de l’ancien art. L. 132-1, alin. 7, C. consom. [L. 212-1 al. 3 nouveau], en ce qu’il ne définissait pas précisément l’ITT, de sorte qu’entraînant une restriction substantielle de garantie, il avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, la cour d’appel a, hors toute dénaturation et sans contrevenir aux art. L. 113-1 et L. 112-4 C. assur., retenu, à bon droit, qu’il présentait un caractère abusif, qui en commandait la suppression. Cass. civ. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-19107 ; arrêt n° 430 ; Cerclab n° 5605 (assurance-crédit ; ITT définie comme l’impossibilité absolue, pour un assuré ayant une activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, sans autre précision, alors que, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 janvier 2015 : RG n° 12/02971 ; Cerclab n° 5047, sur appel de TGI Grenoble, 7 mai 2012 : RG n° 09/05854 ; Dnd.
* Juges du fond. Pour des illustrations de clauses ne respectant pas cette exigence en matière d’assurance : en formulant les garanties souscrites et les montants garantis, de façon aussi alléchante, pour les réduire drastiquement de façon si complexe, l’assureur qui a délibérément privé son cocontractant des moyens d’effectuer toute comparaison, a mis en œuvre un contrat qui a eu pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce qui rend inopérante l’argumentation, qui dénie la possibilité de faire porter l’appréciation du déséquilibre significatif, sur la définition de l’objet principal du contrat dès lors que les limitations clairement exprimées de celui-ci ont été prises en compte dans le calcul du montant de la prime payée par le cocontractant. CA Aix-en-Provence (10e ch.), 16 mars 1999 : RG n° 94/17400 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 2613 (écart qualifié d’extravagant entre l’annonce des garanties souscrites - garantie de l’IPP, maximum pour un taux d’IPP de 100 % de
Pour des illustrations dans d’autres contrats : CA Douai (ord. tax.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/06616 ; Cerclab n° 5420 (avocat ; clause d'honoraire de résultat insérée en cours d’appel, sans que la portée de cet engagement puisse être réellement comprise par le client faute d'élément d'information sur la définition du résultat obtenu et les modalités de calcul, alors qu’au surplus l’avocat était tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, non-professionnel du droit), sur appel de Bâtonn. ordr. av. Valenciennes, 29 septembre 2014 : Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/02119 ; arrêt n° 389 ; Cerclab n° 1159 ; Juris-Data n° 2007-345675 (location de box ; caractère abusif de la clause d’exonération de responsabilité au titre de l’obligation de surveillance, alors les documents publicitaires et commerciaux multipliaient la référence à des éléments de sécurité laissant à penser au consommateur que le bailleur s’était engagé à assurer la surveillance des locaux), confirmant TI Toulouse, 7 février 2006 : RG n° 05/2289 ; Dnd - CA Lyon (2e ch.), 11 septembre 2001 : RG n° 1999/00655 ; Cerclab n° 1144 ; Juris-Data n° 2001-172306 (référence assez ambiguë à l’al. 7, apparemment pour en écarter l’application, en raison de l’absence d’information claire sur la nécessité pour le locataire de souscrire obligatoirement un contrat avec un fournisseur de chaleur imposé et sur l’absence d’obligation du bailleur au titre d’une autre installation de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 9 mars 2005 : pourvoi n° 01-18039 ; arrêt n° 311 ; Bull. civ. III, n° 59 ; Cerclab n° 1940 (problème non examiné ; action du bailleur repoussée au seul motif que les frais invoqués n’entrent pas dans la liste de charges récupérables).
Rappr., sans références aux clauses abusives, sous l’angle de la clarté de la stipulation : impossibilité pour un opérateur de téléphonie mobile de demander le paiement des forfaits résiduels en cas de résiliation pendant la période initiale, dès lors, notamment, que le contrat ne contenait aucune claire et précise sur la durée de l’engagement, celle-ci étant mentionnée sous la forme d’une réserve insérée dans un renvoi relatif à la catégorie d’appels concerné par le forfait, ce renvoi étant libellé en caractères d’imprimerie difficilement lisibles car de très petite taille et placé sous la signature de l’intéressée. CA Rennes (1re ch. B), 17 février 2011 : RG n° 07/04991 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 3992 (procédure de résiliation au surplus non respectée), sur appel de TI Nantes, 1er juin 2007 : Dnd.
Rappr. pour l’hypothèse, un contrat d’assurance de responsabilité stipulant que l’assureur ne s’engage qu’à garantir la part contributive finale de l’assuré, en l’espèce la responsabilité des parents du fait de leur enfant, sans prise en charge de l’obligation in solidum, clause concernant la définition de l’objet principal, en l’espèce le risque garanti, mais qui aurait sans doute pu être contrôlée dès lors que, figurant à l’art. 63 du contrat, elle ne pouvait être considérée comme claire et compréhensible au sens des anciens art. L. 132-1 al. 7 [L. 212-1 al. 3 nouveau] et 133-2 al.
Manquement à l’obligation d’information. Rappr. sous l’angle de l’obligation d’information : CA Nancy (2e ch. com.), 16 mai 2007 : RG n° 03/01158 ; arrêt n° 1201/07 ; Cerclab n° 1495 (absence de manquement de la banque à son obligation d’information dès lors qu’elle a remis les notices d’informations de l’assureur explicitant les conditions de mise en œuvre des différentes garanties par le biais de clauses très claires et accessibles à toute personne qui prend le soin de les lire) sur appel de TGI Nancy (2e ch. civ.), 27 mars 2003 : RG n° 01/02659 ; jugt n° 354 ; Cerclab n° 1445 (même conclusion, apparemment au visa de l’ancien art. L. 133-